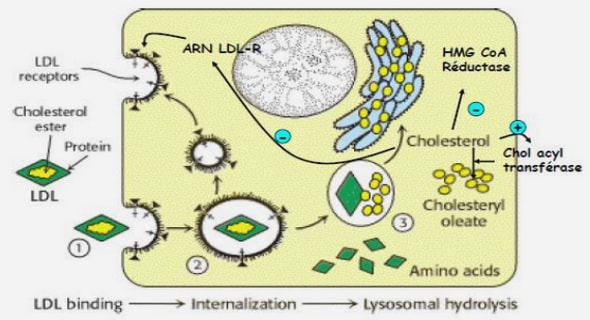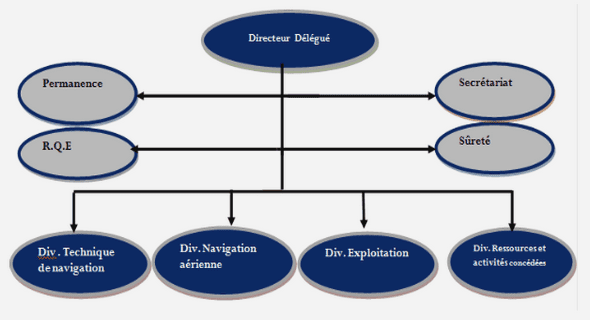Le probème de la classification
Si nous envisageons cette enquête suivant une perspective historiographique, nous devons toutefois marquer la distance avec une certaine façon de faire, qui nous paraît inadéquate. Un des traits marquant d’une certaine historiographie, en France, est la logique classificatoire à l’œuvre, expression d’une spécialisation progressive des disciplines et des histoires locales.
La tradition historiographique18, en France, a retenu la figure de Braudel et le paradigme labroussien comme point pivot de l’unification de l’histoire après la Seconde Guerre mondiale. Et elle l’a fait au moment même oùl’on constatait la disparition de l’unité disciplinaire. Au début des années 1970, Pierre Nora lançait la célèbre collection attaques du linguistic turn venu d’outre-Atlantique 22. Le même François Dosse devint, au cours des années 1990, une figure centrale de l’historiographie, discipline conçue comme histoire de l’histoire. C’est à lui, entre autres, que l’on doit une certaine vision historiographique : celle d’un âge d’or de l’histoi re qui s’est effondré sous les coups du structuralisme, du linguistic turn et finalement de la diversification. Cette vision historiographique s’est répandue par le biais de manuels et d’ouvrages à destination des nouvelles générations d’étudiants.
Si cette vision manifeste l’essor de l’historiograp hie comme discipline tendant à l’autonomie 24, elle présente aussi le risque d’une lecture paradigmatique de l’histoire savante du XXe siècle centrée sur le concept decourant historique25. En effet, dans cette représentation de l’historiographie française, se succèdent des courants historiques articulés sous l’angle de la génération, jusqu’à unpoint clé où divers courants en viennent coexister à partir des années 1980. En outre, cet te lecture en terme de succession linéaire relève d’un impensé, celui du progrès de la discipline historique atteignant l’âge d’or du moment braudélien et labroussien, poursuivi par la « Nouvelle Histoire » de Le Goff et Nora, puis finalement de son effondrement dans les labyrinthes de l’émiettement. Le problème pour nous est que ce tableau prétend intégrer l’anthropologie historique comme courant, qui interagit, à travers une logique d’emp runt et de changements, avec les autres courants historiques – ce qui peut être pertinent pour certaines anthropologies historiques, celle des Annales justement, mais non pas pour celle inventée par Vernant. De plus, penser en termes de courant historique induit de penser un ou plusieurs auteurs de référence inventant un nouveau champ d’investigatio poursuivi par des disciples, comme la troisième génération des Annales fut disciple de la seconde. Cette logique classificatoire, permettant une représentation unifiée de l’histoire de la discipline au XXe siècle, et élaborée à partir du modèle de l’histoire des Annales, présente des limites irréductibles, dès lors que l’on envisage la penséehistorique dans un sens plus large.
Cette historiographie est non perspectiviste. Ceci a pour conséquence deux écueils majeurs. Le premier est que le système de classification qu’elle met en place a pour critère l’objet des recherches, non pas les problèmes qui les ouvrent. Classer les enquêtes historiques en termes de courants présente un intérêt didactique indéniable. Cela sert à voir clair, à se faire une idée générale de l’évolution de la discipline. Cependant, cela prend le risque de regrouper ensemble des enquêtestrès hétérogènes, à la seule condition qu’elles ont une même notion en titre, un même objet, ou un même auteur . Autrement dit, une telle classification se fonde sur des continuités lexicales superficielles du point de vue des enquêtes. Car comme nous allons le voir, une notion ou un concept trouvent leur signification, certes dans une définition, mais surtout dans leur insertion dans une enquête, conçue comme espace problématique dynamique qui détermine pour une grande part le comportement des outils qui s’y déploient, et qui construit son objet d’une façon particulière. Cela ne signifie pas qu’il n’y a rien en commun entre les historiens se revendiquant, par exemple, d’une histoire des mentalités. Cela signifie simplement que pour comprendre le sens de cette revendication, il importe de l’examiner plus profondément, enquête par enquête.
La seconde conséquence est plus profonde, et explique aussi cette logique superficielle de classification. L’absence de conception perspectiviste de l’histoire révèle un impensé qui doit être déconstruit. Nous pourrions qualifier cet impensé de réalisme. La logique classificatoire se fonde sur une conception de la synthèse historique qui remonte probablement à Henri Berr 27. Le terme vise alors l’unification de diverses disciplines du point de vue théorique et du point de vue des résultats, et non pas la fin d’un mouvement dialectique selon la tradition hégélienne. La synthèse historique est donc la finalité possible du savoir. Ce maître-mot est reconduit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, contexte qui nous occupe au premier chef, par Fernand Braudel, dont on connaît le projet d’unification des sciences de l’h omme sous le langage de l’histoire 28. En même temps qu’une finalité synthétique, l’histoirede Fernand Braudel représente un nouveau paradigme, celui de la seconde génération esd Annales. Si Braudel patronne la nouvelle génération d’historiens, le paradigme quidevient dominant doit cependant plus à Claude-Ernest Labrousse qu’à Fernand Braudel. C’est Labrousse qui fournit un modèle unifié d’explication du monde historique, inspiré de Marx, et qui lui permet de rendre raison de la Révolution Française29. Le paradigme labroussien30 articule, à travers un schème de causalité unifié, une théorie du changement, dans laquelle les mouvements des prix et les systèmes de production, donc les réalités économiques, déterminenten dernière instance les changements sociaux et politiques. On le voit, un tel paradigme reconduit la volonté de synthèse et de classification des plansde réalité – et des disciplines en ayant la responsabilité – selon un schéma causal, dans leque le sujet de causalité – au sens grammatical du terme – relève le plus souvent de l’ économique. Les régions de la réalité historique sont non seulement classées, mais articulées ensemble.
Il y a, dans le geste même de classification des histoires locales qu’opère l’historiographie des manuels universitaires, la reconduction de cet esprit de synthèse, et d’une conception représentationnelle et cumulative de l’histoire. L’invention d’un nouveau champ historique, d’un nouveau « territoire de l’historien »31, est conçue comme l’ajout d’une nouvelle région du monde à la recherche historique. Le vocabulaire de la territorialité en est l’indice le plus net, qui exprime une conception cumulative et non problématique à l’œuvre dans l’histoire de la disci pline. Se dessine alors une trame historique inventant l’objectivité de l’histoire par l’extension progressive de son domaine d’expertise, et non comme reformulation critique de nouveaux problèmes. De ce fait, il est possible de faire le constat d’un certain échec du programme de l’histoire-problème de Lucien Febvre32. Or cette conception problématique des enquêtes historiques est peut-être l’instrument épistémologique le plus adéquat pourppréhendera l’histoire de la discipline.
Il permet en outre de dépasser l’obstacle épistémolgie des continuités lexicales.
Un fait manifeste la difficulté qu’une tentative de classification des courants historiques rencontre face à l’anthropologie histor ique de Vernant. Dans l’ouvrage collectif Une Ecole pour les sciences sociales, dirigé par Jacques Revel et Nathan Wachtel33 une typologie des courants est proposée, permettan de classer les diverses disciplines représentées à l’Ecole. Un article est consacré à l’anthropologie historique. Il présente ce courant actuel en listant quatre perspectives : anthropologie historique de l’économie, anthropologie historique de la parenté, anthropologie historique du symbolique et du religieux et anthropologie historique du politique. Ces quatre courants suivent la structuration institutionnelle de l’anthropologie française. Le fait marquant est qu’un autre article est consacré uniquement à l’anthropologie historique de la Grèce. Les représentants de ce courant – au premier rang desquels figurent Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet – sont absents de l’article précédent. Pourquoi traiter à part de l’anthropologie historique de la Grèce ancienne ? En vertu de quels critères cette mise à l’écart est-elle justifiée ? Peut-être la plus grande structuration institutionnelle de l’anthropologie historique de la Grèce, notamment autour de Vernant et du Centre Louis Gernet, justifie-t-elle de traiter ce « courant » à part. Cependant, sans vouloir entrer dans la logique éditoriale à l’œuvre dans cet ouvrage, n otons simplement que la séparation surprend et exprime la difficulté à saisir l’anthropologie historique comme courant unifié.
Cette même difficulté s’exprime dans l’historiographie entreprise par André Burguière34 dans les recueils, dictionnaires et textes programmatiques de la Nouvelle Histoire. Prenant le terme « anthropologie historique » sans opérer une analyse épistémologique des enquêtes, Burguière tente luiussia de délimiter un courant historique. Le problème émerge dès lors qu’il est onfrontéc à l’impossibilité de produire une définition distinctive de l’anthropologie historique, donc à saisir la rupture épistémologique qu’elle constitue par rapport à l’histoire sociale et la divergence de problème qu’elle exprime avec l’histoire des mentalités. La conséquence de cette historiographie des courants historiques est qu’elle brouille les pistes, et rend inintelligible l’invention d’une discipline nouvelle par Vernant. Il faut donc envisager la logique classificatoire à l’œuvre ici comme un obstacle épi stémologique.
L’obstacle épitémologie des continuités lexicales
Cet obstacle a été largement examiné par Michel Foucault dans l’ Archéologie du savoir, lorsqu’il entreprend de déconstruire les régularités discursives implicites à l’œuvre dans une certaine histoire des idées traditionnelle:
Il y a d’abord à accomplir un travail négatif : s’affranchir de tout un jeu de notions qui diversifient, chacune à leur manière, le thème de la continuité .»35
Il a mis en évidence quatre hypothèses qui sous-tendent implicitement le regroupement des énoncés dans l’impensé de cette manière traditionnelle de lire les textes. Il paraît utile de les rappeler succinctement, car leur mise à l’écart constitue un préalable à l’élaboration de notre méthode d’enquêt.
La première hypothèse à écarter est que « les énoncés différents dans leurs formes, dispersés dans le temps, forment un ensemble s’ils se réfèrent à un seul et même objet ». Or chaque discours construit son objet. Toute classification des pensées historiques en termes d’objet est donc fortement risquée. La seconde hypothèse est que les énoncés forment un ensemble par « leur forme et leur type d’enchaînement ». Cet ensemble se caractériserait par « un certainstyle, un certain caractère constant de l’énonciation ». Or, il existe « des formulations de niveaux trop différents, de fonctions trop hétérogènes pour pouvoir se lier et se composer en une figure unique et pour simuler à travers le temps une sorte de grand texte ininterrompu38 ». Les continuités historiographiques doivent donc être préalablement suspendues. La troisième hypothèse serait que les énoncés forment un ensemble par le système des concepts permanents et cohérents qui s’y trouvent mis en jeu. « Mais on se trouve en présence de concepts qui difèrent par la structure et les règles d’utilisation, qui s’ignorent ou s’excluent et qui ne peuvent entrer dans l’unité d’une architecture logique39 ». Il faut donc réexaminer l’unité des architectures logiques à travers une lecture plus méticuleuse des enquêtesLa. dernière hypothèse serait que les énoncés forment un ensemble par « l’identité et lapersistance des thèmes40 ». Cependant, « on trouve plutôt des possibilités stratégiques diverses qui permettent l’activation de thèmes incompatibles, ou encore l’investissement d’un même thème dans des ensembles différents ».
La solution proposée par Foucault est alors de concevoir les énoncés suivant une dispersion initiale, avant d’envisager tout regroupement des énoncés. A l’égard de l’historiographie, c’est ce même geste préalable que nous envisageons. L’espace de dispersion que représente l’ensemble des textes de Jean-Pierre Vernant doit d’abord être mis à plat, indépendamment des diverses tentatives de classification dont il a fait l’objet. Ceci constitue un premier geste pour notre enquête qui se présente ensuite comme épistémologie. Par ce terme, il ne faut pas entendr ce qu’il fut dans une première acceptation. Il ne s’agit pas d’évaluer la valeur d’une connaissance scientifique en fonction de son adéquation à l’égard d’un concept préalable de vérité. Au contraire, il s’agit de comprendre l’ensemble des opérations intellectuelles à l’œuvre dans une pensée investigatrice et problématique. Il s’agit de comprendre la mécanique des solutions pratiques et théoriques inventées par un penseur pour résoudre les problèmes qui l’occupent.
Force est de constater la rareté de ce type de réflexions portant sur la pensée historique française et son fonctionnement épistémologique42. Peut-être est-ce là une conséquence du fossé, entretenu par les historiens français, entre l’histoire et la philosophie. Ce fossé serait reconduit dans une certaine historiographie43. Or la mise à Certaines entreprises font exception, notamment celle d’Henri-Irénée Marrou, De la connaissance historique, Paris, Editions du Seuil, 1954 ; celle de Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, Editions du Seuil, 1971 ; celle de Michel de Certeau, L’Ecriture de l’histoire , Paris, Gallimard, 1975. Ce type de questionnement, en France, est ouvert par la thèse de Raymond Aron, Introduction à la philosophie de l’histoire. Essai sur les limites de l’objectivité historique, Paris, Gallimard, 1938, qui traduit a contrario l’importance que les questions d’épistémologie de ’histoirel ont en Allemagne depuis le XIXe siècle. Ces préoccupations épistémologiques sont ouvertes notament par les thèses de Wilhelm Dilthey et Max Weber sur l’histoire : Wilhelm Dilthey, Critique de la raison historique. Introduction aux sciences de l’esprit [1883], Paris, Le Cerf, 1992 ; Max Weber, Essai sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965. Voir à ce sujet Otto Gerhard Oexle, L’historisme en débat. De Nietzsche à Kantorowicz, Paris, Aubier, 2001.
L’usage du terme même d’historiographie, souvent synonyme d’épistémologie de l’histoire, est sans doute un indice de ce fossé, tandis que les autres disciplines des sciences sociales n’hésitent pas à utiliser le mot l’écart de l’épistémologie, comme entreprise de compréhension des opérations intellectuelles à l’œuvre dans la production savant e, prédispose justement une projection non contrôlée des continuités irréfléchies sur la aseb de continuités lexicales. L’anthropologie historique serait un même courant partout où le vocable est utilisé, et il aurait la responsabilité d’une région particulièrede la réalité. En-deçà de ces continuités lexicales gouverne précisément le postulat de la synthèse, fondée sur l’idée d’une agrégation cumulative possible des différentes histoires locales. Chez Burguière, l’anthropologie historique s’inscrit dans la contin uité de l’histoire des mentalités – ce qui peut être pertinent dans une certaine mesure si l’on parle de l’anthropologie historique de Le Goff44. Cependant, l’anthropologie historique de Vernant ne répond pas à un tel schéma. En outre, dans la pensée de Vernant, la logique classificatoire moderne fait figure d’obstacle épistémologique au sens que Bachelard donne à ce terme 45. Les catégories classificatoire – le religieux, le politique, l’économique, le mental –, qui gouvernent aussi l’esprit de synthèse résiduel dans l’historiographie, sont suspendues car anachroniques dans leurs formes intuitives. Si elles sont utilisées, elles doivent d’abord passer par un processus de traduction. Dès lors, c’est le postulat de l’homogénéité entre nos catégories classificatoires et la réalité historique qui s’effondre.
La normativité épistémologique de l’enquête
C’est l’épistémologie historique de Georges Canguilhem qui va nous servir de modèle pour élaborer notre méthode de lecture desextes. Elle s’articule sur le concept de normativité élaboré par Canguilhem, et sur le concept d’enquête, construit par John Dewey. Ces deux cadres théoriques rendent possible une manière adéquate d’analyser les pratiques savantes, sous l’angle d’une théorie du problème et de ce que nous appelons une éthologie du concept : peuvent servir de modèle ; elles montrent que l’histoire d’un concept n’est pas, en tout et pour tout, celle de son affinement progressif, de sa rationalité continûment croissante, de son gradient d’abstraction, mais celle de ses divers champs de constitution et de validité, celle de ses règles successives d’usage, des milieux théoriques multiples où s’est poursuivie et achevéeson élaboration. […] Et le grand problème qui va se poser – qui se pose – à de telle s analyses historiques n’est donc plus de savoir par quelles voies les continuités ont pu s’établir […] – le problème n’est plus de la tradition et de la trace, mais de la découpe et de la limite : ce n’est plus celui du fondement qui se perpétue, c’est celui des transformations qui valent comme fondation et renouvellement des fondations. »46 L’intérêt des regroupements théoriques que nous isonsfa pour construire notre méthode, tient précisément dans le fait de concevoir la pensée, et la pensée historique, comme une pratique – un ensemble d’opérations – présidant à un discours – un ensemble de résultats. En ce sens, notre méthode répond point par point aux trois postulats avancés par Michel de Certeau dans son analyse de l’ « opération historique » :
1) Souligner la singularitéde chaque analyse, c’est mettre en cause la possibilité d’une systématisation totalisante et tenir pour essentielle au problème la nécessité d’une discussion proportionnée à une pluralité de procédures scientifiques, de fonctions sociales et de convictions fondamentales. […]
Ces discours ne sont pas des corpus flottant « dans » un englobant qu’on appellerait l’histoire (ou le « contexte » !) Ils sont historiques parce que liés à des opérations et définis par des fonctionnements. Aussi ne peut-on comprendre ce qu’ils disent indépendamment de lapratique d’où ils résultent. […]
3) Pour cette raison, j’entends par histoire cette pratique (une « discipline »), son résultat (le discours), ou leur rapport sous la forme d’une « production ». […] » 47
Reprenant directement à notre compte cette définition de l’histoire, non certes comme « discipline » puisque Vernant n’en a pas suivi la formation, mais comme pensée historique, nous allons analyse l’ensemble des opérations à l’œuvre dans la pensée de Vernant. Cet ensemble d’opération est thématisé sou l’angle d’une normativité épistémologique.