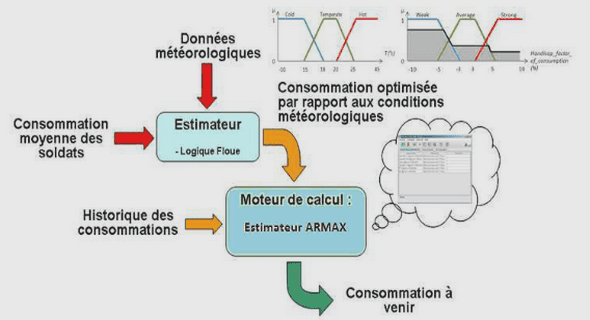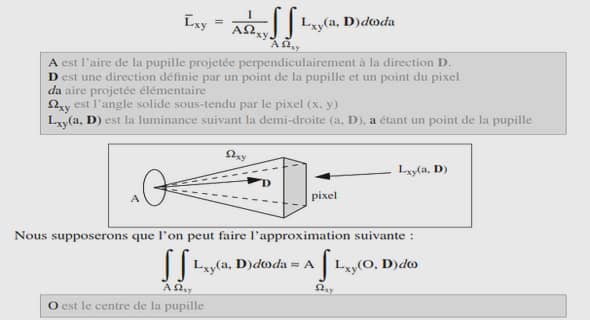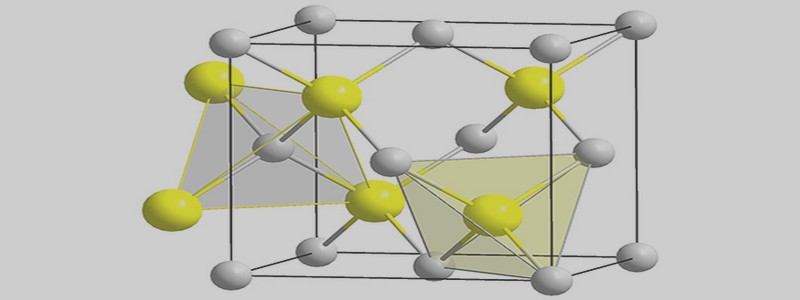Les réponses terminologiques de l’UIPAC
l’expression du linguiste « mode de désignation » correspond celle du chimiste de « règles de nomenclature » où le terme nomenclature80 s’utilise pour désigner un ensemble de règles permettant d’attribuer à une entité chimique un nom qui n’appartienne qu’à elle seule et inversement d’établir sans ambiguïté, à partir du nom, la structure (ou « formule développée ») de l’entité qu’il désigne. Signalons d’entrée que cette définition n’est pas réflexive : une entité chimique peut posséder plusieurs « noms systématiques » (sôshikimei, 組 織 名 ) ou « noms semi-systématiques81 » (hansoshikimei,半組織名), même s’il est le plus souvent fait état, lorsque l’on traite des questions de nomenclature, de la dichotomie entre nom systématique (« dioxyde de carbone ») et nom dit trivial82 (« gaz carbonique », cholestérol », « urée »). Le nom systématique d’une molécule se construit par la réunion, dans un ordre et selon des règles d’écriture strictement déterminées, d’éléments traduisant chacune de ses particularités. En chimie organique par exemple, c’est le nom de la chaîne d’atomes de carbone, c’est-à-dire le nom de l’hydrocarbure ayant le même squelette carboné qui constitue la base du nom Il ne s’agit pas d’un mode de classement en vue de constituer un répertoire, l’autre sens de nomenclature. L’expression japonaise équivalente signifiant littéralement méthode de désignation meimeihô, 命名法 est à cet égard plus explicite pour un non-spécialiste.
Un nom semi-systématique est un nom dont « une partie au moins a une signification systématique ». Par exemple dans acétone la terminaison -one : indique que le composé contient un groupe carbonyle (C==O) c’est-à-dire qu’il appartient à la famille des cétones. Cette même molécule possède aussi deux noms systématiques: « propanone » et « diméthylcétone ».
Il s’agit de l’expression employée par les chimistes français pour désigner les termes non-conformes à la nomenclature systématique (UIPAC), c’est-à-dire dont « aucune partie n’a de signification systématique » [PANICO,RICHER 1994 :18]. les Japonais retiennent le terme de composé. On ajoute ensuite à ce nom des préfixes et/ou des suffixes qui sont assortis d’indices numériques afin d’indiquer la nature et la position sur la chaîne des atomes que contient la molécule.
La formule développée de l’éthane83 (un alcane linéaire doté de 2 atomes de carbones ) est : H3C-CH3
La formule développée de l’octane (un alcane linéaire doté de 8 atomes de carbone) :H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
L’alcane ramifié de formule : H3C-CH2-CH2-CH2-CH-CH2-CH3 CH2-CH2-CH3
Il porte le nom de : 4-éthyloctane84
On considère que la molécule (27) est formée d’une chaîne principale portant des susbtituants ou « chaînes latérales » constitués de groupes alkyles85. Le nom à construire comportera [l’indication numérique de la position du substituant (4) + le nom du substituant (éthyl) + le nom de la chaîne principale (octane)]. La chaîne principale est par convention celle qui possède le plus long enchaînement de carbones : ici (en caractères gras) on compte huit carbones donc le nom de l’alcane linéaire constituera la base du nom à construire : « octane » (exemple 26). L’endroit de la ramification doit porter le plus petit numéro possible : ici 4. Le nom du substituant est fabriqué à nouveau à partir de l’alcane correspondant (ici éthane, Ethane est le nom usuel, c’est à partir de 5 atomes de carbones que les alcanes sont nommés par des racines latines ou grecques traduisant la longueur de la chaîne : pentane (5 atomes de carbone) deux atomes de carbone, l’exemple 25) soit éthyle, toutefois son emploi comme préfixe s’accompagne de la perte de son « e » muet. L’exemple d’emploi de la nomenclature systématique (de l’UIPAC) présenté ci-dessus montre qu’il faut pouvoir « visualiser » la molécule dans l’espace, c’est-à-dire connaître son architecture, les chimistes diraient sa structure, pour lui attribuer un nom. Il existe, faut-il le souligner, de nombreuses autres règles de nomenclature établies par l’UIPAC qui permettent de nommer des molécules composées d’autres types d’atomes et dotées de structures complexes. L’évolution des connaissances relatives aux structures moléculaires et bien sûr la synthèse de nouvelles molécules entraînent leur mise à jour régulière. Ces règles, décidées au niveau international, au sein de l’UIPAC, sont d’abord rédigées et publiées en langue anglaise sous le titre de « Principles of Chemical Nomenclature ». Puis, dans des délais plus ou moins longs, les comités nationaux, dont fait partie la société savante éditrice de Nippon Kagaku Kaishi (NKK), en réalisent une adaptation-traduction86.
La version francophone des recommandations souligne « la nécessité de posséder un langage compris de tous mais respectant les habitudes linguistiques des différents pays» [LEIGH, FAVRE 2001]. Il se trouve en effet que la nomenclature internationale actuelle diffère sur quelques points de la nomenclature en langue française. Illustrons notre propos à l’aide de deux exemples afin de mieux appréhender la diversité linguistico-culturelle des acteurs de la chimie. Nous avions expliqué précédemment comment établir le nom d’un alcane doté d’une seule ramification.
Prenons cette fois le cas d’une molécule comportant deux ramifications de même nature, le « 2,4 diméthyldécane ». Ce nom se compose, des indices marquant la position des substituants87 (« 2,4 »), du préfixe « di » indiquant que le nombre de substituants identiques est égal à deux, du nom du substituant « méthyl » et de la fin du nom de la structure de base qui est ici composée de dix atomes de carbones : décane ». Le terme anglais est « 2,4 dimethyldecane » : seule la disparition de l’accent différencie les deux notations.
L’exemple suivant concerne l’indication d’une double liaison établie entre deux atomes de carbones. Celle-ci est notée à l’aide de la terminaison diène » (« diene » en anglais). La molécule de structure [H2C==CH-CH2==CH2] se désigne « 1,4 pentadiene » selon la nomenclature anglaise. Cette fois en tête nous trouvons « 1,4 » : les indices marquant la position des liaisons multiples (==), penta » indique qu’il s’agit d’une chaîne de 5 atomes de carbones et « diene » traduit les deux doubles liaisons identiques.
Si l’on met côte à côte les noms « 2,4 dimethyldecane » et « 1,4 pentadiene », on constate que dans le premier cas, les indices « 2 » et « 4 » servent à désigner l’emplacement de substituants alors que dans le second cas le « 1 » et le « 4 » notent chacun la localisation de la double liaison. En d’autres termes, une notation identique sert en anglais à désigner deux choses différentes, alors qu’en français la double liaison est signalée par la forme « penta-1,4-diène ». La nomenclature francophone perpétuerait-elle ainsi l’héritage de Lavoisier qui, en disciple de Condillac, associait « la rigueur scientifique et la précision du langage » sans être suivi sur ce point par les autres Européens [BENSAUDE-VINCENT 2000 : 81] ? Il est permis de le penser, si l’on considère que les exercices de nomenclature88 continuent à occuper une place de choix dans le cursus des chimistes français89.
La problématique du « nom unique »
La commission internationale reconnaît l’importance du « nom unique », notamment pour les brevets, la sécurité, etc, toutefois, il faut savoir qu’« un ensemble de règles, qui conduit à des noms clairs et efficaces pour certains composés, peut fournir des noms maladroits et presque impossibles à reconnaître pour d’autres composés » [PANICO, RICHER 1994 : 1]. Ainsi, elle offre le plus souvent des « ensembles alternatifs de recommandations, également systématiques, chaque fois que c’est possible, pour permettre à l’utilisateur de construire un nom adapté à un besoin particulier » [PANICO, RICHER 1994 : 2]. Or, dans le contexte dit d’explosion ou raz-de-marée d’informations déjà illustré, et aux enjeux du « nom unique », les réponses qui sont apportées par les comités nationaux relèvent de priorités divergentes. Il convient avant toute chose de distinguer ici la langue d’expression (anglais, français, japonais) de l’usage d’une nomenclature systématique.
Il ressort de ce qui précède que la nomenclature chimique se conçoit, traditionnellement, comme un outil permettant de décrire, le plus fidèlement possible, une structure moléculaire. Or, cette fonctionnalité va de pair avec une souplesse d’adaptation aux besoins potentiellement variés qui autorise une pluralité de désignations pour une même molécule. Dans le contexte précité, marqué par l’explosion de l’information, il est clair que la souplesse apportée par la pluralité des noms entre en conflit avec sa commodité, notamment en termes de classement d’un nom unique ». Ce débat est ancien : il divise les chimistes sur la question centrale de la fonction prioritairement dévolue à la nomenclature : décrire ou indexer ?
La réponse de l’American Chemical Society à l’origine des Chemical Abstract (CAS®) déjà cités consiste à privilégier « l’indexation sous un nom unique afin d’éviter un grand nombre de références croisées et d’entrées multiples. » Cette nécessité l’a conduite « à classer ensemble des composés ayant le même squelette fondamental90 et en même temps à réduire au minimum le nombre de règles » [PANICO, RICHER 1992]. Une telle option peut sembler en contradiction avec la nomenclature UIPAC or, les chimistes américains réfutent l’argument selon lequel les deux modes de désignation sont antagonistes [BLOCK et al. 1990] . Quel que soit le point de vue adopté par le rédacteur en langue seconde, il est clair qu’il doit vérifier la nature des consignes terminologiques des revues de chimie, ce que nous allons faire dès à présent.
Ceci sous-entend que des composés qui ne possédent pas exactement la même structure peuvent toutefois être désignés par un nom identique.
Les consignes des revues de chimie du corpus.
Trois types de consignes peuvent être distinguées : celles qui portent sur la nomenclature, celles qui traitent de l’usage des symboles, unités, acronymes et abréviations et enfin celles qui abordent les questions de néologie.
Les nomenclatures chimiques
Compte tenu de l’importance des échanges scientifiques internationaux et du volume écrasant de publications de chimie rédigées en langue anglaise91, nous pouvons conjecturer que les auteurs japonais et français se posent la même question : Est-il possible d’employer telle quelle dans les revues japonaises la nomenclature habituellement en usage dans les revues anglophones ? Incidemment, nous pouvons nous demander si, de la même manière qu’elles acceptent l’usage de l’orthographe américaine, les revues britanniques autorisent la notation retenue par l’American Chemical Society : le Ring Index. Examinons pour commencer les normes explicitées par NKK et YKZ, soit deux des trois revues de chimie de notre corpus.
YKZ :「命名法:化合物の命名法は UIPAC 制定の命名規則に従って下さい。しかし、Chem.Abstr.の索引の命名法並びに RingIndex の命
名法に準ずることもできます。」[Meimeihô: kagôbutsu no memeihô wa UIPAC seitei no meimei kisoku ni shitagatte kudasai. Shikashi, Chem.Abstra. no sakuin no meimeihô narabini RingIndex no meimeihô ni junzuru koto mo dekimasu.]
«La nomenclature des entités chimiques doit répondre aux normes de l’UIPAC. Toutefois, il est possible d’adopter les nomenclatures en vigueur dans les Chemical Abstracts comme le Ring Index.»
Nous constatons, une nouvelle fois, que la politique des revues n’est pas uniforme au sein d’une même aire linguistique. NKK, revue généraliste, exige le respect des normes de l’UIPAC (anglaises ou japonaises) tandis que YKZ spécialisée en pharmacie accepte aussi bien la nomenclature de l’UIPAC que celle, américaine, des Chemical Abstracts sans spécifier cependant si elle se limite ou non à leur adaptation en japonais.
Les revues britanniques du corpus, éditées par la Royal Society of Chemistry, ne reconnaissent que l’usage de la nomenclature de l’UIPAC. Elles stipulent : ANL: Current internationally recognized (UIPAC) chemical nomenclature should be used. Common trivial names may be used, but should first be defined in terms of UIPAC nomenclature. «La nomenclature chimique (UIPAC) reconnue au niveau international doit être appliquée. On peut employer les noms triviaux à condition d’être d’abord définis au moyen des règles de l’UIPAC.»
DLT-PKT : For many years the Society has actively encouraged the use of standard UIPAC nomenclature… as an aid to the accurate and unambiguous communication of chemical information between authors and readers». «In order to encourage authors to use UIPAC nomenclature rules when drafting papers, attention is drawn to the following publications in which both the rules themselves and guidance on their use are given.
«De longue date la Société (Royale de Chimie) mène une politique visant à promouvoir activement l’emploi des normes de l’UICPA… qui aident à assurer entre auteurs et lecteurs une communication précise et exempte d’ambiguïté…». «Afin d’encourager les auteurs à utiliser la nomenclature UIPAC nous attirons leur attention sur les publications ci-dessous qui présentent à la fois les règles et des conseils pour leur application.»
Consciente des difficultés que les auteurs peuvent rencontrer, DLT et PKT offrent leurs conseils en accord avec la raison sociale de la société savante britannique: assurer la promotion de la chimie. DLT-PKT :It is recommended that where there are no UIPAC rules for the naming of particular compounds or authors find difficulty in applying the existing rules, they should seek the advice of the Society’s editorial staff.
«S’il n’existe pas de règles UICPA pour nommer un composé particulier ou si l’auteur rencontre des difficultés à appliquer les règles en vigueur, il est recommandé de demander conseil auprès du comité éditorial de la Société.»
Ainsi, nous retiendrons que si les variantes orthographiques américaines sont acceptées par les revues britanniques (voir chapitre deux), l’usage des normes américaines de nomenclature, et en particulier celles des Chemical Abstracts n’est absolument pas envisagé. En adoptant les normes de l’UIPAC, le rédacteur, en L1 comme en L2, s’assure une audience des plus larges, toutefois, la question du « nom unique » reste en suspend : elle est laissée dans l’ombre dans toutes les revues du corpus.
Les Comptes rendus de l’Académie des Sciences (CRC) ne traitent pas des questions de nomenclature, sans doute parce que, comme nous l’avons déjà signalé, celles-ci occupent une place de choix dans la formation des chimistes français. Il faut ajouter que la nomenclature anglaise de l’UIPAC y est enseignée en marge de la version française lorsqu’elle retient une notation qui diffère de façon importante (Voir l’exemple du terme anglais « 1,4 pentadiene » et de son équivalent français « penta-1,4-diène »). Les Chemical Abstracts® sont bien sûr consultés dans les laboratoires français, mais leur nomenclature demeure relativement sous-utilisée92.
L’usage des symboles, unités, acronymes et abréviations
Le traitement des questions relatives aux symboles chimiques, aux unités, aux acronymes et abréviations ressemble, d’un certain point de vue, à celui des graphies japonaises. Il définit en effet des « lieux ou cadres d’écriture », des formes autorisées, des formes acceptées ou tolérées sous réserve d’être assorties, au moins à leur première occurrence, de leur « lecture » ou transcription. Alors que l’usage des acronymes et des abréviations s’observe à la fois dans les revues relevant des sciences humaines93 et des sciences expérimentales, il apparaît à nouveau que seules ces dernières expriment des préférences ou des directives.
Les lieux d’écriture concernent les symboles chimiques (H2O) : explicitement bannis du corps du texte des articles publiés dans NKK, ils ne doivent apparaître qu’à l’intérieur des équations chimiques. Ce point n’est pas abordé dans les revues britanniques et françaises du corpus, sans doute parce qu’il s’agit d’une convention d’écriture qui différencie traditionnellement le cahier de laboratoire de l’article publié94.