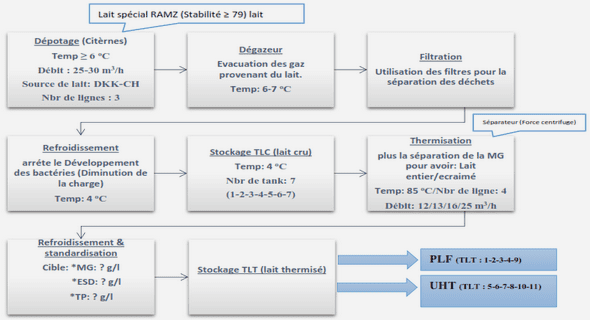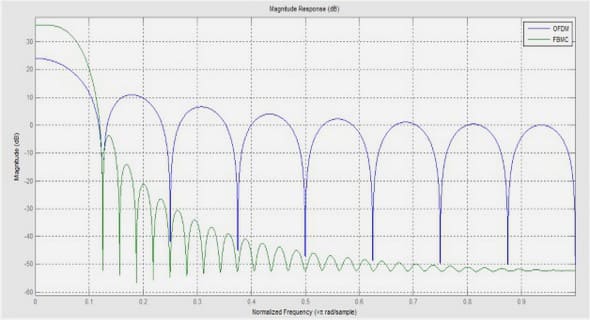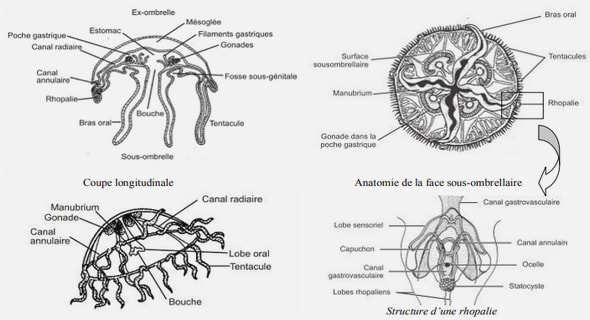Défis méthodologiques et épistémologiques
Lorsque la science étudie un phénomène quelconque cela se fait à partir d’observations empiriques. Parfois ces observations peuvent être faites en utilisant des méthodes particulières, comme dans le cas de l’observation participative dans le cadre de la recherche anthropologique. Parfois la science emploie des dispositifs énormes, coûteux et très sophistiqués, comme dans le domaine de la physique nucléaire. En dépit des différences évidentes et considérables entre ces sciences, il nous semble qu’il existe une caractéristique commune essentielle : la nécessité d’expliquer le visible par l’invisible. Mais pour parvenir à cette fin la science doit d’abord utiliser des techniques pour rendre ce monde invisible visible. Ces médiations différentes comprennent des instruments d’observation ou de mesure pour sonder le monde et des changements de propriétés associés et également des interprétations fondées sur des théories. Ainsi, pour comprendre les maladies contagieuses, nous rendons le monde microbiologique visible par l’utilisation du microscope, mais nous employons aussi des techniques diverses pour rendre discernables les effets des microorganismes sur notre propre organisme (observation clinique, stéthoscope, tests sanguins, etc.) Au niveau de la population nous pouvons également tracer les interactions des microorganismes « invisibles » ou d’autres influences par le comptage des cas ou bien d’autres indicateurs dans une population humaine. Cet acte de rendre l’invisible visible nécessite que nous traduisions le visible en invisible et vice-versa. Cet acte de traduction, comme Latour, (2001) l’explique, donne la possibilité à la fois de réduire la réalité confuse en termes plus simples et compréhensibles, mais aussi d’utiliser les résultats d’une série de traductions pour ensuite comprendre la réalité à l’étude ou par analogie d’autres réalités. Ce processus dépend du fait de traduire, et souvent de remplacer, la définition d’un phénomène par d’autres définitionsobjectivables. Ce qui est crucial dans ce processus est l’acceptabilité de cette définition. Or notre travail concerne d’une part, la culture et les phénomènes interculturels ainsi que l’implication du self dans cet ensemble et d’autre part, la santé et la santé publique ainsi que les interactions entre ces deux domaines et les implications de cette approche pour les pratiques de formation, les pratiques et les politiques sanitaires, sociales et éducatives. Or, il est bien connu que cet ensemble d’objets se montre assez récalcitrant à la définition. Si, dans les sciences physiques, ce processus de traduction se passe naturellement et la plupart du temps sans commentaire puisque ce processus de traduction est devenu normalisé grâ ce à des critères de définitions et des indicateurs objectivables, dans le cas des sciences humaines et surtout des sciences psychologiques et sociologiques, fondées sur le sens, ce processus de traduction ne va pas forcément de soi car chez l’homme cette objectivation comporte des difficultés intrinsèques liées à la fois, à la nature insaisissable des phénomènes psychologiques ainsi qu’à des problèmes éthiques et pratiques associés à une telle objectivation. Si, pour un chimiste dans son rôle de scientifique, l’eau est toujours H2O, pour un autre homme le sens de l’eau va varier selon le contexte et ainsi nous pouvons parler, comme Shweder (1991), d’objet intentionnel. Dans la littérature philosophique, selon Descombes (1996), il existe trois formules de l’intentionnalité. L’intentionnalité serait la propriété de l’esprit conforme à l’idée que (I) « toute conscience est conscience de quelque chose. »(II) Toute conscience vise un objet.
Dans toute conscience, quelque chose est présenté au sujet ». (p.29)). Ainsi dans un baptême, l’eau bénite possède d’autres propriétés que celles l’eau du robinet, de même l’eau pour l’homme perdu dans le d ésert est radicalement différente de l’eau qu’on utilise pour prendre un médicament ou même de celle utilisée en guise de placebo. De plus, si nos représentations d’objets sont influencées par le contexte situationnel, le scénario social ou le rituel dans lequel on se trouve, ces représentations changent également sous l’éclairage de nos connaissances ou manque de connaissances (ou fausses connaissances) associées un objet. John Berger dans son étude de l’art et les représentations associés avec l’Art , « Ways of Seeing » (Berger, 1972) démontre ceci de façon élégante en demandant à des personnes d’interpréter le tableau d’un champ de blé de Van Gogh . Ensuite, en tournant la page, il nous informe que celui-ci fut le dernier tableau que le peintre a exécuté avant sa mort. Notre regard peut relever alors spontanément, des signes d’angoisse et d’instabilité mentale dans ce tableau que nous n’avions pas remarqué quand nous ignorions cette information tragique. De façon semblable la recherche sur l’effet Pygmalion ainsi que d’autres recherches démontrent que les contextes sociocognitifs peuvent facilement avoir un impact sur les personnes en tant qu’objets de nos représentations. (Monteil, 1993). Ces exemples soulignent le fait que dans l’analyse des interactions humaines et culturelles, il faut procéder avec précaution et éviter de tirer des conclusions trop hâtives à partir d’observations superficielles fondées uniquement sur le comptage d’indicateurs. La recherche dans ce domaine devrait notamment essayer de comprendre les contributions respectives des différents facteurs susceptibles d’influencer le comportement et les choix des acteurs. Dans une recherche sur le « co-sleeping » des enfants avec leurs parents et les questions morales et éducatives que cette pratique pourrait poser, Shweder, (2003) démontre que le simple comptage et l’observation de données matérielles ne suffisent pas pour comprendre la culture car nos interprétations seraient erronées si l’intentionnalité des personnes dans une telle situation n’était pas prise en compte. Si un objet quelconque a un sens différent pour des sujets différents sur un plan individuel, il est également vrai que l’absence du même objet a aussi des sens différents, de plus le même objet peut avoir des ef fets différents sur des sujets différents à des moments différents. Tout ceci est bien connu mais sans doute souvent oublié et reste au fond obscur ! Considérons les cas où un objet est absent, (cette absence de notre nouvel objet, peut être sim plement une non présence), il peut également s’agir d’un refus, d’un oubli ou bien d’une erreur attribuable à l’agent, (évidemment le même phénomène peut être vu du côté de la présence car une présence peut être simplement une non absence ou bi en une implication, voire un oubli ou une erreur.) Si cette situation pose des problèmes sur le plan individuel, les mêmes difficultés sont envisageables sur le plan co llectif et nous trouvons de nombreux exemples dans les domaines sociaux. Citons un exemple, celui de Largeault-Fagot, (2002) : l’assurance maladie universelle dans la plupart des pays européens est considérée comme l’essence de la justice sociale ; s’il est facile de voir un Français dénoncer cette absence comme une erreur grave, par contre, pour beaucoup d’Américains une telle hégémonie de l’Etatsur l’individu est considérée comme irrecevable. Nous devrions faire très attention à ces critères et au sens associé à leur présence ou leur absence quand nous construisons des indicateurs pour rendre visible ou faire émerger la culture, car la culture ou les effets de la culture ne deviennent visibles qu’à partir d’interactions et le repérage des différences issues de ces interactions par des observateurs humains. Nous sommes les indicateurs de l’existence de la culture, ou plutôt les indicateurs de l’existence de la différence entre les cultures. Or, si pour le microbiologiste, l’existence des microbes ne se pose pas car c’est un fait établi, par contre l’existence de la culture et sa définition est toujours à justifier car elle dépend de la participation et des réactions dites subjectives de l’être humain. Voilà où se tro uve une des lignes de fracture possible entre une approche de la santé (et de la médecine) « naturalistic » et notre approche anthropologique et plus phénoménologique de la culture et de la santé. On peut généralement caractériser l’absence de santé, donc la maladie, par référence à des entités microbiologiques, biochimiques ou histologiques, c’est-à-dire des faits naturels établis et reconnus. Il en va autrement quant à l’étude de la culture et des phénomènes d’interactions culturelles car la culture est une construction théorique de l’anthropologie, surtout en ces temps récents, où elle est très discutée et critiquée. (Fox & King, 2002) Pour lever toute ambiguïté, nous admettons volontiers que d’une part, la culture est une « co nstruction » 10 : s’il est possible d’isoler les bactéries ou les virus, il est difficilement imaginable d’isoler des « atomes culturels» 11, et que d’autre part, beaucoup de ces critiques semblent valides. De même, si des indices de présence de maladie nous pe rmettent d’évaluer et d’auto-évaluer notre état de santé, ou le plus souvent descarences de santé, il va de soi que la santé en tant que telle est difficilement objectivable, comme Canguilhem, (1996) nous l’enseigne en particulier. Nous pouvons accepter, dans une certaine mesure, que la culture et la santé ne sont pas objectivables et peuvent être considérées comme des constructions des chercheurs par contre il faut s’entendre sur la signification du terme « construction » car ce terme est souvent mal interprété et utilisé abusivement pour devenir l’équivalent de la négation de l’existence de la réalité. A un niveau simple, la culture est une construction puisqu’elle ne possède pas une forme physique évidente en dehors de ses manifestations matérielles, mais ce constat ne dit pas que la réalité, de ce que l’on décrit par le moyen du concept de la culture, est illusoire. Au contraire, nous maintenons que la culture, en tant qu’environnement intentionnel, est réelle puisqu’ele exerce une influence sur notre identité, notre être et notre vie pour créer les conditions pour la santé et pour la maladie dans notre corps et cette influence variera entre cultures selon les circonstances. Tout au long de cet écrit, nous tenterons d’une part, de démontrer la justesse de cette idée et d’autre part, nous examinerons comment la rencontre interculturelle et sa mise en scène particulière de la réalité nous aident à comprendre jusqu’à quel point notre vie et notre façon de voir et d’être au monde sont formés par notre participation à la culture.
L’épreuve de l’interculturalité
Ainsi nous proposons d’exploiter ce phénomène d’interculturalité dans un sens large, comme un outil ou plutôt un terrain d’essai, ou dans les termes de Latour, (1989) « d’épreuve », pour bâtir un modèle éclairant à la fois ce qu’est la culture et les interactions interculturelles mais également pour explorer les mises en scène de la santé publique et les domaines de la santé, de la maladie et du handicap. Nous faisons le pari méthodologique et conceptuel de considérer que c’est justement l’interaction qui révèle voire produit des cultures. Dans tous les cas il est évident que c’est l’homme ou plutôt ses réactions émotionnelles et cognitives qui fonctionnent comme indicateurs de l’existence de différences culturelles. En effet, l’étude de la culture implique forcément le sujet et sa subjectivité en aval et en amont. L’indicateur des phénomènes culturels approprié est l’homme lui-même et souvent un « homme-idéal » fondé sur notre propr e expérience humaine de la culture et des interactions dans ce domaine. Néanmoins, nous sommes très conscients du fait que la démarche scientifique est souvent jugée en fonction de sa capacité à éliminer la subjectivité et il nous semble que c’est en voulant prendre en compte le sens pour le sujet lui-même qu e l’anthropologie et la psychologie culturelle ainsi que certaines sections de notre travail se démarquent d’autres sciences. Ce fait, pour nous, est indissociable d’une science de l’homme fondée sur le sens et nous aurions tort de tenter d’éliminer cet aspect interprétatif car sans l’acceptation de ces attachements humains, le sens de notre objet s’évanouirait ou deviendrait trivial à l’extrême. Cette démarche nous rapproche d’une démarche « phénoménologique » inspirée d’auteurs tels que Schutz ou Strauss. Goldstein, (1968), en faisant référence à une réflexion de Schutz sur l’étude des phénomènes socioculturels (« the phemonological approach et « the naturalistic approach), considère que « …le but de l’approche phénoménologique de l’étude du comportement social est de rendre explicite ce qui est implicite dans l’action sociale des membres d’une communauté donnée. Et que Schutz dans un sens a raison de voir ceci comme l’exploration du social du point de vue du sujet ou de l’acteur … » afin de « révéler ce qui précisément rend l’action de l’acteur intelligible ». (N.T.) (p.101) (Nous partageons ce point de vue tout en admettant avec Goldstein qu’une approche uniquement « phénoménologique » est incapable pour des raisons évidentes d’explorer tous les types de phénomènes socioculturels et en particulier « d’expliquer le développement d’un monde social particulier » (Goldstein, 1968)). Puisque dans nos « explorati ons culturelles » et dans notre conceptualisation de la culture, de l’interculturel et de la santé publique dans un sens large nous ferons référence à un modèle de l’être humain fondé sur l’idée du développement non seulement sur le plan social mais également sur le plan psychologique, psychophysiologique, voire biologique, nous accepterons d’explorer également d’autres approches plus « naturalistic » également utilisées dans le champ de la santé publique.
Mises en scène dans la médecine
En rapport avec la théorisation précédente et son ondementf épistémologique nous proposons d’aborder notre champ par référence à l’idée que la médecine et la santé publique peuvent être traitées comme un phénomène socioculturel. Nous avancerons plus spécifiquement à l’instar de Annemarie Mol (Mol, 2002) et d’autres travaux associés à la théorie des acteurs-réseaux qu’au fond la maladie et la santé, le self et la culture, peuvent être « mis en scène » ou en anglais performed or enacted » de façon différente. Fond amentale à notre approche est l’idée que l’expérience humaine et les domaines du savoir et de la pratique dans lesquels est insérée cette expérience façonnent également sujets et objets. En ce qui concerne la médecine, Mol (2002) nous invite dans la préface de son ouvrage the body multiple : ontology in medical practice » à explorer « les façons par lesquelles la médecine s’accorde, interagit ou forme ses objets dans ses pratiques
variées » Ainsi nous prenons dans cet écrit la position que dans le domaine de la santé, le domaine de la médecine et de la santé publique, il est judicieux et fructueux de parler de réalités multiples et de mise en scène de la réalité. Ainsi selon Mol (1999), « reality is done and enacted rat her than observed. »« la réalité est « mise en scène » plutôt qu’observée. » (N.T.)
Ce positionnement épistémologique accepte l’idée que nos outils d’observation, y compris nos théories sous-jacentes à ces observations, construisent les réalités avec lesquelles nous avons affaire. Ainsi l’expression, la mise en scène (enactment ou performance), renvoie à une idée que selon les définitions utilisées, selon la question que l’on (se) pose, selon les outils disponibles, selon les apports théoriques sous-jacents à l’interprétation des observations ou des résultats, la réalité serait construite de façon différente. Cecis’applique aussi aux démarches de prévention, de traitement ou de non traitement, et aux finalités des actions entreprises. Au départ nous considérons que la réalité, selon une épistémologie constructiviste, ne peut être cernée indépendamment des sujets observateurs et des outils mis en œuvre pour effectuer une telle ob servation. De plus l’idée de « mise en scène » ne concerne pas simplement les ré sultats, mais doit être considérée comme un processus susceptible d’évoluerdans le temps.
Mises en scène dans le domaine de la santé occidentale
Or si nous adoptons une telle approche ce n’est pas simplement pour des raisons philosophiques mais parce que, selon notre expérience personnelle, académique et professionnelle, il est difficile d’accepter une épistémologie qui prétend que les contextes culturels de nos observations n’influent pas sur les objets de notre observation, en d’autres termes que les mises en scène de la réalité n’existent pas. Dans le domaine de la santé, par exemple, il existe trop de cas qui suggèrent fortement que la culture et la langue (même s’il es t difficile, voire absurde, de maintenir une position déterministe en argumentant pour une position relativiste forte où selon l’hypothèse de Sapir Whorf la langue forme la pensée totalement), structurent la pensée et favorisent des façons de voir. Ainsi l’étude bien connue de Lynn Payer « Medicine and culture » (Payer, 1996) présente un ensemble considérable de données suggérant que dans des situations médicales similaires, des formes différentes de traitement sont prodiguées selon les pays ; que certaines situations médicales semblent ne concerner que certaines situations culturelles et qu’en général plusieurs diagnostics et décisions relatifs à des traitements sont influencés par des facteurs culturels. Ainsi le type de mastectomie, proposé aux femmes, varie fortement selon le degré de la prise en compte, de la culture, de l’efficacité (USA) ou plutôt d’une esthétique (France). De la même manière, dans le prolongement des observati ons précitées de Lynn Payer, des différences significatives existent entre la France et la Grande-Bretagne dans le diagnostic et la conceptualisation de la schizophrénie (Van Os et al., 1996). Dans le domaine des maladies infectieuses, de récentes recherches menées par Steffen, (2001) sur les modalités de gestion de l’épidémie du SIDA par différents pays européens montrent que les traditions religieuses (leurs effets indirects) ont pu avoir eu un effet sur la gravité de l’épidémie. Ainsi, les pays étudiés, à forte tradition catholique comme le Portugal, l’Espagne, la Suisse, la France et l’Italie, connaissent généralement en cequi concerne les infections par VIH, une prévalence et une proportion de décès, par rapport à la population générale, supérieure à celle des pays traditionnellement protestants. Se référant à Weber, elle suggère que de telles différences peuvent être expliquées par l’action de la culture sur les politiques publiques par le biais de la maîtrise de la sexualité, de la limite entre les sphères publiques et privées ainsi que par les effets de différenciation entre une éthique de responsabilitéet une éthique de conviction. De façon semblable, les recherches sur les représentations sociales dans le domaine de la santé et de la maladie effectuées par Mattes (1992), suggèrent que bien qu’il y ait un certain nombre de similitudes entre les Allemands et les Britanniques ils n’en mettent pas moins l’accent sur des facteurs différents de causalité quand ils parlent de problèmes de santé.Ainsi, tandis que les Allemands ont tendance à souligner le rôle des déséquilibrespsychologiques, des conflits, du stress et de l’obligation d’être performant, les Br itanniques, quant à eux, parlent du hasard (du destin ?), des bactéries, des virus, de l’alcool, des problèmes financiers et des conditions de travail. Dans les deux domaines connexes de la protection de l’enfance (Freund et al., 1994) et du handicap (Armstrong, Armstrong, & Barton, 2000; Jenkins, 1998) ; (Sherlaw, 2001), des études interculturelles laissent penser qu’il y a entre les pays des différences significatives en matière de politiques et de pratiques. Et comme nous allons le voir dans le domaine des médicaments, produits supposés universels, il existe des différences compatibles avec l’idée de l’influence de la culture sur les pratiques (Sherlaw, 2003).