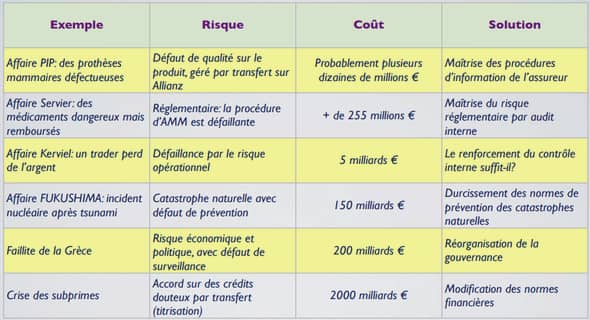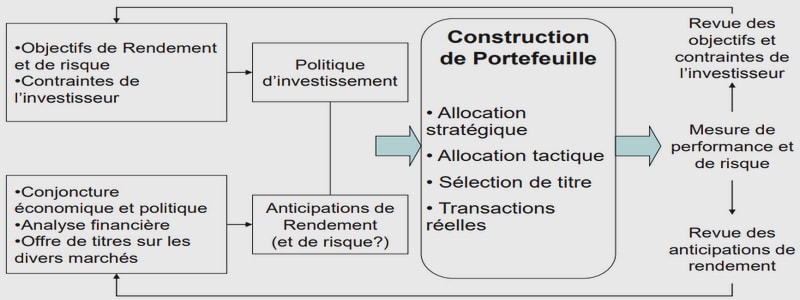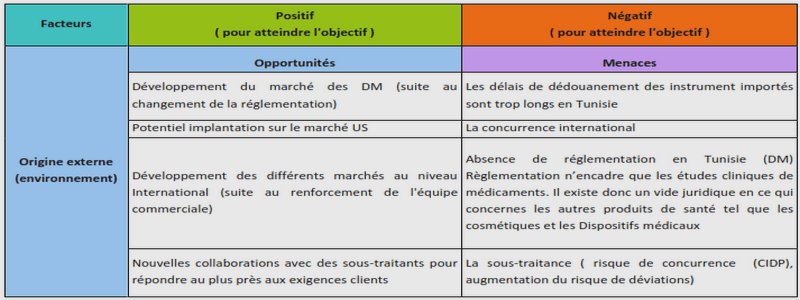Théorie et méthode
La bipolarité entre les anciens pays colonisés et les colonisateurs forme la base de la théorie postcoloniale. Dans son livre Orientalism (1978), Edward Saïd a montré que l’Occident a créé, pendant la période de la colonisation, une représentation de l’Orient fondée sur l’idée de la supériorité de l’Europe. Par contraste, les pays colonisés étaient perçus comme inférieurs. Ce système d’idées a laissé des traces chez les habitants des anciens pays colonisés, puisqu’il a été difficile pour eux de continuer à s’identifier à une culture que les anciens colonisateurs estimaient être inférieure. Aimé Césaire s’est opposé cet état de fait. Avec d’autres intellectuels noirs, comme Léopold Sédar Senghor (devenu plus tard président du Sénégal), il a lancé à Paris, dans les années 1930, le mouvement de la négritude dont le but était de rendre aux Noirs leur dignité en associant des valeurs positives au fait d’être Africain (Loomba, 1998). Frantz Fanon s’est aussi opposé à la systématisation du racisme due à la colonisation. Dans Peau noire, masques blancs, il montre que la colonisation a créé un sentiment d’infériorité et de frustration chez les peuples colonisés (Fanon, 1971). Les Noirs aimeraient jouir des mêmes privilèges que les Blancs mais cela leur est impossible à cause de la couleur de leur peau et du système de valeurs mis en place par les Blancs. Saïd, Fanon et Césaire montrent tous les trois qu’il existe une forte opposition entre les pays colonisés et colonisateurs. Pour Fanon et Césaire, cette dichotomie peut même être un moyen de résistance, car elle permet de dénoncer les agissements des anciens colonisateurs.
Le nationalisme des colonies devenues indépendantes peut également être un moyen de résistance anticoloniale. Lors de la conférence de Berlin en 1884, les colonisateurs européens se sont partagé l’Afrique, sans informer ou consulter les peuples africains. Les frontières des pays africains actuels y ont été définies arbitrairement par l’Europe. Il est donc délicat de parler de nationalisme pour beaucoup de pays africains qui se sentent peut-être parfois plus près de la notion de communauté ou de tribu que de celle de pays. Néanmoins, la notion de nation peut unir des communautés très différentes autour d’un projet commun et ainsi remettre en question la suprématie de l’Occident (Loomba, 1998). Selon Chatterjee (1993), le plus grand projet du nationalisme est de trouver une voie originale qui diffère du nationalisme occidental. La vraie nature d’une nation ne réside pas forcément dans une justification politique mais plutôt dans l’idée d’une communauté liée par des valeurs communes.
Cependant, la bipolarité entre pays n’est pas la seule approche possible. Homi Bhabha, par exemple, a voulu mettre en question l’opposition entre colonisateurs et colonisés en créant la notion d’hybridité, qu’il définit comme une identité nouvelle, une identité qui crée un troisième espace à l’interstice entre différentes cultures (Eriksson, 1999). Cette nouvelle identité peut, pour Bhabha, être une force positive et une possibilité de redéfinir les rapports de force inégaux mis en place par le processus de la colonisation. Lorsque, par exemple, certains habitants des pays colonisés imitent les Blancs, miment les Blancs, pour s’approprier les valeurs primées par la société occidentale, ils remettent en cause la notion même de différence entre Noirs et Blancs.
Les différents mécanismes d’identification qui se mettent en place lors de la rencontre entre différentes cultures ne sont jamais simples et à sens unique. Mary Louise Pratt s’est ainsi intéressée à la notion de transculturation qui est l’incessant et l’inévitable processus d’appropriation et de négociation qui se met en place entre deux cultures quand elles sont mises en contact (Pratt, 1992). Au départ, le terme transculturation a été utilisé dans le cadre de l’ethnographie pour montrer comment des peuples marginalisés se sont servis de l’information transmise par la métropole. Le point de vue bascule et devient celui des peuples colonisés. Pratt souligne que les rencontres entre deux cultures différentes sont le plus souvent soumises à des rapports de force inégaux. L’interaction entre deux cultures se fait dans un espace qu’elle appelle zone de contact. Nous nous approchons ici de l’idée d’espace qui nous intéresse particulièrement dans ce mémoire.
En somme, il y a dans la théorie postcoloniale deux tendances qui s’opposent : d’un côté, d’aucuns, comme Césaire et Fanon, sentent la nécessité d’entretenir une opposition binaire entre l’Occident et les anciens pays colonisés afin de résister efficacement à la suprématie occidentale, de l’autre, des auteurs comme Pratt et Bhabha estiment qu’il est impossible d’établir des séparations aussi nettes et que la création d’une nouvelle culture, issue de la rencontre entre deux cultures différentes, est en elle-même capable de subvertir les relations de pouvoir asymétriques mises en place par la colonisation. C’est le but de ce mémoire d’étudier les relations de pouvoir et les rencontres entre l’île de Niodor et la France de plus près.
Le Ventre de l’Atlantique peut sembler un choix surprenant pour étudier les rapports entre la France et le Sénégal, puisque l’île de Niodor se trouve au milieu de l’Atlantique, très loin de la France. Or, c’est justement cette distance qui est intéressante : comment la France peut-elle toujours être omniprésente dans l’esprit des insulaires alors qu’elle se trouve si loin géographiquement ? Une des richesses du roman est de superposer les perspectives des exilés sénégalais en France aux perspectives des insulaires restés au pays et mêmes à celles des exilés revenus au pays. Ces différentes perspectives donnent une image nuancée des interactions entre les deux pays. Le fait que Salie, la narratrice, est une femme ajoute une dimension supplémentaire, car en tant que femme, elle développe une position d’observation plutôt que de pouvoir.
Etant donné que Le Ventre de l’Atlantique est un roman relativement récent, il m’a été difficile de trouver des études antérieures significatives à son sujet. Je me baserai donc principalement sur la théorie postcoloniale pour conduire cette étude. La méthode employée sera une lecture détaillée du roman pour comprendre comment l’auteur contraste les différents espaces entre eux. Des exemples tirés du livre illustreront l’analyse.
La première partie de l’analyse définira le centre et la périphérie dans le roman. La deuxième partie étudiera les différentes zones de contact entre la France et l’île de Niodor. Enfin, une troisième et dernière partie montrera comment le roman met en question la notion d’opposition binaire.
Centre et périphérie
L’on peut voir dans le roman les traces laissées par la colonisation, ces traces dénoncées par Saïd. En effet, la France est un point de référence omniprésent et elle est définie comme un paradis par la plupart des habitants de Niodor :
Au paradis on ne peine pas, on ne tombe pas malade, on ne se pose pas de questions : on se contente de vivre, on a les moyens de s’offrir tout ce que l’on désire, y compris le luxe du temps et cela rend forcément disponible. Voilà comment Madické imaginait ma vie en France. (Diome, 2003, p.50)
Rien ne semble difficile en France et la vie de ceux qui y habitent est idéalisée. Selon les habitants de Niodor, en France, tout le monde est riche et ne manque de rien. La richesse des Français est un thème récurrent. La France est associée à la richesse matérielle, celle qui impressionne les voisins : « Ici, la friperie de Barbès vous donne un air d’importance, et ça, ça n’a pas de prix » (Diome, 2003, p.35). Tout ce qui vient de France constitue un objet d’envie, même ce qui en France serait considéré comme de la pacotille. Par opposition, l’île de Niodor semble pauvre même si elle est autosuffisante. En effet, l’île dispose d’une large nappe phréatique et les insulaires n’attendent pas non plus « quelques kilos de riz français » pour subsister (p.58).
La France est présentée comme un paradis ou un Eldorado: « la France, l’Eldorado, représentait aussi la plus lointaine destination de toutes les escapades et figurait une sorte de lieu mythique de la perdition » (p.155). C’est un endroit certes magique, rempli d’or, mais en même temps si lointain que l’on ne sait pas très bien ce qui s’y passe. Le centre du pouvoir se trouve donc en France, un endroit merveilleux, mythique mais un peu dangereux. C’est par conséquent aux hommes qu’il incombe d’y aller tenter leur chance, tandis que les femmes restent au foyer, Salie étant une exception. Il n’est pas rare que l’homme parte alors que sa femme reste en Afrique. Il se crée alors un nouveau lien de dépendance avec la France: la femme se trouve doublement à la périphérie car elle reste à Niodor en attendant que le mari envoie de l’argent. Il y a dans le roman l’exemple d’une femme qui attend que son mari la fasse venir en France pour que ses enfants, comme ceux de la première épouse, puissent dire : « je suis né en Frââânce ! » (p.185). Au bout de deux ans, elle comprend que cela n’arrivera jamais, car il n’a pas l’intention d’honorer sa promesse. Elle est alors obligée de s’humilier en allant réclamer les affaires dont elle s’était débarrassée en espérant partir elle aussi. Beaucoup de personnes fondent ainsi leur vie sur l’attente d’une aide financière venue de France.
Une conséquence de l’idéalisation de la France, issue de la colonisation, est ainsi la déstabilisation de l’économie locale : « L’île regorge de vieillards […] et de femmes d’émigrés encerclées par une marmaille qui consomme à crédit sur la foi d’un hypothétique mandat » (p.41). Césaire a accusé les pays colonisateurs d’avoir détruit les économies des pays colonisés, des économies adaptées aux conditions locales, pour leur substituer une économie de dépendance vis-à-vis du colonisateur (Césaire, 1955). La France est le pays d’où vient l’argent, et devient par conséquent le centre du pouvoir. De même, Fanon montre déjà dans l’introduction de Peau noire, masques blancs que l’exploitation économique menée par les colonisateurs est l’une des causes du sentiment d’infériorité qu’éprouvent les peuples colonisés (Fanon, 1971). Même si les anciennes colonies sont devenues indépendantes, les inégalités économiques subsistent. Ainsi le coût du téléphone, fixé par France Telecom, est hors de prix pour les Sénégalais résidant en France : « En concoctant la francophonie, Senghor aurait du se rappeler que le Français est plus riche que la plupart des francophones et négocier afin de nous éviter ce racket sur la communication » (Diome, 2003, p.43). Salie est dépendante du tarif de France Télécom et doit payer le prix fort pour garder le contact avec son demi-frère.
Il est à noter que l’île de Niodor se trouve très loin de la France mais aussi loin des côtes du Sénégal, ce qui souligne encore plus la distance avec la France et les distorsions entre la réalité et les idées reçues. Selon la narratrice, les habitants de Niodor « auraient pu […] ériger leur mini-république au sein de la République sénégalaise, et le gouvernement ne se serait rendu compte de rien avant de nombreuses années […]. D’ailleurs, on les oublie pour tout » (p.58-59). L’île de Niodor est loin de tout et se trouve donc non seulement à la périphérie de la France mais aussi du Sénégal. Le sort de l’instituteur Ndétare confirme l’isolation de Niodor, puisque le gouvernement sénégalais, considérant Ndétare comme un agitateur marxiste dangereux, l’a placé sur l’île « aux confins du pays » pour l’empêcher de nuire (p.73).
On pourrait penser que le centre pour les habitants de Niodor serait la terre ferme et les villes importantes du Sénégal, comme Dakar, Ndakarou ou Touba, mais ils semblent mieux connaître la France que le Sénégal. Malgré une vie difficile passée en France, l’homme de Barbès » chante les louanges de Paris à son retour au pays pour ne pas trahir ses propres faiblesses et sa vie difficile à Paris. Il avoue : « C’est marrant, je connais Paris, alors que je ne connais même pas Touba. Des Parisiens m’ont dit que la mosquée de Touba est l’une des plus belles d’Afrique » (p.97). Quoique musulman, l’homme de Barbès connaît mieux Notre Dame de Paris que la mosquée de Touba.
Il est donc tout naturel que les jeunes garçons de Niodor, gavés de ces images fantastiques de la France, rêvent d’y aller pour devenir footballeurs. Par le biais de la télévision, ils découvrent tous les grands clubs de football occidentaux mais ce n’est que la France qui attire leur attention :
Après la colonisation historiquement reconnue, règne maintenant une sorte de colonisation mentale les jeunes joueurs vénéraient et vénèrent encore la France. A leurs yeux, tout ce qui est enviable vient de France.
Tenez, par exemple, la seule télévision qui leur permet de voir les matchs, elle vient de France. Son propriétaire, devenu un notable, a vécu en France. L’instituteur, très savant, a fait une partie de ses études en France. Tous ceux qui occupent des postes importants au pays ont étudié en France. (Diome, 2003, p.60)