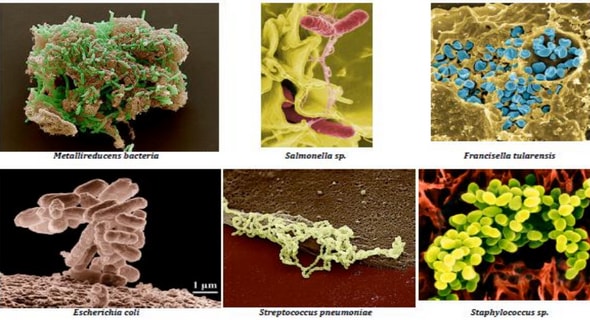Sources et effets potentiels sur la santé
Les COSVs regroupent un grand nombre de composés chimiques utilisés notamment comme substances actives ou additifs dans les matériaux de construction et dans de nombreux produits de consommation – tels que les plastifiants, les peintures, les adhésifs, les produits de nettoyage, les désinfectants, les composants électroniques, les produits cosmétiques (Figure 1). Ces composés sont ubiquistes dans les environnements intérieurs, et donc fréquemment détectés dans les poussières sédimentées ou dans le compartiment atmosphérique (Blanchard et al. 2014b).
Depuis une décennie, l’exposition de la population aux COSVs associée à l’environnement intérieur fait l’objet d’un intérêt croissant de la part de la communauté scientifique, tant pour l’identification d’effets sur la santé (Inserm, 2011; UE DG Environnement 2002), que pour la réduction des risques identifiés (US-EPA, 2009). Du fait notamment d’une pollution provenant d’une multitude de sources, d’une ventilation parfois insuffisante et de la persistance de certains contaminants en lien avec une longue demi-vie et/ou un réservoir d’émission important, à l’inverse des composés organiques volatils (Rudel and Perovich 2009). En outre, plusieurs de ces composés sont considérés comme cancérigènes ou mutagènes et certains suspectés d’être des substances neurotoxiques, reprotoxiques et/ou perturbatrices endocriniennes (Fournier et al. 2014; Inserm, 2011; Rudel et al. 2003).
L’exposition aux COSVs dans l’environnement intérieur peut se produire par inhalation (phases gazeuse et particulaire des composés dans l’air ambiant), par ingestion de poussières déposées au sol et sur le mobilier (Wu et al. 2007), en particulier pour les jeunes enfants (Weschler 2009) mais également par contact cutané (Bekö et al. 2013; Weschler and Nazaroff 2012). En particulier, les phtalates, les pesticides, les retardateurs de flamme polybromés (RFBs), les polychlorobiphényles (PCBs), le bisphénol A (BPA), les muscs synthétiques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) ont été identifiés comme les principales classes chimiques de COSVs dans les environnements intérieurs (Hwang et al. 2008; Mercier et al. 2011; Rudel et al. 2003; Weschler and Nazaroff 2008; Xu and Zhang 2011). Par ailleurs, un travail de hiérarchisation des COSVs réalisé en 2009 par l’EHESP a permis de sélectionner plusieurs composés prioritaires sur la base à la fois de leur toxicité et leurs concentrations rapportées dans la littérature (Bonvallot et al. 2010). Parmi ces composés, seuls ceux analysables en chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CG/MS/MS) ont été retenus pour le projet ECOS-Habitat (Mercier et al. 2014).
Enfin, dans l’étude de l’exposition des COSVs, la voie alimentaire peut constituer une voie importante, toutefois, celle-ci n’a pas été abordée dans le cadre de ce travail.
Les phtalates
Les phtalates ou esters phtaliques sont le produit d’estérification d’un acide phtalique avec un ou plusieurs alcools. Ils sont caractérisés par une structure chimique incluant un cycle benzénique substitué en ortho par deux groupements carboxylates dont la taille des chaînes alkyles est variable.
Produits pour la première fois dans les années 1920, ils ont connu un essor très important dans les années 1950, lorsque le PVC (Chlorure de Polyvinyle) est apparu. En effet, les phtalates sont très majoritairement utilisés en tant que plastifiants pour rendre le PVC souple et flexible ; les autres utilisations concernent les applications non PVC. Ils sont également utilisés pour la composition d’autres polymères tels que l’acétate de polyvinyle, l’acétate de cellulose et le polyuréthane.
Les phtalates sont principalement destinés à un usage industriel. En 2005, la production européenne de phtalates était estimée à environ 1 million de tonnes, 900 000 tonnes étant utilisées pour plastifier le PVC. La production mondiale quant à elle a été estimée à plus de 3,5 millions de tonnes par an (Cadogan and Howick 1996; INRS, 2004). Pendant de nombreuses années le phtalate le plus couramment utilisé était le DEHP, mais en réponse à la restriction de l’utilisation de plusieurs produits en Europe (Directive 2005/84/CE, 2005; Directive 2007/19/CE, 2007; Directive 2007/47/CE, 2007), les phtalates à faible poids moléculaire tels que le DEHP, DBP, BBP ont été progressivement remplacés par des phtalates haut poids moléculaire comme le DINP, qui représente aujourd’hui plus de 80 % de tous les phtalates produits en Europe occidentale (ECPI, 2012).
Ainsi, les phtalates se trouvent incorporés à une grande variété de produits, comprenant les dalles de sol, les textiles enduits, les câbles électriques, les contenants alimentaires, les adhésifs, les mastics, les caoutchoucs, les rideaux de douche, les encres, les solvants, les céramiques, les détergents, les peintures, les vernis, les jouets d’enfants, les dispositifs médicaux tels que les tubes et poches de sang, les pesticides et les produits cosmétiques : parfums, déodorants, lotions après rasage, shampooings, aérosols pour cheveux, vernis à ongles (European Union, 2003; European Union, 2004; European Union, 2007; European Union, 2008). Leur proportion dans certains produits de consommation peut atteindre jusqu’à 50 % en poids. C’est par exemple le cas des sacs plastiques, des emballages alimentaires, des jouets pour le bain, des dispositifs médicaux et des contenants pour le stockage du sang.
Ces dernières années, la toxicité des phtalates a été étudiée dans le cadre du règlement européen 93/793/CEE; cinq d’entre eux ont été évalués sur le plan du risque pour la santé humaine et pour l’environnement. En raison de leurs effets sur la reproduction, comprenant les effets sur la fertilité et ceux sur le développement du fœtus et du nouveau-né, les phtalates ont été classés comme substances dangereuses pour l’homme. Il faut préciser que le niveau de toxicité des phtalates varie selon le type de composé.
Face aux interrogations sur la question de la fertilité et des perturbateurs endocriniens, l’Inserm a été saisi en 2008 en vue d’analyser les données disponibles sur les effets sur la reproduction de certaines substances largement représentées dans les produits de grande consommation, dont les phtalates. Un rapport d’expertise collective intitulé « reproduction en environnement » a été publié en 2011 à l’issue de ces travaux (Inserm, 2011). Tant chez l’animal que chez l’homme, l’exposition aux phtalates semble avoir pour conséquences des altérations de certains paramètres de la fonction de reproduction et ce particulièrement si cette exposition se situe à des périodes sensibles comme la vie intra-utérine et la période néonatale. Chez l’homme, même si les études ne sont pas nombreuses, les phtalates ont été associés à des effets sur la reproduction comprenant la diminution de la qualité du sperme et l’altération du développement de l’appareil génital mâle (Dodson et al. 2012; Heudorf et al. 2007; NTP-CERHR, 2006). Chez l’animal en revanche, les études sont nombreuses et permettent d’en savoir plus sur le mode d’action et les cibles. Chez le mâle, le DEHP, le DBP, le DiBP, le DINP et le BBP induisent par exemple une diminution de la production de testostérone (ATSDR, 2002; Borch et al. 2004; Borch et al. 2006). Chez la femelle, le DEHP agit au niveau des follicules ovariens (ATSDR, 2002). Enfin, le DEHP, le DiBP et le BBP jouent également un rôle dans les effets embryotoxique, foetotoxique et/ou tératogène (Ema et al. 1998; Saillenfait et al. 2006).
Par ailleurs certains phtalates, comme le DEHP, peuvent avoir des effets au niveau du développement du système nerveux en conduisant à l’apoptose des cellules nerveuses (ATSDR, 2002; Tully et al. 2000). Des effets sur le système immunitaire sont également rapportés avec notamment le développement d’allergies et d’asthme (Bornehag and Nanberg 2010; Hsu et al. 2012; Kimber and Dearman 2010; Kolarik et al. 2008; Larsen et al. 2002; Larsen et al. 2007; North et al. 2014).
Des interdictions et restrictions d’usage ont été promulguées par la Commission Européenne. En 1999, l’UE a interdit provisoirement l’utilisation de six phtalates (DEHP, DBP, BBP, DIDP, DINP, DNOP) dans les jouets et articles de puériculture susceptibles d’être portés la bouche par des enfants de moins de 3 ans. Cette interdiction a été ajoutée en 2005 dans la directive 76/769/CE de façon à la rendre permanente.
La directive cosmétique 76/768/CEE et ses amendements interdit l’utilisation de plusieurs phtalates dans les cosmétiques (DEHP, DBP, BBP, DiPP, DnPP, DMEP). Selon la FIPAR (Fédération des Industries de la Parfumerie), le phtalate de diéthyle (DEP) est le seul phtalate utilisé par l’industrie cosmétique européenne.
Quatre phtalates (DEHP, DBP, BBP et DIBP) sont dans la liste de l’annexe XIV du règlement REACH. Le DMEP est maintenant aussi candidat à autorisation, selon la liste publiée par l’ECHA (Agence Européenne des Produits Chimiques). Cette autorisation est une mesure transitoire jusqu’à remplacement par un substitut économiquement et techniquement viable, elle peut être accordée par la Commission Européenne après présentation d’un dossier par les industriels concernés.
La directive 2007/19/CE interdit l’usage des phtalates DEHP et DBP pour les plastiques en contact avec des aliments gras (car il y a un risque d’extraction des phtalates du plastique et donc de contamination des aliments) et impose des limites de migration spécifique pour ces deux phtalates et le BBP dans toutes les autres applications alimentaires.
Par ailleurs, conformément à la réglementation européenne, interdisant les substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 (CMR1 et CMR2) dans les produits de construction et d’ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis, sont interdit à la vente depuis le 1er janvier 2010, tout produit de construction et de décoration émettant du DEHP et du DBP en quantité supérieure à 1 µg/m3.
Les retardateurs de flamme bromés
Les retardateurs de flamme bromés (RFBs) ont été largement utilisés dans différents matériaux afin de réduire le risque d’incendie, soit en fournissant une résistance accrue à l’allumage, soit en agissant pour ralentir la combustion et ainsi retarder la propagation des flammes (EFRA, 2013). Le terme « retardateurs de flamme » décrit une fonction et non une classe de composés chimiques. Un large choix de substances peut-être associé et une combinaison de plusieurs composés chimiques est généralement utilisée par les industriels. Cette diversité est nécessaire pour répondre à la variété des matériaux à protéger comme par exemple : les plastiques et les textiles qui possèdent des natures chimiques très variées et ont par conséquent un comportement au feu très différent. Les retardateurs de flamme sont indispensables pour assurer la sécurité dans une large gamme d’applications de matériaux :
• Composants d’équipements électriques ou électroniques (télévision, ordinateurs, appareils électroménagers, équipements automobile et aéronautique) ;
• Matériaux d’isolation pour le bâtiment (panneaux de mousse rigide ou de fibres polymères) ;
• Eléments d’ameublement : mousse souple pour matelas et coussins par exemple ;
• Textiles en fibres naturelles ou synthétiques : tissus d’ameublement, tapis…
Les RFBs se déclinent en 5 principales familles : les polybromobiphényles (PBBs), les polybromodiphényl éthers (PBDEs), les bromocyclodécanes (ex : l’hexabromocyclodécane ou HBCD), les dérivés de l’acide phtalique bromés (ex : le tétrabromobisphénol A ou TBBPA) et les phénols bromés. Sur le plan commercial, 3 familles sur 5 assurent la quasi-totalité des RFBs commercialisés : les PBDEs, l’HBCD et le TBBPA.
Du point de vue de leur structure chimique, les PBDEs sont des éthers aromatiques bicycliques. Actuellement, ils forment une famille de composés organiques regroupant 209 congénères théoriques, mais seule une partie de ces congénères est en réalité produite. Leur classification suit le système IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) et s’appuie sur le nombre et la position des atomes de brome dans le cycle. La nomenclature usuelle consiste à les désigner par un nombre donnant des informations sur le degré de bromation et sur la position des atomes de brome sur les cycles benzéniques (BDE-1, BDE-2, BDE-3, …, BDE-209). Une autre nomenclature se base sur le nombre d’atomes de brome portés par la molécule (mono-, di-, tri-, tétra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- et déca-bromodiphényl éther) et sur la position de ces atomes de brome sur les cycles benzéniques. Les différents congénères sont généralement utilisés dans trois mélanges commerciaux (Korytár et al. 2005) dont la dénomination réfère au type de congénère le plus représenté : Penta-BDE, Octa-BDE et Déca-BDE.
L’HBCD regroupe plusieurs isomères dont les majoritaires sont les formes α-, β- et γ-HBCD. Il occupe la troisième place au classement des RFBs les plus utilisés. Ces trois isomères sont retrouvés en mélange dans les produits commerciaux, avec une prédominance de la forme γ-HBCD, à 70-95 %.
Le TBBPA est un composé synthétisé par bromation du Bisphénol A. Contrairement aux PBDEs, le TBBPA est un composé utilisé en tant que réactif dans les matériaux, donc avec une liaison forte à ceux-ci.
Les études épidémiologiques sont encore trop peu nombreuses pour conclure à un rôle possible des PBDEs sur la santé reproductive de l’homme et la femme (Inserm, 2011). Dans les études animales, des effets reprotoxiques tels qu’une modification de la distance anogénitale chez le mâle, un retard pubertaire dans les deux sexes, une diminution de la production spermatique et des taux de testostérone, une modification de certains paramètres fonctionnels spermatiques ou encore une diminution du nombre de follicules ovariens ont été observés après une exposition gestationnelle ponctuelle ou une exposition pubertaire et adulte aux BDE-99 et 209 (Inserm, 2011). Chez la femelle, il a été montré que les BDE-47, 49 et 100 pouvaient stimuler la production de testostérone et d’androsténedione, que les BDE-99 et 100 pouvaient stimuler la production de progestérone et que les BDE-47 et 100 étaient capables de réduire l’aromatase (He et al. 2008; Karpeta et al. 2011).
Par ailleurs, les BDE-47 et 209, peuvent conduire à l’apoptose des neurones suite à l’induction d’un stress oxydant (Chen and Hale 2010; He et al. 2008). Le BDE-99 conduirait à des dysfonctionnements dans le développement neurocomportemental (Kuriyama et al. 2007).
Concernant le HBCD et le TBBPA il est à noter un manque de données tant en termes d’exposition, d’imprégnation, de métabolisme, de pharmacocinétique, que de lien avec certains paramètres cliniques (Inserm, 2011).
Durant ces dernières années, en raison de la mise en évidence ou de la suspicion de certains éléments préoccupants pour la santé humaine, l’UE a adopté une législation visant à réduire ou arrêter la vente et l’utilisation de certains RFBs.
La directive 2003/11/CE du 6 février 2003 a interdit la mise sur le marché et l’emploi des PentaBDE et OctaBDE dans des solutions à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. Par ailleurs, La directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques stipule que les États membres veillent à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées à l’annexe II, notamment les polyBDE, à une concentration supérieure à la concentration maximale tolérée en poids dans les matériaux homogènes de 0,1 %. Cette directive remplace la directive 2002/95/CE, dite « RoHS » portant sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Cette ancienne version avait, jusqu’en juin 2008, exempté le decaBDE des restrictions imposées aux autres polyBDE, et en avait fait une alternative intéressante au pentaBDE (INERIS, 2012).
Par ailleurs, l’HBCD a été inscrit à l’annexe XIV du règlement REACH en février 2011, conduisant notamment à son interdiction de mise sur le marché. L’HBCD a été ajouté également à la liste des polluants organiques persistants lors de la réunion des signataires de la Convention de Stockholm du 10 mai 2013. L’utilisation et la production du HBCD seront ainsi interdites après août 2015 dans l’ensemble de l’Union Européenne.
Depuis la mise en place de réglementations limitant l’utilisation des PBBs et des PBDEs, les industriels produisent de nouveaux retardateurs de flamme bromés (NRFBs) pour remplacer les composés interdits (Covaci et al. 2011). Les NRFBs sont représentés par un grand nombre de molécules différentes (DBDPE, BTBPE, TBB ou EHTBB, TBPH ou BEHTBP, TBBPA-DBPE, HCDBCO). Au total, une dizaine de nouvelles substances ont récemment été mises sur le marché, mais leur utilisation, leur volume de production, leur comportement dans l’environnement et leur impact potentiel sur la santé sont encore peu connus (Covaci et al. 2011). Ces restrictions sur l’utilisation des PBDEs ont également entraîné une utilisation accrue des alternatives chimiques ignifuges, tels que les composés organophosphorés. En particulier le tributylphosphate (TBP) qui est utilisé comme solvant pour les esters cellulosiques et comme plastifiant dans les résines de matière plastique et de vinyle. Une étude récente a étudiée la présence de TBP dans de nouveaux produits de consommation sur le marché japonais, comprenant les équipements électroniques, les rideaux, le papier peint et les matériaux de construction (Kajiwara et al. 2011). Le TBP était présent dans une large gamme de produits et les concentrations les plus élevées ont été mesurées dans les produits textiles.
Les polychlorobiphényles
Les PCBs sont des composés aromatiques chlorés d’origine anthropique découverts au 19ème siècle. Ils forment une famille de 209 composés ou congénères en fonction du positionnement et du degré de chloration. Compte tenu de leurs caractéristiques physico-chimiques, de leurs propriétés thermiques d’isolants électriques et d’ininflammabilité ils ont été largement utilisés dans l’industrie comme fluide caloporteur pour l’isolation électrique et le refroidissement des transformateurs, des condensateurs électriques, et en tant qu’additifs aux peintures, vernis, laques, encres, caoutchouc ou encore dans les plastiques. Ils ont ainsi connu un développement industriel considérable entre 1930 et 1980. Les PCBs ont été majoritairement commercialisés sous forme de mélange contenant jusqu’à 50-70 congénères différents, si bien que leurs propriétés physicochimiques ont été essentiellement étudiées pour des mixtures contenant plusieurs types de PCBs, plus connus sous l’appellation commerciale de « Pyralène » ou « Arochlor » (ex : mélange Arochlor de Monsanto). La production cumulée aux USA, en Europe de l’Ouest et au Japon est estimée à plus de 1 million de tonnes sur la période de 1930 à 1980. La production française, entre 1930 et 1984, a été estimée à 135 000 tonnes, ce qui représente environ 10 % de la production mondiale.
Les PCBs sont considérés comme un des 10 polluants organiques les plus persistants (POPs) par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). En raison de leur stabilité chimique, les PCBs sont effectivement des substances très peu biodégradables et lipophiles qui, après rejet dans l’environnement, peuvent s’accumuler dans la chaine alimentaire. En France, d’après les analyses faites en 2006-2007 chez 3 100 personnes dans le cadre du programme national nutrition santé (PNNS), le sang des français contient des concentrations un peu supérieures à celles rapportées dans la population allemande et 4 à 5 fois plus élevées que celles de la population américaine (InVS, 2011).
Divers effets néfastes ont été observés chez l’animal après une exposition chronique aux PCBs, notamment des effets sur la reproduction, d’immunotoxicité et de cancérogénicité (ATSDR, 2000). Ils ont été classés en tant que substances probablement cancérigènes pour l’homme (groupe 2A du CIRC) pour les cancers hépatobiliaires. Différentes études épidémiologiques suggèrent un lien entre l’exposition aux PCBs et des anomalies des hormones thyroïdiennes. Outre ces possibles effets cancérigènes, les effets chroniques des PCBs sont des dommages du foie, des effets sur la reproduction et la croissance. Une étude a montré qu’une exposition au PCB-118 induisait une augmentation de la distance anogénitale chez le mâle lors d’une exposition, in utero, à un moment précis de la gestation (Kuriyama and Chahoud 2004). Cette exposition induirait également une diminution du nombre de spermatozoïdes ainsi qu’une diminution de la production journalière de sperme. Ces effets pourraient potentiellement être retrouvés après une exposition au PCB-138 via son activité anti-androgénique (Bonefeld-Jorgensen et al. 2001) ou après une exposition au PCB-153 (Zhang et al. 2013). Par ailleurs selon la nature des PCBs, différents effets sur le système nerveux ont été rapportés. Pour les PCB-101 et 153, il a été observé une diminution du taux hypothalamique de dopamine (Khan et al. 2002; Yang et al. 2010). Pour une exposition au PCB-138 on observe également une altération du développement neural (Boix et al. 2010).
En raison de leur toxicité et de leur persistance dans l’environnement, l’utilisation des PCBs dans les applications ouvertes telles que les encres d’imprimerie et les adhésifs a été interdite en Europe en 1979. La vente et l’acquisition de PCBs ou d’appareils contenant des PCBs ainsi que la mise sur le marché de tels appareils neufs sont interdites en France depuis 1987. Aujourd’hui, les PCBs peuvent encore se retrouver dans l’environnement à la suite d’incinération des déchets urbains ou lors de fuites de transformateurs. Un plan d’élimination des PCBs a été mis en place dans le cadre du protocole de Stockholm, qui prévoit que tous les pays signataires s’engagent à ne plus produire, ni utiliser de PCBs d’ici 2025.
Les pesticides
Les pesticides regroupent plus d’un millier de substances actives ayant comme caractéristique principale de lutter contre des organismes considérés comme nuisibles (animaux, végétaux, champignons) et sont utilisés principalement en milieu agricole. En 2008 en France, environ 90 % des tonnages de pesticides vendus l’ont été pour des usages agricoles et 10 % pour des usages non agricoles : entretien des infrastructures routières et ferroviaires, des espaces verts, des trottoirs, jardinage, traitement des locaux… (OPECST 2010). Les pesticides regroupent plusieurs grandes familles de composés qui peuvent être classés en fonction de leur cible principale. Les trois grandes catégories sont : les herbicides, qui luttent contre les plantes adventices des cultures ; les fongicides, qui luttent contre les champignons pathogènes ; les insecticides, qui luttent contre les insectes nuisibles. Les pesticides peuvent également être classés par groupe chimique, selon la molécule principale utilisé. Parmi les plus importantes on trouve notamment les organochlorés, les organophosphorés, les carbamates, ainsi que les pyréthrinoïdes (Bouvier, 2006).