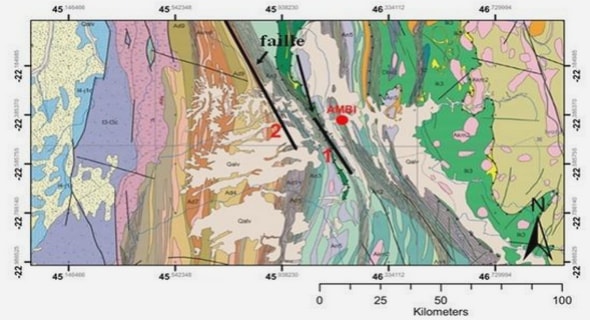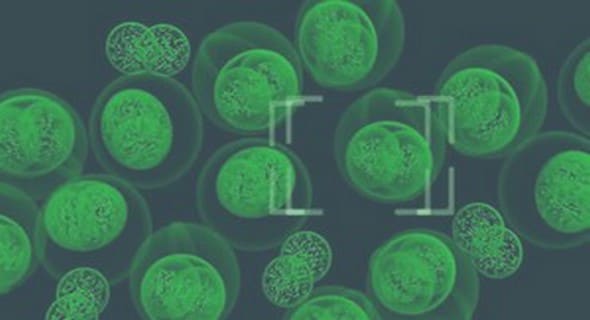Élaboration de N,S-acétals cycliques et leur transposition en 1,4-thiazines selon des processus en cascade
Bioisostère de la proline
Les deux études détaillées ci‐dessous permettent de comprendre comment l’utilisation de ce motif comme bioisostère de la proline permet le développement de molécules ayant des propriétés biologiques intéressantes.
Traitement du diabète de type 2
La dipeptyl peptidase–IV est une protéine qui est exprimée à la surface de la plupart des cellules mammifères et joue un rôle important dans le métabolisme du glucose. Elle est capable d’inactiver la production de glucon‐like‐peptide‐1 qui est une hormone gastro‐ intestinale sécrétée en réponse à l’ingestion d’un repas qui stimule la sécrétion d’insuline lorsque le taux de glycémie est trop élevé. Par conséquent, l’inhibition de cette protéine pourrait augmenter la sécrétion d’insuline après l’ingestion d’un repas seulement. Les inhibiteurs de cette enzyme pourraient avoir un potentiel antidiabétique exempt d’effets secondaires tels que l’hypoglycémie et l’épuisement des cellules β pancréatiques importants dans les traitements prescrits. Elle reconnait un large éventail de substrats peptides contenant la proline ou l’alanine. Par conséquent, l’activité inhibitrice de la DPP‐IV des composés 2‐cyanopyrrolidines a été explorée56,57 dont le nitrile sur la position 2 de la pyrolidine semble déterminant pour l’activité biologique. La triade catalytique de cette protéine est identifiée en 1993 par David et al.58 par analyse mutationnelle puis l’enchaînement Ser‐Asp‐His est confirmé par l’étude aux rayons X réalisés sur différents complexes protéine‐inhibiteur.59,60,61,62 Sur la base de ces travaux, il est donc suggéré que le groupement électrophile forme un adduit avec la sérine du site actif de l’enzyme et par conséquent l’activité est améliorée (Schéma 16).63 Schéma 15 : Remplacement des cyanopyrolidines par motif thiazolidines pour éviter la cyclisation intramoléculaire Le premier inhibiteur marquant NVP‐DPP728 contenant le motif 3‐pyrrolidinecarbonitrile, a été breveté en 1998‐1999 par Hughues et al. (Schéma 15). Des études RSA sont effectuées sur la partie à gauche (en bleu) a conduit au produit NVP‐DPP237 qui présente une activité, anti hyper‐glycémique très intéressante et administrable par voie orale.84 Afin de travailler sur un système contraint analogue de NVP‐DPP728, Sakashita et al. proposent de travailler sur la famille de molécules VII (Schéma 15) qui a présenté des activités intéressantes dues à l’importance des groupements nitrile et amine. L’instabilité de ces produits est expliquée par la cyclisation de ces deux fonctions (Schéma 15).65 Afin d’éviter cette cyclisation intramoléculaire, la modulation de la partie à droite a été envisagée mais les composés pyrrolidiniques obtenus ne contenant pas la fonction nitrile se sont avérés hélas moins actifs que les autres dérivés.66,67 Néanmoins, le motif thiazolidine a généré de meilleures activités que la pyrrolidine sans substituants. Ainsi, le remplacement de la 2‐cyanopyrrolidine par le cycle thiazolidine, a conduit à l’étude de nombreux dérivés dont la thiazolidine de type VIII (Schéma 15).68,69.70,71,72,73 Les résultats obtenus sont très satisfaisants, offrent une grande diversité moléculaire et soulignent enfin l’importance de ce motif dans le cas de l’inhibition du DPP‐IV pour le traitement du diabète de type 2.
Anti‐inflammatoires
On retrouve également ce concept dans le développement de composés anti‐ inflammatoires. En effet, le composé IX (Schéma 16) est un agoniste des récepteurs d’acides gras à chaîne courte FFA2 impliqués dans la régulation du métabolisme, l’appétit, l’accumulation de gras et des réponses inflammatoires. Schéma 16 : Agonistes potentiels des récepteurs d’acides gras à chaîne courte impliqués dans les processus inflammatoires L’utilisation de la thiazolidine comme bioisostère semble être une bonne stratégie offrant une nouvelle diversification possible et par conséquent des composés avec de meilleures activités biologiques.
Thiazolidines : squelette insertion de pharmacophore actif et support de diversité
Thiazolidine : un support
En raison du phénomène de résistance aux antibiotiques bien connu maintenant, il est très important de développer de nouvelles stratégies antibactériennes. Dans cette perspective, de nombreux travaux se sont focalisés sur l’inhibition de la thymidylate synthase X qui est une enzyme présente dans la plupart des bactéries et absentes chez l’homme et la plupart des organismes eucaryotes. Une librairie moléculaire de composés autour du motif thiazolidine‐4‐ carboxylate d’éthyle a été envisagée. La séquence employée permet d’introduire une grande diversité en peu de transformations (Schéma 17). Schéma 17 : Diversification : 3 familles de molécules potentiellement inhibitrices de la Thymidylate Synthase X L’amine secondaire et l’ester sont les deux points qui ont été utilisés comme source de fonctionnalisation et trois familles de produits ont ainsi émergées (Schéma 17). Une méthode par spectrométrie d’absorbance a été conçue pour permettre de mesurer l’activité de cet enzyme en présence des différents composés à tester.74 Ainsi, les différents composés sont évalués et quatre dérivés constitués du motif triazole et un du groupe XII se sont avérés prometteurs avec des IC50 très satisfaisantes.75 Parallèlement à ces travaux, il a été exploré (Önen‐Bayram, 2015) l’activité anticancéreuse des thiazolidines et intermédiaires de ces molécules (Schéma 17). Le seul composé qui s’est avéré être cytotoxique est le composé XIV (Schéma 17) dont le groupe phényle en C2 n’est pas indispensable à l’activité biologique mais cette position peut être utilisée afin d’améliorer les propriétés pharmacocinétiques des composés ou l’insertion d’un groupement fluorophore.76 Le nombre de produits étudiés par ces auteurs illustrent bien la diversité offerte par ce squelette. Grâce à ces quatre points de diversifications, ce motif peut également servir de support à l’insertion de pharmacophore bien établi pour une activité biologique précise. Le schéma 18 rassemble les exemples choisis pour illustrer ce propos. Schéma 18 : Insertion d’un groupement sur la thiazolidine responsable de l’activité générée..
Insertion de groupement pharmacophore responsable de l’activité générée
Insertion de l’adamantyle (Molécule XV)
La 11‐β‐hydrostéroïdes déshydrogénase de type 1 (11β‐HSD1) est une enzyme exprimée dans le foie, les tissus adipeux et le système nerveux central. Elle permet la conversion de la cortisone en cortisol, hormone qui peut dans certains cas occasionner une hausse de la glycémie. Des études réalisées sur les souris révèlent que l’inhibition de cet enzyme pourrait permettre la réduction de glycémie et de l’insulino‐résistance.77,78 Des inhibiteurs de cet enzyme semblent donc être une stratégie intéressante pour le traitement du diabète de type 2 (Schéma 18). Parmi les inhibiteurs proposés dans la littérature, le motif adamantyle semble être largement considéré. Pour cela, Kwon et al.79 proposent l’adamantyl thiazolidine‐2‐ carboxamide (XV) comme inhibiteur de cette enzyme. De nombreux groupements Boc, Benzoyle, urée, benzyle, et différents sulfonyle d’aryle ont été utilisés pour protéger l’amine du cycle thiazolidine afin de connaître l’influence de ce groupement sur l’activité obtenue et les meilleures activités in vitro sont obtenues avec les sulfonyl‐ aryles ainsi que les groupements fluorés et chlorés. Enfin des études plus approfondies ont permis de sélectionner le composé XV ayant une bonne activité in vitro, sélectif et stable métaboliquement.
Insertion d’une fonction Thiosemicarbazides (Molécule XVI)
En 2015, l’équipe de Savegno propose des composés thiazolidines comportant une fonction thiourée XVI et démontrent leurs propriétés anti‐oxydantes
Insertion d’un groupement nucléoside (Molécule XVII)
La modification des fragments d’acides nucléiques afin de proposer des composés antiviraux et antibactériens est un champ riche d’investigations.81 Dans ce contexte, des thiazolidines substituées en position C2 par des nucléosides ont été proposées (Nagaraj, 2006). Cinq produits sont testés sur quatorze pathogènes humains et le composé XVII s’est avéré être le plus actif (Schéma 18).
Insertion de l’isoquinoléine (Molécule XVIII)
Le groupement aminoquinoléine est largement reconnu pour son apport aux propriétés antipaludiques. L’insertion de ce dernier sur des dérivés de la thiazolidine a conduit au produit XVIII (Salomon, 2013). Plus largement, l’activité antipaludique contre une souche NF‐ 54 de Plasmodium falciparum in vitro et de la souche N‐67 de Plasmodium YOELII in vivo des nouvelles thiazolidines a été évaluée et deux composés de la famille de molécules XVIII ont montré une suppression significative de la parasitose lors de l’évaluation in vivo. De plus, d’après les résultats des tests in vitro, il semblerait que ces analogues forment un complexe fort avec l’hématine et inhibent la formation de la β‐hématine (composé obtenu par l’oxydation de l’hème). Ces tests in vitro ont permis une meilleure compréhension du mécanisme d’action conduisant à leurs activités antipaludiques.
Partie I‐ Synthèse bibliographique |