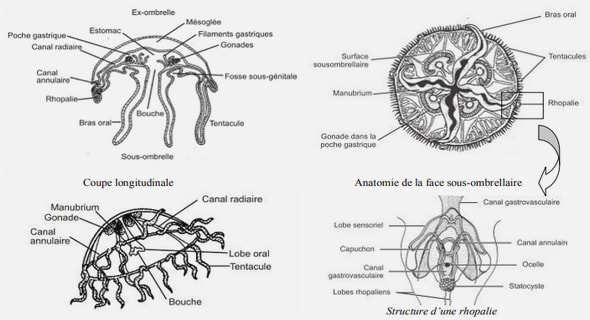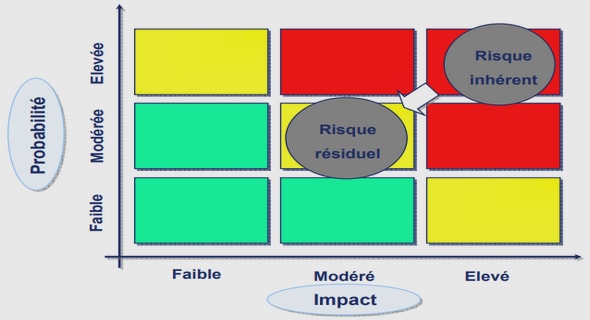La notion d’(in)visibilité du traducteur
L’acte de traduction soulève une question fondamentale, qui est de savoir dans quelle mesure le traducteur – qui en un sens est un trait d’union entre deux cultures, en somme un médiateur culturel et littéraire – est un acteur (in)visible lorsque l’on s’intéresse à la réception d’un texte traduit par le lectorat ? Lawrence Venuti nous donne une définition précise de ce qu’est la traduction. Translation is a process by which the chain of signifiers that constitutes the foreign text is replaced by a chain of signifiers in the translating language which the translator provides on the strength of an interpretation » (Venuti, 2008: 13). Cette définition met en lumière plusieurs aspects importants de la traduction qu’il est aisé d’oublier. Ce que l’on apprend, c’est que le traducteur propose et délivre une interprétation du texte étranger. Sathya Rao nous dit, quant à elle, que « la traduction a ceci d’original qu’elle offre un accès privilégié à l’étranger » (2004 : 13). Cependant, la traduction, dans son acception la plus traditionnelle, présente un étranger subjectif. Selon Venuti, l’acte de traduire peut aussi selon ses termes, s’accompagner d’une domestication du texte étranger (2008 : 14), c’est-à-dire une transposition des codes, des usages d’une culture étrangère à ceux ayant cours au sein de la culture cible, pour en faciliter l’accès. Il dénonce d’ailleurs cette propension tout occidentale d’avoir recours à cet ethnocentrisme littéraire. Cette idée de domestication, et par conséquent d’appropriation de l’Autre, souligne une autre problématique relative au statut, à la fois particulier et paradoxal du traducteur mais également à la notion d’invisibilité.
Traditionnellement, le traducteur est considéré comme un travailleur de l’ombre. Les marques de sa présence sont les plus ténues possible. La mise au second ou plutôt en arrière-plan de sa présence éclipse dans le même temps son travail. Cette éthique revendiquant l’invisibilité a donc des conséquences importantes. En effet, elle participe au peu de reconnaissance dont jouit le statut du traducteur, qui, répondant à « l’impératif dictant l’effacement des traces de la réénonciation » (López López-Gay, 2009 : 114), permet à l’auteur étranger de s’imposer en le supplantant. Cette apparente transparence du texte reste toutefois trompeuse. Car comme le suggère Venuti, la traduction se fait passer pour original (2008 : 1). C’est d’ailleurs en raison de cette illusion, la résultante de la stratégie traductive adoptée et de la volonté d’assurer une lisibilité fluide et aisée, que le traducteur se voit dans l’obligation d’inscrire son énonciation dans un cadre structuré par l’usage afin de pouvoir, comme le rappelle Venuti, maintenir un discours intelligible et syntaxiquement cohérent, de créer du sens. Cet aspect de la traduction amène à s’interroger sur le concept de fluency, étroitement lié, d’une part à la notion d’invisibilité du traducteur, et d’autre part à la réception critique de cette même traduction. Paradoxalement, plus le travail de retranscription du texte – en l’inscrivant dans un contexte historique et social, et en le faisant correspondre aux attentes inhérentes à l’habitus du lectorat – est conséquent, c’est-à-dire ne posant aucune difficulté particulière quant à la compréhension lors de la lecture, plus le traducteur se rend invisible et plus le texte produit semble authentique. Mais comme le rappelle López López-Gay, il n’en est rien, car « l’adoption 6 du critère de la lisibilité (fluency) revient le plus souvent à l’annexion des textes étrangers, à la quête du Même au prix de l’Autre » (2009 : 114). Cet état de fait, permet également de comprendre pourquoi la traduction peut être considérée comme duale. Elle fige et fixe les choix pris par le traducteur en faisant état d’une interprétation possible du texte originale, mais dans le même temps, n’a de cohérence que dans la relation qu’elle entretient avec le contexte culturel, social et historique dans lequel elle se fait jour (Venuti, 2008 : 14). Ceci sous-entend donc que le texte est irrémédiablement voué à être traduit à plusieurs reprises pour qu’il conserve la cohérence sémantique au regard d’un contexte qui lui aussi est amené à évoluer.
Pour lutter contre cette invisibilité impliquant en un sens, l’appropriation culturelle du texte original dans un souci d’agrément de lecture, on pourra rappeler que Venuti cite le travail de F. Schleiermacher proposant au traducteur de choisir entre deux approches opposées (Venuti, 2008 : 15). La première reposant sur une approche ethnocentrique, consiste à distordre le texte original pour le faire correspondre aux valeurs culturelles de la société à laquelle se destine la traduction. La seconde, ethnodeviant, consiste quant à elle, à bousculer la doxa la société réceptrice par la mise en relief des différences culturelles présentes dans le texte original, en permettant ainsi au lecteur d’avoir véritablement accès à l’Autre dans son particularisme. Dans la continuité de cette seconde approche, Venuti propose une réhabilitation du statut du traducteur en envisageant son travail sous un nouveau jour. Cette réhabilitation passe par un engagement comparable à une prise de position, un acte politique, puisque l’idée sous-tendant cette démarche est d’entrer en résistance contre l’hégémonie des valeurs dans la culture à laquelle s’adresse la traduction. C’est ce que Rao définie comme étant « une résistance menée au nom d’une conception intéressée du traduire (Rao, 2004 : 13). En suivant l’éthique de cette ligne de conduite, le traducteur reprend ces lettres de noblesse en se rendant visible, mais en remettant du même coup en cause le primat de l’auteur. C’est d’ailleurs dans ce dépassement de l’ordre jugé jusqu’à lors comme évident, dans la remise en question du statut de traducteur et de la conception faite de la traduction, que la question des théories du genre (gender) entrent en résonnance avec l’idée d’envisagée l’acte de traduire comme une action militante. De plus, si ce qu’avance Venuti est vrai, à savoir que la traduction fait état des valeurs d’une société, puisque modelée par celles-ci, alors on pourra observer le rapport au pouvoir et la hiérarchisation des genres.
Théories du gender et traduction
Si l’on adopte une approche historiographique du champ littéraire et par extension de la traduction, on se rend compte d’un clivage entre ces deux domaines. L’accès à l’éducation et donc l’écriture ont longtemps été l’apanage des hommes. La traduction cependant, considérée comme une tâche subalterne, en ce sens qu’elle n’est pas production mais plutôt reproduction de l’original, a de ce fait été confiée aux rares femmes instruites. Usant ainsi de ce seul accès au domaine des Lettres, les femmes, en mettant au point différentes stratégies, ont très tôt eu recours au détournement de ce medium pour en faire un outil d’expression publique (Simon, 1996 : 2). Cette conception genrée et duale du couple auteur/traducteur permet également d’expliquer le peu de cas que l’on a longtemps fait de la traduction et du lexique employé pour décrire ce domaine. On pensera par exemple aux affirmations de John Florio (Simon, 1996 : 1) ou plus récemment à celles de Bensoussan (Simon, 1996 : 8) qui mettent tous deux en évidence la vision à la fois genrée et dépréciative caractérisant la traduction et son artisan. Selon eux, la traduction et donc le traducteur sont intrinsèquement féminins. Par opposition, l’auteur et sa production originale seraient quant à eux associés au pôle masculin.
C’est à partir des années 1970-1980, coïncidant, ou faisant suite à la deuxième vague du féminisme comme le rappelle E. Söderberg (2010 : 78), qu’un groupe de traductrices québécoises commencent à théoriser une nouvelle conception de leur discipline en adoptant un angle d’approche jusqu’à lors négligé, et en élaborant de nouvelles stratégies de traductions. Comme nous l’avons vu dans la partie précédente traitant de l’invisibilité du traducteur, le texte traduit au même titre que l’original, sont tous deux représentatifs d’un contexte socio-culturel, politique, dont ils sont indissociables. Comme le suggère Oster, [L]a traduction (en tant que processus et en tant que produit final) est un terrain propice à l’analyse des rapports de force à l’œuvre dans le processus de traduction et dans l’évaluation et la réception du texte-cible, ainsi qu’aux tentatives de renversement du rapport de force qui s’établirait, serait perpétué ou renforcé par ce processus. (2018 : 3)
La traduction féministe se propose donc de mettre en place de nouvelles méthodes de travail permettant de se focaliser sur la langue et la sémantique tout en portant sur elles un œil critique, afin de se détacher du caractère misogyne et patriarcal que le langage conventionnel renferme (von Flotow, 1991 : 72). Cet examen approfondi du langage, permet dans le même temps, comme le dit Sherry Simon, de redéfinir la notion de « fidélité » de la traduction ou « transparency » selon les termes de Venuti. En outre, « For feminist translation, fidelity is to be directed toward neither the author nor the reader, but toward the writing project–a project in which both writer and translator participate » (Simon, 1996: 2).
De ce fait, cette approche à différentes conséquences visibles sur le texte traduit. Tout d’abord, en recourant au détournement, en préfaçant, annotant ou simplement par des ajouts, le ou la traductrice s’autorise à révéler sa présence, se rendre visible. Ceci vient donc marquer son implication directe dans le processus de transfert, mais aussi et surtout, la conscience que son rôle de médiation s’inscrit dans une démarche que l’on pourra qualifier de politique (von Flotow, 1991 : 75), en ce sens qu’elle se met au service d’un élan progressiste et du renouveau de la tradition littéraire et langagière (Simon, 1996 : 2). Comme on peut le remarquer, cette éthique de traduction et celle à laquelle aspire Lawrence Venuti sont étroitement liées, sinon semblables.
Une autre question que la traduction féministe aborde est en relation avec l’éthique de la démarche, est celle de l’attitude, ou plutôt de la position que le traducteur adopte vis-à-vis de l’interdépendance entre le texte traduit et l’original. Ce positionnement traite également de l’élément crucial qu’est la retraduction. Nous avons vu avec Venuti, deux types d’approches possibles. La première que l’on qualifiera d’ethnocentrique consiste à intervenir sur le texte pour augmenter sa « fluency » et sa « transparency ». C’est ce qu’Oster appelle quant à elle une traduction dite « d’acclimatation », « qui s’attache à faire connaître l’œuvre dans la culture-cible » (2018 : 5). On constate ici, que la préoccupation principale est d’estomper autant que faire se peut la particularité, la singularité qui font de l’œuvre son originalité. C’est pour cette raison que la seconde, une « foreignizing » approche, pour laquelle on pourra opter dans le cadre d’une retraduction ou tout simplement d’une traduction féministe, permettra « de véhiculer plus précisément une idée pouvant avoir été occultée par la première traduction » (Oster, 2018 : 5). Ainsi, on pourra parler en quelque sorte d’un engagement du traducteur à rester fidèle au texte en s’assurant de rendre au mieux la complexité de la parole de l’auteur. Ce qui sous-entend également de s’affranchir des contraintes que la culture-cible pourrait imposer. Cette éthique visant à retranscrire le plus fidèlement possible le message véhiculé par l’original permet en outre, de légitimer l’intervention plus ou moins marquée du traducteur sur le texte. Ces interventions ont donc pour but de palier au mieux aux manques, ou difficultés que représente le passage d’une langue à une autre.
La tâche à laquelle s’attèle la traduction dite féministe pourra être résumée de la manière suivante. Très proches des préoccupations de Lawrence Venuti en ce qui concerne la visibilité du traducteur, les théoriciennes de ce mouvement militent pour la reconnaissance par l’affirmation de leur travail en adoptant une approche performative de la traduction. Ce faisant, leurs travaux peuvent être assimilés à une prise de position politique. En effet, cet engagement proposant une interprétation, un point de vue nouveau sur une œuvre originale. Pour ce faire, la traduction procède alors à une analyse de la langue. Le langage comme construction arbitraire, dictée par les codes propres à une culture, permet d’appréhender les rapports de forces présents dans une société. C’est d’ailleurs par cette analyse du langage, que la traduction devient féministe. En se focalisant sur la sémantique, mais aussi sur l’attention portée au choix des mots employés, le travail des traducteurs consiste alors à proposer deux choses. D’une part, une production littéraire centrée sur le texte et son message, faisant abstraction des contraintes imposées par la réception dans la culture cible. D’autre part et par voie de conséquence, de s’inscrire dans une démarche progressiste permettant, à la fois de dénoncer, mais aussi d’outrepasser les codes structurants le langage jugés comme étant des projections représentatives d’une idéologie patriarchale. En d’autres termes d’amorcer un renouveau langagier permettant de donner aux femmes voie au chapitre, en ayant l’opportunité de développer un vocabulaire propre, mettant en adéquation pensée et expression. Ces dispositions participent donc à la création d’une éthique qui, par la réappropriation « féministe » du texte, vise à pallier la distorsion volontaire et/ou involontaire de l’image de la femme et de sa voie dans le domaine des Lettres, tout en rééquilibrant la balance dans les rapports de pouvoirs entre les genres.
C. Oster fait malgré tout une remarque concernant les manipulations apportées au texte en ajoutant que, « les lacunes ou la méconnaissance du contexte idéologique, littéraire, culturel, ou tout simplement le manque de recul par rapport à un texte ou une époque peuvent nuire aussi sûrement à la qualité de la traduction qu’une manipulation délibérée » (2018 : 5). Il faut donc faire preuve de vigilance et avoir un recul suffisant lorsque l’on tente de déterminer les raisons à l’origine des modifications présentent dans la traduction.
Nous avons vu dans cette partie en quoi les théories féministes et théories de genre étaient utiles quant à l’éthique à adopter lors de la traduction d’un texte. Cette éthique aspire aux mêmes avancées que celle proposée par Venuti en ce sens, qu’elles traitent toutes deux de la notion d’invisibilité du traducteur, de la reconsidération de son statut mais aussi de celui de la traduction et enfin de critères permettant de repenser la manière de juger plus objectivement de la qualité d’une traduction.
Les personnages dans la littérature
Le terme de fiction englobe différents éléments qui la constituent. La fiction, comme la définit Reuter, est l’univers mis en scène par le texte : l’histoire, les personnages, l’espace-temps (2016, section 2). Ainsi, lorsque l’on veut analyser les caractéristiques d’une histoire, sur sa singularité, il est important de se pencher sur les éléments constitutifs de la fiction.
Dans ce mémoire le travail qui nous occupe est comme nous l’avons déjà mentionné, de porter notre attention sur la jeune héroïne, Pippi Långstrump. En effet, les personnages sont en quelque sorte la clé de voûte de l’histoire, puisque ce sont eux qui « permettent les actions, les assument, les subissent, les relient entre elles et leur donnent sens » (Reuter, 2016, section 2.2). C’est donc à travers les personnages et leurs actions que la fiction tire son essence. Un autre point important que soulève la question des personnages est qu’ils sont « des éléments clés de la projection et de l’identification des lecteurs » (Reuter, 2016, section 2.2). Il est intéressant de mettre cette affirmation de Reuter en relation avec ce que nous dit Heldner au sujet de la traduction de la première traduction de Pippi Långstrump. En effet, elle avance l’hypothèse selon laquelle les modifications et altérations apportées au texte par la traductrice Marie Loewegren, auraient pour but d’empêcher ou plutôt de limiter l’identification des jeunes lecteurs à des personnages fictifs ne faisant pas suffisamment montre de savoir-vivre, d’exemplarité (Heldner, 1992 : 68).
Pour en revenir aux personnages, nous allons maintenant nous intéresser à la manière dont ils sont présentés. Reuter fait référence aux travaux de Philippe Hamon, et à sa ‘grille de lecture’ permettant de distinguer et de hiérarchiser les personnages. Pour ce faire, Hamon propose six catégories de critères. Cette catégorisation permet en premier lieu de différencier les qualifications attribuées aux personnages tant physiques, psychologiques, comportementales que sociales. Ensuite, elle permet également d’analyser l’importance des personnages en fonction de la durée et de la fréquence à laquelle ils apparaissent tout au long du récit. En somme, quelle stratégie a été adoptée pour mettre en scène les personnages et ce qu’elle nous révèle sur le degré d’importance des personnages. Enfin, elle peut également permettre une évaluation des personnages en fonction de la manière dont ils sont décrits, c’est-à-dire, le discours dont il est fait usage pour parler d’un personnage.
Une des catégories de critère qui va se révéler être extrêmement utile pour notre travail est celle que l’on nomme la pré-désignation conventionnelle. Grâce à cette dernière, il est possible de combiner le personnage et ses actions en se référant à un genre donné. Ceci sous-entend également qu’indépendamment de l’histoire, les attributs et actions d’un personnage peuvent être codifiés ou régis par un ensemble de caractéristiques traditionnellement associées à un mais qui permet du même coup de faciliter la catégorisation du personnage par ces spécificités communes relative au genre en question. Reuter souligne cependant le fait qu’à partir de la fin du XIXe siècle les romanciers contemporains et d’avant-garde n’ont eu de cesse de remettre en cause la légitimité de cette approche. En ayant recours à l’euphémisation et au brouillage de ces marqueurs, ils ont remis en question la place du personnage dans l’œuvre littéraire et le bien-fondé des routines de lecture. Les deux points soulever dans ce paragraphe vont nous servir pour aborder la question de l’œuvre d’Astrid Lindgren et plus particulièrement de son personnage, Pippi.
Spécificités du travail d’Astrid Lindgren
Innovation dans la littérature pour enfant
Les universitaires s’accordent à dire que l’œuvre de Lindgren est à bien des égards, une véritable révolution dans le genre de la littérature pour enfant. D’un point de vue du style notamment, comme le soulignent A. Gnaedig, C. Heldner ou encore V. Edström, les textes de l’auteure sont imprégnés par l’oralité. « A linguistic game in which the phonetic qualities too, are important, for the swing of the rhythm and the beauty of style » (Edström, 2000 : 11). C’est d’ailleurs, comme le dit Gnaedig, ce jeu sur l’oralité qui rend la traduction dans une autre langue des textes de Lindgren si complexe. Mais c’est un autre aspect de l’œuvre de Lindgren qui va nous intéresser ici. Comme nous l’avons vu précédemment, la pré-désignation conventionnelle permet au lectorat d’avoir en quelque sorte une liste d’attentes quant aux caractéristiques, aux attributs d’un personnage en relation avec le genre littéraire auquel appartient le livre en question. D’après Gnaedig, le style des livres de l’auteure suédoise se plient « aux canons que l’on s’attend à trouver dans différents genre littéraires » (2007 : 135). Mais comme le rappelle Edström, ce qui participe grandement au plaisir de lecture des livres de Lindgren est cette faculté qu’elle a d’assoir ses textes sur une structure allant de pair avec un genre littéraire spécifique, tout en outrepassant ses règles. Elle ajoute également que c’est sans aucun doute avec le livre Pippi Långstrump que l’auteure remet le plus en question les codes existants, mais en gardant malgré tout un fort attachement aux traditions littéraires (2000 : 21).
Pour bien comprendre l’origine du caractère innovant et unique du travail de Lindgren il est important de rappeler que c’est au cours du XXe siècle que s’opère un changement radical dans la façon de considérer l’enfant, la place qu’il occupe dans la société et donc par extension son éducation. On pourra citer les travaux de la féministe suédoise Ellen Key et notamment son livre Le siècle de l’enfant. Avec l’émergence de cette vision nouvelle, l’enfant est placé au centre du débat. Il n’est plus considéré exclusivement comme un individu à former à travers une éducation stricte en jugulant ce qui fait de lui un enfant. C’est dans la continuité de cette pensée que l’on pourra inscrire le travail de Lindgren.