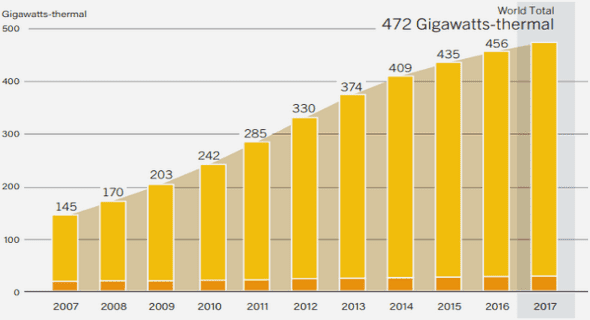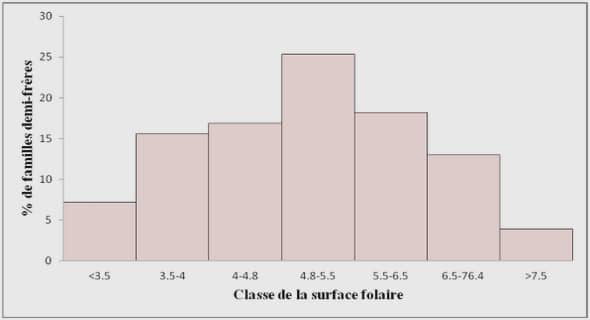Allemagne et Bade-Wurtemberg
L’Allemagne possède 82, 8 millions d’habitants (Eurostat 2017) et est en cela le pays le plus peuplé de l’Union Européenne (UE) (16, 2% de la population européenne totale). Selon Eurostat toujours, le taux de chômage en Allemagne se situe en janvier 2019 à 3,2 % tandis que la moyenne européenne se situe à 2017 à 6,5%, 8,6% pour la France)3. Ces chiffres cependant ne disent rien sur les fortes disparités géographiques de ces taux, ni sur la problématique croissante des « travailleurs pauvres » ou des retraités pauvres. L’Allemagne contribue à 21, 2 % au produit intérieur brut (PIB) de l’UE. En tant que République fédérale, elle consiste en 16 Etats (ci-après Land ou pluriel, Länder), qui sont complétement responsables de leur système éducatif.
En 2014, le budget total pour l’éducation, la recherche et la science s’élevait à 267 milliards d’euros. Cela correspondait à 9,2% du produit intérieur brut (Eurydice). Länder et autorités locales contribuent pour 90% aux dépenses éducatives. Les fonds privés (entreprises, associations…) sont proportionnellement plus élevés concernant l’éducation professionnelle (apprentissage, système dual), dans le domaine de l’éducation tertiaire et de « l’éducation tout au long de la vie ».
Le Bade-Wurtemberg est le troisième pays le plus peuplé d’Allemagne avec 11 millions d’habitants. Cette région est située dans le sud-ouest. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale et particulièrement le début des années 1950, c’est une région d’immigration à laquelle elle doit ses récents gains de population (à hauteur d’environ 75%, contre 25% pour l’accroissement naturel). Les immigrants sont en moyenne dix ans plus jeunes que la population autochtone, ce qui cependant ne compense pas le vieillissement de la population. Ce vieillissement est visible notamment dans la pyramide de distribution d’âge des enseignants. En effet, comparé à d’autres pays européens excepté l’Italie, l’Allemagne compte de façon disproportionnée un nombre élevé d’enseignants âgés (sans compter la problématique de renouvellement). Le Bade-Wurtemberg a la plus grande proportion d’habitants de nationalité étrangère en Allemagne (12% de la population totale). 40 % des habitants étrangers viennent des pays membres de l’Union (Italie, Grèce) tandis que le second plus gros groupe est d’origine turque. A Stuttgart, Mannheim et Hallstadt, une personne sur quatre ou cinq est d’origine étrangère. Le Bade-Wurtemberg est un Land qui est économiquement dynamique basé sur un tissu de petites, moyennes et grosses entreprises à la réputation internationale (industrie automobile, électronique). La région possède aussi de nombreuses villes universitaires, telles que Stuttgart, Tübingen, Heidelberg et Mannheim.
La Gemeinschaftsschule4 (GMS) « Geschwister Scholl » étudiée.
La « Gemainschaftsschule » est une école du secondaire inférieur en « transition » depuis 2013 du modèle Realschule au modèle de l’école « intégrée » et « à la journée » (Ganztagsschule). L’école qui a accueilli une partie de cette recherche est située dans une ville moyenne et rurale (selon la perception allemande)5 du Bade-Wurtemberg, entre la capitale Stuttgart et la ville universitaire de Balenstadt. D’après les statistiques internes (au 1er juin 2017), 423 élèvent sont inscrits dans cette école, dont 70 sont issus de l’immigration (première ou seconde génération). Parmi les 21 nationalités recensées par l’école, les élèves d’origine turque ainsi que de Bosnie-Herzégovine et d’Italie sont les plus nombreux. Dans la catégorie « inclusion », relativement au projet de cette école qui est d’accueillir tous les élèves (qui auraient pu être autrefois orientés dans des écoles spéciales (Förderschule) par exemple), l’école recense trois élèves avec des « troubles du développement et émotionnels ». En moyenne, une classe compte 26, 4 élèves. Tandis que l’appartenance religieuse et la nationalité font partie des statistiques établies par l’école, je n’ai pas pu accéder à des statistiques portant sur l’origine sociale et éducative des élèves. Dans ma thèse, je vais apporter des éléments concernant la distribution inégale des élèves selon les milieux sociaux et le fait d’être issu de l’immigration ou non entre les différentes types d’écoles (Förderschule, Hauptschule, Reaschule, Gemeinschaftsschule, Gymnasium) –qui est également un indice pour un achèvement inégal des diplômes.
France et Bretagne
La France compte 67,19 millions d’habitants (Insee 2018) –environ 15 millions de moins que l’Allemagne. D’après Eurostat, le taux de chômage en France fluctue autour de 9% en 2018. En 2016, les dépenses domestiques en éducation atteignent 149, 9 milliards d’euro, qui correspondent à 6,7% du PIB. Contrairement à l’Allemagne, l’Etat est le principal contributeur (57, 3% en 2016). Viennent ensuite les autorités décentralisées (23, 4%), les entreprises (8,4%) et les ménages (7,7%). En 2018, 79% d’une génération a obtenu le bac général et technologique tandis qu’en Allemagne, l’Abitur est obtenu, en 2017, par 42, 2 % d’une génération. Cette proportion augmente continuellement tandis que le niveau de qualification d’une génération sur l’autre s’élève également.
La Bretagne est une région située dans le nord-ouest de la France. En 2015, elle compte 3 293 850 habitants, dont 47,1% ont 45 ans et plus. 34,5% de la population totale a entre 0 et 29 ans (Insee). Un rapport de l’Inspection générale en 2000 notait de similaires évolutions qu’en Bade-Wurtemberg, à savoir un gain de population qui provient essentiellement d’un solde migratoire positif tandis que la population vieillit. 73,1% de la population active (15-64 ans) a un emploi, 8,8% n’en a pas. Les jeunes femmes sont les plus affectées. La capitale est Rennes, qui est aussi une ville universitaire. Plus généralement, la Bretagne est très diverse, recouvre des zones rurales et urbaines plus ou moins dynamiques et affectées par les changements économiques structurels (désindustrialisation, économie locale maritime…) ; ainsi que de fortes inégalités en termes d’accès aux services publics ou en termes d’offres de formation. En 2000, le rapport de l’inspection générale note une structure favorable aux performances éducatives avec une évolution positive de la proportion de cadres et de professions intermédiaires. En matière d’éducation et au vu de certains indicateurs de réussite (comme le taux de réussite au bac par exemple, tests réguliers d’évaluation des performances des élèves en mathématiques et français…), elle est considérée comme l’une des académies les plus performantes du territoire. A l’instar du Bade-Wurtemberg, c’est également le territoire français où les sorties sans diplôme sont les moins nombreuses.
Le collège REP « La Balikan »
Il a accueilli la recherche de janvier à juin 2015. Il est situé dans l’un des quartiers prioritaires politique de la ville » et rassemble une population à bas revenus. Selon une organisation parapublique locale6 qui produit régulièrement les portraits sociodémographiques des quartiers de cette grosse ville pour la municipalité, ce quartier est celui qui compte en 2015 le taux le plus important de familles et familles à bas revenus, ainsi qu’issues de l’immigration. La population issue de l’immigration a augmenté depuis quelques années, ainsi que la proportion d’adolescents. Par ailleurs, la population locale est relativement mixte en ce qui concerne les âges, bien qu’elle se rejoigne sur les bas et très bas revenus. 400 élèves sont inscrits au collège La Balikan en 2014 selon les statistiques internes. 66 élèves sont en inclusion », 10 malentendants sont intégrées dans les classes ordinaires, 56 sont scolarisés dans une unité séparée (SEGPA). Selon les statistiques internes, les élèves boursiers sont en augmentation depuis trois ans (65,10 % en 2012 ; 68,09% en 2015). A ma demande, une auxiliaire de vie scolaire a établi une statistique des origines des élèves d’une classe de cinquième ordinaire. Voici les résultats sur 19 élèves : Guyane (1), Guadeloupe (2), Portugal (1), Italie (1), Turquie (3), Cap Vert (1), Guinée (1), Mayotte (1), République Tchèque (1), France (5). On notera que sur 12 élèves issus de l’immigration, la moitié provient d’anciennes colonies.
La France et l’Allemagne sont comparables du point de vue de leur « régime de transition », l’aspect sélectif et standardisé de leur système éducatif7 auxiliaire de vie scolaire a établi une statistique des origines des élèves d’une classe de cinquième ordinaire. Voici les résultats sur 19 élèves : Guyane (1), Guadeloupe (2), Portugal (1), Italie (1), Turquie (3), Cap Vert (1), Guinée (1), Mayotte (1), République Tchèque (1), France (5). On notera que sur 12 élèves issus de l’immigration, la moitié provient d’anciennes colonies.
La France et l’Allemagne sont comparables du point de vue de leur « régime de transition », l’aspect sélectif et standardisé de leur système éducatif7.
Introduction
Cette thèse s’effectue à la suite d’une recherche de master qui portait sur l’étude de parcours de jeunes qui avaient quitté l’école secondaire sans diplôme et s’étaient engagés dans un volontariat de service civique. Cette thèse porte moins sur les parcours de « décrocheurs » que sur la construction politique d’un problème public et l’appropriation (par les professionnels de l’école) de ce concept. Ces appropriations sont replacées dans leurs contextes nationaux, institutionnels et organisationnels. Comment les différents professionnels de l’école « entre les murs » 9 légitiment ou non, s’emparent ou non, du problème visant à réduire les « sorties précoces » en Bretagne et en Bade-Wurtemberg, dont les gouvernements nationaux ont un rôle moteur dans l’intégration européenne. Plus spécifiquement, cette recherche consiste à interroger les « formes d’action » que la notion est censée « susciter » au niveau local, et plus particulièrement, au niveau de l’école (Bernard, 2013, pp. 18-19). Quelles sont-elles ? Que nous apporte une comparaison dans ce domaine?
Parler de « sorties précoces » et non de « décrochage scolaire », qui est le terme français en vogue, vise à dépasser une polysémie de concepts français et allemands qui ont pour objet les comportements « déviants » à la norme ancienne d’obligation scolaire et celle, plus récente, d’assiduité ». Le terme de « sorties précoces » renvoie à la construction d’un problème public qui participe de l’établissement d’une norme d’achèvement d’un niveau minimal de qualification (Bernard, 2013). S’interroger sur cette norme revient à expliciter le rôle de l’Union européenne dans la mise en forme discursive de cette nécessité, fondée sur l’espérance d’une société économiquement plus dynamique et socialement plus cohésive.
La thèse est introduite par un extrait d’un protocole de terrain relatant la rencontre avec une principale allemande d’une « Gemeinschaftsschule », qui eut lieu après la clôture du terrain français au collège La Balikan (Bretagne). Cet extrait peut être considéré comme un moment crucial qui orienta par la suite l’analyse comparée de l’appréhension du problème « sorties précoces » 10 en France et en Allemagne, ainsi que le plan de raisonnement. Cet extrait se veut être une illustration de la méthodologie qui fut employée dans cette recherche, basée sur une approche « ancrée » des phénomènes sociaux. Elle suppose l’analyse systématique des données issues du terrain et la mise à l’épreuve de concepts et d’approches théoriques existants ou générés de façon inductive (theoretical sensitivity) qui conditionnent ensuite la collecte approfondie de nouvelles données ou l’analyse nouvelle de données déjà collectées.
Cette rencontre avec une principale allemande, Madame Hummel, illustre aussi un des processus inhérents à la recherche qualitative, qui consiste à trouver et à négocier les terrains d’observation (participante) –dans mon cas au sein d’écoles du secondaire inférieur en Bretagne et dans le Bade-Wurtemberg. Cela demande du temps et n’aboutit pas toujours, ce qui explique aussi pourquoi la comparabilité apparente des deux écoles étudiées n’est pas parfaite (voir ci-après).
L’invitation par Madame Hummel à une rencontre qui résultait de son intérêt pour le problème et phénomène « Schulverweigerung »11 a conduit notamment à s’interroger sur ses motivations. En effet, j’avais écrit à d’autres écoles, qui n’avaient pas répondu. Qu’est ce qui peut expliquer que certains principaux font de ce thème leur bataille et d’autres non ?
La rencontre avec Madame Hummel informe aussi sur le rôle de l’UE dans la gouvernance éducative, ainsi que sur le rôle des « technologies gouvernementales » au sens foucaldien du terme, tel que le projet pour les « refuseurs de l’école » subventionné à 50% par le Fonds social européen et que Madame Hummel souhaite implanter dans son école. Ce projet, comme j’ai pu le constater par la suite, dissémine à la fois définitions et catégories spécifiques (une façon de voir et de définir le problème) comme il participe au renforcement de la norme de la certification. Ainsi, cet entretien a conduit à questionner le rôle et la nature du discours développé par l’UE sur ce problème.
De plus, le discours tenu par Madame Hummel a conduit à considérer la diversité des acteurs impliqués dans la lutte contre les « sorties précoces », ou susceptibles de l’être. Ces acteurs sont aussi bien ceux de l’école que ceux qui en sont extérieurs, tels que les autorités éducatives locales, les institutions de protection sociale, d’enfance et de jeunesse, comme mentionnées par Madame Hummel, avec lesquelles elle doit composer concernant sa vision du problème et le projet qu’elle souhaite mettre en œuvre dans son établissement.
En outre, Madame Hummel fait également référence à un répertoire existant de mesures de contrôle et punitives, qui permettent de gérer les cas de « participation négative » des élèves. L’expérience de l’« inefficience » de ces mesures explique en partie pourquoi elle se tourne vers « autre chose ». C’est aussi un exemple de la marge de manœuvre qu’ont les professionnels incarnant le service public de l’éducation auprès des usagers (« street level bureaucrats ») dans la mise en place de leur politique scolaire.
Le discours de Madame Hummel informe également sur le rôle des structures du système éducatif qui influencent en Allemagne la composition de la « clientèle » au sein des différents types d’école. Cet aspect impacte possiblement l’interprétation des problèmes rencontrés. Même si ce n’est pas vraiment mis en valeur dans cet extrait, qui fut raccourci, Madame Hummel mentionne régulièrement, au cours de l’entretien, la réforme qui vise l’établissement d’une école (secondaire) intégrée dans le Bade-Wurtemberg (Gemeinschaftsschule), supposément plus démocratique. Elle lie ainsi explicitement les problèmes rencontrés avec la nature segmentée et sélective des structures éducatives. De quelles relations s’agit-il exactement ?
Approche située d’un concept médiatique d’action publique au sein de deux écoles secondaires allemande et française
Contexte d’émergence de la thèse : agenda, ancrage disciplinaire et distanciation
Cette partie fait état du contexte d’émergence de la thèse dont le sujet et le financement ont été fortement favorisés par la mise à l’agenda du problème « décrochage scolaire » en France, et plus particulièrement en Bretagne. En effet, depuis la loi de décentralisation concernant l’orientation et l’éducation tout au long de la vie (2014), les régions ont été invitées par le gouvernement à intégrer sur leur agenda éducatif la lutte contre le « décrochage scolaire ». J’évoque à ce sujet quelques éléments de mon terrain exploratoire, et notamment d’une recherche-action dont l’objet était d’analyser l’activité des 17 « plateformes régionales de soutien et d’appui aux décrocheurs » (PSAD). Ces entités administratives sont créés en 2011 et ont pour but de renforcer le repérage des « sortants précoces » et de leur proposer des solutions ». Cette recherche-action a mis en lumière des éléments de transformation de la gouvernance de l’éducation en France: importance des cadres discursifs transnationaux et de leurs usages à des niveaux subnationaux de l’action publique, le rôle des chercheurs dans la dissémination de ces cadres, la gouvernance multi-niveaux (multi-level and rescaling), multi-acteurs, qui se veut intersectorielle, les discours sur « l’autonomie » des établissements d’enseignement secondaires (Walther and al., 2016; Pareira do Amaral and al., 2015).
La lutte contre le « décrochage scolaire » dans le secondaire (ou autres concepts renvoyant aux ruptures de scolarité perçues comme précoces) est un thème extrêmement traité depuis les années 1980, et particulièrement depuis le début des années 2000, que ce soient dans les média, la recherche, et différents champs institutionnels et professionnels (action sociale et éducative, éducation formelle et non-formelle, protection de la jeunesse, justice des mineurs….), tant en France qu’en Allemagne. La littérature en sciences sociales traitant de ce thème est abondante, tout comme les termes qui sont employés12 pour le décrire et qui renvoient dans leur ensemble à l’émergence d’une norme sociale (celle d’une formation secondaire complète, de la qualification). Comme toute norme, elle suscite bien sûr l’étude des déviances qu’elle engendre. Certains ouvrages se penchent sur l’intérêt historique des autorités publiques pour les manquements à l’obligation scolaire –qui sont aussi vieux que l’école obligatoire. Les chercheurs s’interrogent également sur la construction récente du phénomène en problème d’action publique. Ici, les préoccupations relatives à la transformation des économies structurelles et au problème de l’insertion professionnelle des moins ou non qualifiés impliquent des justifications d’ordre universaliste et peuvent être reliées à des peurs anciennes et sécuritaires liées au contrôle de la déviance des jeunes (p. ex. Stamm et al., 2012, Wagner (dir.), 2007; Herz, Puhr & Ricking, (dir.), 2006, pour l’Allemagne; Berthet & Zaffran (dir.) 2014; Bernard, 2013, Glasman & Œuvrard (dir.), 2004; Brucy, 2003). Au-delà du respect de l’obligation scolaire, nombre de recherches sur ce thème soulignent également le contexte européen dans la mise à l’agenda nationale, régionale et locale de ce phénomène. La lutte contre les « sorties précoces » est, depuis 2003, un indicateur de performance des systèmes éducatifs européens jugés à leur capacité de réaliser l’égalité des chances » et à produire la « matière grise » nécessaire à l’établissement d’une économie de la connaissance ».
La référence à l’UE dans les différents programmes de lutte contre les « sorties précoces » en France et en Allemagne suite aux engagements pris dans le cadre de la stratégie de Lisbonne (2000) oblige à faire l’état de la recherche sur les questions liées à « l’européanisation » des politiques publiques d’éducation. Cette question cependant est à mettre en perspective avec les réinterprétations et configurations institutionnelles spécifiques au niveau national et local (Walther and al., 2016, Parreira and al., 2015, Buisson-Fenet & Pons, 2012). Aussi, bien qu’on ne puisse pas parler de « transfert » direct ou d’imposition verticale des injonctions et/ou recommendations prises au niveau communautaire jusqu’au niveau de l’école, l’UE a un impact sur la formulation et le cadrage cognitif des problèmes publics domestiques.
On dispose aujourd’hui d’une connaissance importante concernant les phénomènes de « décrochage scolaire » et des « facteurs de risque ». Ceux-ci sont liés à l’environnement individuel des élèves tout comme au contexte scolaire. On connait statistiquement, les territoires les plus « touchés ». On connait également les leviers pédagogiques et organisationnels possibles au niveau de l’établissement. Très souvent, la question du décrochage scolaire » recoupe la question sociale (et migratoire). En cela, elle comporte un effet « dynamite » potentiel pour sociétés françaises et allemandes (Delaye, 2015; Stamm and al., 2012). La recherche à ce sujet souligne également le rôle du « décrochage » dans la construction identitaire de l’individu (Stamm ibid.) ainsi, que du « décrochage » comme moyen de gérer une situation éprouvante pour l’individu (coping) : « il y a des décrocheurs pour qui partir, c’est vivre un peu » (Berthet & Zaffran, dir., 2014, p. 58). Enfin, la recherche souligne le rôle des structures et des institutions scolaires dans la production des « décrocheurs ». Par ailleurs, il est intéressant de constater que celles-ci diminuant tendanciellement (ou restant stables dans le temps), la médiatisation de ce phénomène est allée croissante ces dernières années (Bernard, 2013). Cette recherche vise à apporter des éléments de réponse.
La recherche, déjà très fournie sur ce sujet, ainsi que le contexte politico-médiatique existant, m’ont obligée à trouver un angle original sous lequel l’aborder. Dans un perspectif constructiviste, étudier le « décrochage scolaire » consiste à interroger la construction de ce problème en problème public, affiché comme priorité au niveau communautaire. La construction intellectuelle du problème peut ainsi être mise en perspective et interrogée en fonction de la façon dont les acteurs appréhendent, utilisent et mettent en forme ce discours au niveau de l’école. Il n’existe à cette heure aucune recherche comparant les perceptions de ce concept par les acteurs de l’école en France et en Allemagne, ni d’étude faisant l’analyse comparée des justifications intellectuelles à l’origine de nombreuses programmatiques et mesures visant à lutter contre les « sorties précoces ».
Outre l’état de la recherche allemande et française, cette partie est également dédiée à l’exercice de distanciation subjective comme étape inhérente à toute recherche qualitative, accentuée dans l’approche ethnographique, qui engage l’être social du chercheur ou de la chercheuse, et le champ disciplinaire dans lequel il ou elle s’inscrit (Bouveresse, 2003; Noiriel, 1990).