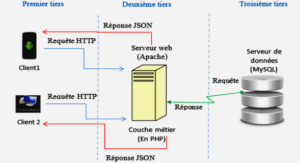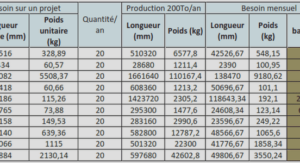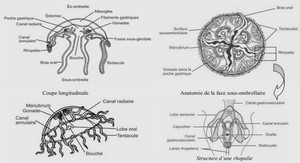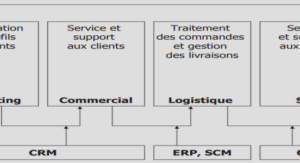Louis Fréchette Mémoires intimes.
Louis Fréchette a publié plusieurs recueils de poésies, des drames et deux recueils de contes, La Noël au Canada (1900) et Originaux et détraqués (1892). De plus, il a fait paraître plusieurs contes dans différents journaux. Louis Fréchette avait songé à publier un autre recueil de contes, qui aurait été intitulé Masques et fantômes, mais devant le peu de succès remporté par la Noël au Canada, il abandonna ce projet. Ses Mémoires intimes ont paru, pour leur plus grande partie, dans le Monde illustré de Montréal entre le 5 mai et le 24 novembre de l’année 1900. Il ont ensuite paru en volume pour la première fois en 1961. Pour plusieurs, ils constitueraient le meilleur de son œuvre. Édition de référence : Éditions Fidès, Collection du Nénuphar. Image de la couverture : Cornelius Krieghoff Québec, vu de Pointe-Lévis, 1853. Huile sur toile, 36.6 x 57.9 cm. Chapitre I Ma naissance. – Mon père et ma mère. – Fréchette, Fréchet ou Frichet. – Mon acte de baptême. – Mes deux grand’mères. – Mon aïeul maternel. – Son mariage avec ma grand’mère. – John Campbell. – Madeleine Lamotte. – Frères et sœurs d’adoption. – La maison paternelle. – Visite au vieux foyer. Je l’ai donné à entendre dans mon avant-propos , je suis né le 16 novembre 1839, le troisième enfant de ma famille, bien que je sois resté l’aîné des survivants – les deux premiers, un frère et une sœur étant morts en bas âge. Mon père Louis-Marthe Fréchette, et ma mère, Marguerite Martineau (dont la famille portait aussi le nom de l’Ormière), étaient nés tous deux à Saint-Nicolas, sur la rivière Chaudière, et, après avoir passé quelques années dans cette banlieue de Québec qu’on appelait alors les Foulons, étaient venus s’établir dans les chantiers de Lévis très peu de temps avant ma naissance.
Les anciens registres de l’état civil ne s’accordent pas sur la manière d’épeler notre nom. Ceux qui savaient lire et écrire, dans nos campagnes, il y a cent cinquante à deux cents ans, étaient l’exception, et lorsqu’il baptisait un enfant, le curé de la paroisse enregistrait le nom de famille au petit bonheur, suivant son impression ou les caprices de son oreille, sans consulter même la tradition. Il en résulte que, dans ces registres, les ascendants de ma famille sont quelquefois nommés Fréchette, souvent Fréchet, parfois Fréschet et même Frichet. La première de ces différentes orthographes est restée la plus généralement adoptée. Et cependant, la seconde me semble la plus ancienne et partant la plus authentique, car, bien que mon ancêtre paternel, le premier de ma lignée émigré dans le pays, fût de Saint-Martin, île de Ré, le nom semble originaire du Midi de la France, où on l’épelle invariablement Fréchet. Ainsi, dans les Hautes-Pyrénées, j’ai visité trois villages ou hameaux qui portaient respectivement les noms de Fréchet-Aure, de Cazaux-Fréchet, et de Fréchou-Fréchet. Quoi qu’il en soit, mon grand-père et mon père ayant adopté la forme Fréchette, j’ai suivi leur exemple, sans m’occuper de la tradition ou de l’étymologie ; et quand j’aurais pu réagir, il était trop tard. Je fus baptisé à l’église de la Pointe-Lévis, aujourd’hui connue sous le nom de Saint-Joseph de Lévis. Mon acte de baptême porte simplement le prénom de Louis. Si pendant mes années de jeunesse il m’est arrivé de signer Louis-Honoré ou Louis-H. qui en est l’abrégé, c’est qu’on avait ajouté le prénom d’Honoré, lors de ma confirmation, en 1849, en l’honneur de notre vicaire l’abbé Honoré Jean, qui était l’ami de ma famille et qui avait présidé à ma première communion. Après mon mariage, je repris mon seul et vrai nom, à cause de la confusion qui pouvait en résulter dans mon état civil. Cela a donné lieu, dans certains quartiers, à des plaisanteries, que malgré ma bonne volonté, je me suis vainement efforcé de trouver spirituelles. Il est vrai qu’il n’est pas donné à tout le monde de comprendre une chose si compliquée. De mes grands-parents j’ai bien connu mes deux aïeules qui ont toutes deux passé leur vieillesse chez mon père, où elles sont mortes, l’une à quatre-vingt-sept et l’autre à quatre-vingt-seize ans. Quant à mes grands-pères, qui sont morts à soixante et quelques années chacun, je ne les ai vus que très rarement dans mon enfance ; et, comme les deux vieillards, à l’encontre de ce qui se voit d’ordinaire chez les vieux, ne faisaient guère attention à leur petit-fils, je n’en ai conservé qu’un souvenir assez confus. Tout ce dont je me souviens, c’est qu’on appelait mon aïeul maternel M.
Martineau ou le colonel l’Ormière, qu’il faisait partie de la milice, qu’il voyageait rarement sans son fusil, qu’il était grand chasseur et le compagnon de chasse ordinaire de sir John Caldwell dans les Bois-Francs, région encore déserte à l’époque dont je parle. Autant que je puis en juger, mon père, qui était l’homme actif et rangé par excellence, n’avait que des sympathies assez limitées pour le vieux colonel, dont l’humeur aventurière semblait ne lui plaire qu’à demi. Un épisode romanesque se rattachait à son mariage avec ma grand’mère. Celle-ci, la « jolie Marie Aubin », comme on l’appelait à Sainte-Croix, sa paroisse natale, était novice au couvent de la Pointe-aux-Trembles, de l’autre côté du fleuve, lorsque mon grand-père, qui avait traversé le fleuve sur la glace en fringant équipage, réussit à obtenir d’elle ce qu’il avait vainement sollicité de la jeune fille en vacances – son cœur et sa main. Ce fut presque un enlèvement ; et encore je dis presque… Au fait je n’y étais pas. Tout ce que je sais, c’est que le galant colonel avait gagné son point, et que huit jours plus tard, la jolie novice s’appelait Mme Louis Martineau ou Mme de l’Ormière, comme on voudra, et que ma pauvre grand’mère a fait des pénitences jusqu’à la fin de ses jours, pour avoir, suivant son expression,manqué ce qu’elle appelait sa vocation. À part mon frère Edmond, qui était mon cadet de quatorze mois, j’ai eu pour compagnon d’enfance, ou plutôt comme frère aîné – car nul n’a jamais mieux que lui mérité le nom de frère – un jeune orphelin né de parents écossais, qui avait huit ou neuf ans de plus que moi, et que mes parents avaient recueilli, à l’âge de trois ans, comme leur propre enfant, pendant leur séjour dans les Foulons. Il s’appelait John Campbell, et ce n’est pas sans émotion que je nomme ici celui à qui j’ai dû, après mon père et ma mère, les premières caresses, les premiers services, les premiers amusements et les premières joies de mon enfance.