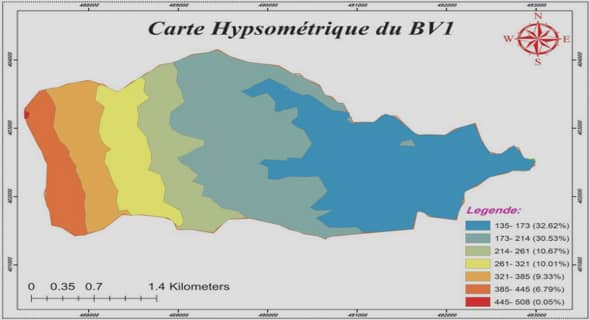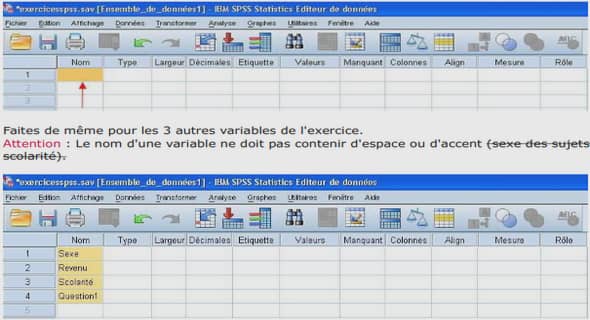Objet de la sexologie et marché des thérapies
Bien que la sexologie soit souvent définie comme science de la sexualité, englobant tous les savoirs biologiques, psychologiques, médicaux et sociaux sur la sexualité et les pratiques thérapeutiques qui y sont associées, cette définition ne correspond pas, de fait, à la situation française. S’il y a bien des recherches sur la sexualité, ces recherches ne constituent pas un champ autonome, comme c’est le cas dans les pays anglo-saxons où la recherche (sex research) et la dimension clinique sont associées1. En France donc, le terme « sexologie » renvoie à la discipline et à la pratique thérapeutique. Si elle est une thérapie, quelles « maladies » prend-elle en charge ? Quelle est sa place sur le marché des thérapies ?
Les travaux d’André Béjin
C’est à ses deux questions notamment, que, dès la fin des années 1970, André Béjin répond au travers de plusieurs articles2. Son travail, qui ne s’appuie ni sur des données empiriques de première main, ni, à proprement parler, sur l’analyse systématique d’archives, mais sur une lecture serrée d’un certain nombre d’ouvrages sur la sexualité du 19ième siècle aux années 1970, est une réflexion historico-sociologique : sur la rationalisation de la sexualité et l’organisation du « champ sexuel »3 ; 2) sur le marché des thérapies et sur la « répartition des tâches » entre sexologie, psychanalyse et thérapies de la communication et de la conscience corporelle4.
Selon lui, l’autonomisation du « champ sexuel » s’est accompagnée de la progressive théorisation d’une « unité de mesure » dans le domaine de la sexualité – l’orgasme. Bien sûr la définition de cette « unité de mesure », l’orgasme, se fait progressivement et André Béjin en perçoit déjà les prémices chez le Marquis de Sade5. Toutefois, il considère que les sciences de la sexualité, et plus particulièrement la sexologie, ont joué un rôle déterminant dans sa définition. Ainsi, il confronte les positions de Sigmund Freud, Wilhem Reich et d’Alfred Kinsey : permettant d’affirmer avec certitude la nature sexuelle d’un processus ; nous ne connaissons sous ce rapport que la fonction de reproduction dont nous avons déjà dit qu’elle offrait une définition trop étroite. »
Reich en 1942 (La fonction de l’orgasme) : « La fonction de l’orgasme devient ainsi l’unité de mesure du fonctionnement psychopsychique, parce que c’est en elle que s’exprime la fonction de l’énergie biologique. »
Kinsey en 1953 (Le comportement sexuel de la femme) : « L’orgasme est un phénomène distinct et particulier que l’on peut généralement reconnaître aussi facilement chez la femme que chez l’homme. Nous l’avons donc pris comme unité de mesure. L’orgasme diffère de tous les autres phénomènes de la vie d’un animal et on peut généralement, sinon même invariablement, voir dans son apparition le signe de la nature sexuelle de la réaction d’un individu. »
La création d’une unité de mesure « autonomise » les pratiques sexuelles et permet une rationalisation par les agents de leurs actions. Ils sont à même, dès lors, d’agir « de façon rationnelle en finalité », selon le concept de Max Weber1, c’est-à-dire d’opérer des calculs selon un modèle coût/efficacité. Cette spécification de l’orgasme permet la comptabilisation des orgasmes et surtout leur commensurabilité2, de telle sorte que les moyens (ou les façons) qui ont permis de les obtenir et les conditions dans lesquels ils sont survenus sont, par là même, des éléments secondaires : un orgasme valant un orgasme, une pratique sexuelle menant à l’orgasme vaut une autre pratique sexuelle menant à l’orgasme3.
La sexologie étant au cœur de cette nouvelle problématisation du plaisir, elle est désormais la mieux placée pour prendre en charge les difficultés qui s’opposent à l’orgasme et elle se transforme en orgasmothérapie. Ayant abandonné ses premiers objets qu’était la périsexualité (contraception, grossesses, maladies vénériennes, etc.) et les perversions, elle s’occupe essentiellement de gérer les troubles de la sexualité ordinaire ». Il ne s’agit plus pour elle de se préoccuper des « aberrations » mais de s’attacher à la fonction érotique de la sexualité ainsi qu’au couple et à sa santé sexuelle. Dans ce cadre, la sexologie, en mêlant une approche biomédicale à des approches psychothérapeutiques, interroge les frontières entre maladie et santé, entre le normal et le pathologique, puisqu’ayant abandonné le terrain des perversions, les thérapeutes traitent moins un fonctionnement anormal qu’une série de troubles et de dysfonctionnements » qui gênent l’établissement d’un fonctionnement sexuel normal. Ce dernier implique d’ailleurs la satisfaction des deux partenaires. A ce titre nous sommes tous, aux yeux de la sexologie, des « dysfonctionnants sexuels » potentiels ou actuels1. La sexologie est, dans ce contexte, l’un des recours possible à la fois pour se situer par rapport à une norme (par le biais de la consultation et de la vulgarisation par exemple), mais aussi pour aider à la reprise d’une vie sexuelle satisfaisante après une rupture (par exemple, un homme mûr recommençant sa vie avec une femme plus jeune et soucieux « d’être à la hauteur »), ou encore pour rassurer sur son orientation sexuelle, etc. Ces évolutions récentes se traduisent aussi dans le discours sexologique qui a abandonné le ton trop normatif de ses origines pour osciller, comme le discours psychologique, entre un pôle normatif (réaffirmant certaines règles) et un pôle libéral (revendiquant une plus grande autonomie des personnes quant au choix de leurs valeurs et modes de vie)2.
Cette évolution des théories de la sexualité a pour conséquence une reconfiguration du marché des thérapies. Avec Alfred Kinsey les orgasmes sont comptabilisés et l’orgasme devient un objet statistique. Plaçant le coït au centre de la conjugalité, il étudie le comportement sexuel comme une série d’actes et non de dispositions mentales. William Masters et Virginia Johnson définissent à sa suite le cycle de la réponse sexuelle. L’orgasme est défini par une configuration de corrélats physiologiques objectivement appréhendables et les troubles sont considérés comme des comportements appris et conditionnés. Ainsi sur le plan théorique, la pratique thérapeutique de la sexologie, est, dans la perspective de William Master et Virginia Johnson, essentiellement basée sur des conceptions behaviouristes (comportementalistes). Cette orientation marquerait donc le « divorce » entre psychanalyse et sexologie, dans la mesure où cette dernière donne la primauté au symptôme et se donne comme objectif sa disparition. La sexologie, en s’appropriant son nouvel objet (l’orgasme), pousse la psychanalyse hors du champ d’intervention du traitement des dysfonctions sexuelles. Ses conceptions comportementalistes lui permettent de concurrencer la psychanalyse et d’afficher un résultat, la psychanalyse se retranchant sur le marché des thérapies de l’identité3.
Le champ thérapeutique
La théorie d’André Béjin sur la spécification par la sexologie de l’orgasme, de ses conséquences sur le « champ sexuel » (qui devient un véritable marché sexuel où l’on échange des orgasmes) et sur le champ des thérapies a les défauts de ses qualités. Si le modèle séduit par sa pertinence, notamment par son actualité et par les formidables intuitions d’André Béjin sur les significations et les attentes contemporaines en matière sexuelle, il est, de par le niveau de généralité qu’il vise, moins exact concernant l’image qu’il donne de la pratique concrète de la sexologie et de la situation du champ des thérapies sexuelles et conjugales.
L’objet de la sexologie
Concernant l’objet de la sexologie, il est vrai qu’actuellement, elle se concentre essentiellement sur les difficultés sexuelles « ordinaires » touchant la « fonctionnalité sexuelle ». Mais contrairement à ce qu’affirme André Béjin, ces difficultés étaient déjà prises en charge par les médecins (et ensuite les premiers sexologues) au 18ième siècle1, puis tout au long du 19ième siècle2 et faisaient aussi partie des préoccupations de l’Association d’Etudes Sexologiques au début du siècle3. Les difficultés sexuelles ordinaires » font donc l’objet d’une réflexion et d’une prise en charge même si, des débuts de la sexologie, on ne retient le plus souvent que l’entreprise nosographique des perversions de la fin du 19ième siècle et le projet eugénique du début du 20ième siècle. Même si l’orgasme n’avait pas encore été théorisé, les débuts de la sexologie ne sont pas entièrement tournés vers les perversions et les maladies vénériennes.
A l’inverse, elle n’a pas complètement abandonné aujourd’hui le terrain de ce que l’on nommait les « perversions », les « aberrations » ou les « déviances ». Certains sexologues prennent par exemple part à la prise en charge psychothérapeutique du transsexualisme en n’intervenant pas exclusivement sur la « fonctionnalité sexuelle » postopératoire mais aussi au moment de l’évaluation de « l’authenticité du syndrome »4. D’autres se spécialisent dans la prise en charge des délinquants sexuels. En ce qui concerne l’homosexualité, les sexologues accueillent des personnes (surtout des jeunes gens) se posant des questions sur leur orientation sexuelle, et il n’est pas si ancien le temps où l’on proposait des thérapies pour changer d’orientation sexuelle, notamment aux Etats-Unis1.
Sexologie, psychanalyse, approches et objectifs thérapeutiques
L’autre point sur lequel les travaux d’André Béjin doivent être nuancés, c’est celui qui concerne la concurrence et l’opposition entre sexologie et psychanalyse. André Béjin, en s’appuyant quasi-exclusivement sur les travaux de William Master et Virginia Johnson, considère que les deux disciplines thérapeutiques s’opposent radicalement2. Compte tenu du modèle thérapeutique proposé par les deux chercheurs états-uniens sur lequel il appuie sa réflexion, ceci est tout à fait cohérent. Mais la question est de savoir si ce modèle est le seul qui se soit développé en France. Bien entendu, comme dans tout le champ de la santé mentale et des prises en charge psychologiques, les théories comportementales puis cognitivo-comportementales séduisent de nombreux sexologues dès les années 1970 et la traduction des travaux américains3. Mais si cette influence sur la sexologie est certaine, celle de la psychanalyse reste très importante dans le contexte français où elle est particulièrement bien implantée et où, comme le soulignent Alain Giami et Patrick de Colomby, elle exerce une hégémonie intellectuelle4. Par ailleurs, même aux Etats-Unis, la sexologue Helen S. Kaplan proposait, dès la fin des années 1970, de concilier approches psycho-dynamique et comportementale5. Les sexologues français n’ont donc pas entièrement épousé les conceptions de la psychologie behaviouriste américaine et les aspects
En illustration de ce propos, on pourra regarder le très beau film de Todd Haynes, Far from Heaven (Loin du paradis) sorti en 2002. Le « marché » de la « réorientation sexuelle » ayant été abandonné par la médecine et la psychologie, il a été récupéré par un certain nombre de mouvements religieux, proches du développement personnel tel que le mouvement d’inspiration chrétienne « Life Stream » qui a essaimé partout dans le monde depuis les Etats-Unis (en France, il se présente sous le nom « Torrents de vie »). Si les homosexuels échappent désormais à la médecine et à la sexologie, les autres « pervers » et délinquants sexuels, eux, continuent d’être soumis aux méthodes de redressement issus du cognitivo-comportementalisme. Sur ce dernier point, on lira la description fascinante et terrifiante de Sylvère Lotringer d’une clinique américaine de sexo-thérapie où l’on prend en charge les délinquants sexuels (Lotringer, 2006).
André Béjin synthétise cette opposition dans un tableau en deux colonnes où les « thérapies psychanalytiques » et les « thérapies comportementales (sexologiques) » sont comparées selon plusieurs critères (en ligne dans le tableau) comme les « objectifs », les « principes thérapeutiqu inconscients de la sexualité restent un objet d’intérêt important pour les praticiens. Certains ont d’ailleurs développé des modèles inspirés de la psychanalyse pour la prise en charge en sexologie. Ainsi, des sexologues québécois ont développé la « sexo-analyse », tandis que le couple Claire Gellman-Barrou / Robert Gellman défendaient une « sexothérapie analytique »1. L’influence des approches psycho-dynamiques est donc loin d’être négligeable. Toutefois si la psychanalyse constitue un corpus de référence théorique pour la sexologie, les différentes thérapies sexuelles ne reprennent pas forcément le cadre et le dispositif analytiques.
La pratique actuelle de la sexologie2 est en fait caractérisée par une très grande diversité dans les approches thérapeutiques (organiques et/ou psychothérapeutiques) et les techniques utilisées (prescriptions médicamenteuses, thérapies psychodynamiques, hypnose, relaxation, thérapies comportementales, etc.)3. Dans l’enquête de 1999 sur la profession de sexologue, le diagnostic inclut, le plus souvent et par ordre décroissant, un bilan de la vie sexuelle, un bilan psychologique et un examen clinique. Les pratiques thérapeutiques consistent le plus souvent en une thérapie de couple, un conseil conjugal, une psychothérapie non analytique. Les interventions médicalisées sont en toute logique pratiquées par les médecins. La durée de la prise en charge est brève (en moyenne quatre consultations)4.
En dehors des traitements médicaux (et chirurgicaux) qui se développent de manière importante depuis l’apparition du Viagra® et qui agissent sur la physiologie, les différentes thérapies sexologiques s’appuient toutes sur un travail aux niveaux psychologique, corporel et relationnel. Certains auteurs parlent successivement de biosexologie (qui s’occupe des causes organiques et des solutions médico-chirurgicales) et de psychosexologie (qui s’intéresse aux causes et aux solutions psychologiques et relationnelles) pour différencier les deux grandes approches en sexologie. Du point de vue psychologique et relationnel, les approches suivent plusieurs voies : celle de l’apprentissage du comportement érotique et la valorisation de l’expérience corporelle, celle de l’exploration des déterminismes inconscients et celle de l’exploration de l’imaginaire érotique conscient5.
En définitive, ce qui réunit les différentes approches thérapeutiques c’est l’objectif de la thérapie: La thérapie sexuelle (…) se préoccupe avant tout d’améliorer le fonctionnement sexuel. (…) toute la stratégie thérapeutique vise principalement à atteindre l’objectif essentiel de la thérapie sexuelle : vaincre le symptôme sexuel. »1
Quelle que soit l’approche envisagée et pour ce qui concerne les troubles de la fonctionnalité sexuelle », la disparition du symptôme est ainsi l’objectif prioritaire de toutes les approches en sexologie. Cela va à la fois avec l’idée que si le trouble sexuel a des causes plus profondes, la reprise rapide d’une sexualité pourra peut-être permettre d’aider au règlement de ces causes plus profondes et en même temps avec l’idée inverse que, contrairement à ce que suppose la psychanalyse ou la thérapie de couple, les troubles sexuels ne sont pas forcément les symptômes de problèmes plus profonds2. Cette focalisation sur le symptôme rapproche l’objectif de la sexologie des stratégies de médecine allopathique. Pour Alain Giami et Patrick de Colomby : La sexologie constitue une forme originale de pratique médicale influencée par les psychothérapies et incluant des approches médicales de différents types, dans un même cadre clinique. »3
La sexologie dans le champ des thérapies sexuelles et conjugales
C’est donc bien sur les objectifs de la thérapie que la sexologie se distingue d’une part des thérapies psychodynamiques individuelles (en particulier de la cure psychanalytique) et d’autre part des thérapies de couple4, inspirées de la psychanalyse et des théories systémiques. Psychothérapies psychodynamiques et thérapies de couple ont en effet pour objectif la résolution des problèmes personnels et/ou relationnels dont les problèmes sexuels ne seraient qu’une manifestation symptomatique. Au croisement de la prise en charge sociale des couples et de l’éducation sexuelle, la sexologie peut également croiser les préoccupations du conseil conjugal5 bien qu’il propose une offre qui n’est pas, à proprement parler, de l’ordre du soin. Sur le plan des prises en charge somatiques, elle subit, en particulier pour les recours de première intention, la concurrence des spécialités médicales, notamment de l’urologie et de l’andrologie, mais aussi de la médecine générale, approches dont l’offre thérapeutique a été renforcée avec le développement des traitements médicamenteux des troubles sexuels. Enfin, elle est aussi en concurrence avec les approches alternatives en matière de prise en charge de la sexualité et de la conjugalité qui constituent bien une offre thérapeutique, même si elles ne sont pas reconnues institutionnellement. Il en est ainsi des offres de développement personnel (comme par exemple les stages collectifs d’épanouissement sexuel) ou des thérapeutes « néo-traditionnels », par exemple des « marabouts » qui, à grand renfort de petits prospectus distribués dans les boîtes aux lettres, ciblent particulièrement les problèmes sexuels, conjugaux et affectifs.
La construction sociale des troubles sexuels
Il semble évident que les hommes ont depuis toujours utilisé et inventé des mots pour désigner les maux auxquels ils étaient confrontés. Par ailleurs, toutes les disciplines psycho-médicales ont besoin de catégoriser les maladies ou troubles qu’elles se proposent de soigner ou de prendre en charge. Sans ces catégories, les praticiens ne pourraient ni parler de ni agir sur ce qui constitue l’objet de leur pratique. La distinction des maladies est donc au cœur de la pratique médicale, dans la mesure où c’est ce qui permet de convertir l’expérience individuelle et unique de la maladie en une entité catégorielle et qui va permettre de confronter les cas entre eux et les différentes affections entre elles. Cela permet de passer du particulier au général1.
Bien que la création des catégories médicales relève pour partie de l’activité médico-scientifique, sociologie, histoire et philosophie ont largement montré que ce processus était influencé par le contexte (scientifique bien-sûr, mais aussi social, politique et économique) dans lequel il s’opère et que la création des catégories n’était pas le seul fait des acteurs médico-scientifiques mais que de nombreux autres acteurs pouvaient intervenir dans la définition des maladies et des troubles. Au-delà de l’existence naturelle (ou non) de l’objet auquel elles se rapportent, les catégories nosographiques ont donc une histoire et c’est dans cette perspective que leur genèse est devenue un objet largement exploré par les sciences sociales de la santé1.
A partir du moment où les difficultés touchant à la sexualité sont les objets de pratiques thérapeutiques, leur catégorisation n’échappe pas à ce processus et comme les autres catégories nosographiques, leur élaboration a une histoire. Celle-ci est, pour ce qui concerne la période contemporaine, largement ancrée dans les réflexions de la médecine et de la psychiatrie du 19ième siècle concernant la sexualité et elle participe de ce que l’on appelle « la médicalisation de la sexualité ». Cette notion n’étant pas sans poser de problème, il nous semble utile d’en exposer les limites et les ambiguïtés.
La « médicalisation de la sexualité » ?
Comme nous l’avons vu dans notre précédent chapitre, l’histoire de la sexualité est confondue avec l’histoire de sa médicalisation, le terme même de sexualité relève au départ du monde médical2 et en un sens, comme le note Alain Giami, l’expression de « médicalisation de la sexualité » relève du pléonasme3. L’expression désigne donc en premier lieu la problématisation médicale de la sexualité, qui conduit à sa modernisation »4 et sa « rationalisation »5, processus lié plus largement à celui de la médicalisation de la société6, lui-même fortement lié au procès de civilisation7.
Toutefois, l’expression ne désigne pas seulement le processus de formation du concept de sexualité mais aussi un ensemble de phénomènes touchant à la (re-)définition et à la prise en charge par la médecine de problèmes, d’objets, de comportements, de « types » de gens, etc. ayant un rapport avec (le champ de) la sexualité »8. Ainsi, dans cette acception, la médicalisation de la sexualité est un mouvement qui a concerné et concerne aussi bien la définition des perversions et des déviations sexuelles, que le traitement des maladies vénériennes, le contrôle des aspects reproductifs (accouchement, contraception, stérilisation), la définition des troubles sexuels, de la santé sexuelle, etc. Une série de problèmes ou de comportements autrefois étrangers à la médecine sont intégrés dans son champ. Historiquement, certains problèmes pouvaient être appréhendés d’une autre manière par la religion (sodomie), certaines autres par le champ judiciaire (par exemple l’impuissance1 ou la prostitution au 19ième siècle2). L’intégration dans le champ médical n’empêche pas l’intégration du problème dans un autre champ. Ainsi, par exemple, le crime sexuel, appréhendé par la législation, est également sujet à une médicalisation par le biais de l’injonction thérapeutique faite aux criminels sexuels3. Certains « problèmes », comme l’homosexualité, ayant été autrefois médicalisés ont été progressivement démédicalisés, mais sont actuellement soumis à d’autres formes de médicalisation. On assiste ainsi à une remédicalisation de l’homosexualité suite à l’épidémie de sida4.
L’une des difficultés avec la notion de « médicalisation de la sexualité »5, c’est la pluralité des utilisations qui en sont faites et les contradictions qui existent entre les différents usages de la notion. A l’intérieur même du champ de la santé sexuelle et de la sexologie, Alain Giami a noté que différents agents se référaient à la médicalisation de la sexualité sans qu’il y ait un consensus sur son sens et sur les jugements positifs ou négatifs associés au phénomène6. L’examen de quelques unes des très nombreuses publications sur la « médicalisation de la sexualité » et des problèmes en rapport avec elle, s’il éclaire telle ou telle dimension du phénomène, tel ou tel aspect historique, laisse apparaître que dans l’expression « médicalisation de la sexualité » sont confondus, selon les auteurs et parfois selon les articles du même auteur, des réalités et des phénomènes distincts qui ont, bien sûr, tous à faire avec la médicalisation et la sexualité mais qui embrassent des périodes historiques, des pratiques, des postulats théoriques bien différents les uns des autres7. En somme, sous le chapeau de médicalisation de la sexualité » sont regroupés, et parfois dénoncés, des processus et des pratiques telles que la thérapisation, la pathologisation des comportements, la bio-médicalisation, la surmédicalisation de la prise en charge, le recours à la médication, la pharmacologisation, etc.
Ainsi, actuellement, dans le cas des difficultés sexuelles, le concept est le plus souvent utilisé pour désigner l’emprise des conceptions organicistes et biologiques et pour mettre en lumière le rôle de plus en plus important que joue l’industrie pharmaceutique dans l’approche des « troubles sexuels ». L’arrivée du Viagra® a ainsi donné lieu à de nombreux articles1 qui tendaient à en faire le signe de la médicalisation de l’impuissance et, plus généralement, de la sexualité masculine2, en insistant sur la nouveauté du phénomène. Il nous semble au contraire que c’est un domaine d’intervention ancien qui a toujours été le lieu d’innovations thérapeutiques. Comme le dit Michel Foucault : Alors que dans l’art érotique, ce qui est médicalisé, c’est plutôt les moyens (pharmaceutiques ou somatiques) qui servent à intensifier le plaisir, on a, en Occident, une médicalisation de la sexualité elle-même comme si elle était une zone de fragilité pathologique particulière dans l’existence humaine. »3
Ainsi, il ne nous semble pas que le Viagra® soit réellement autre chose qu’un remède technico-pharmaceutique supplémentaire visant à « intensifier le plaisir ».