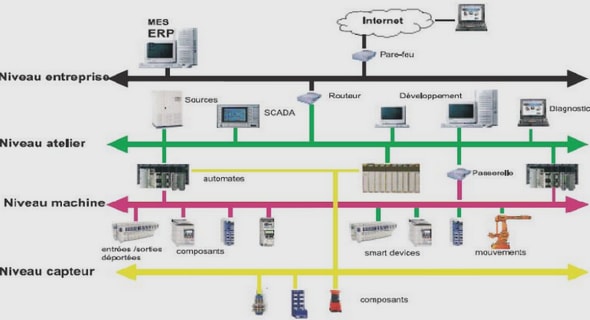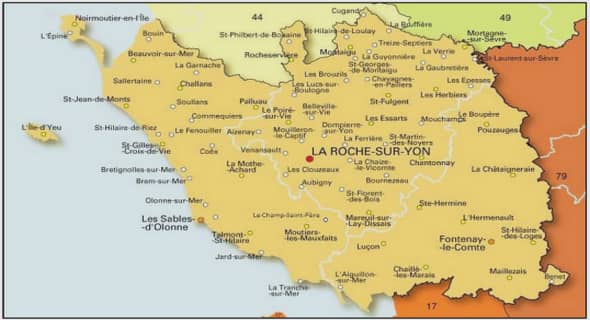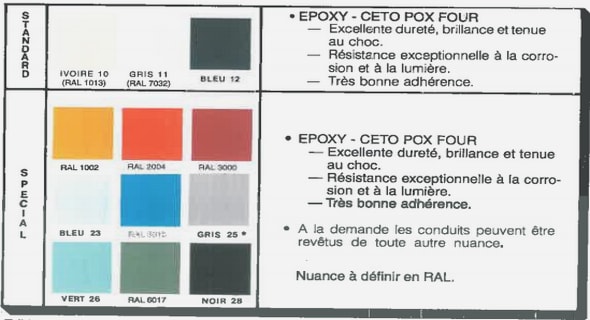Modélisation des sursauts gamma et de leurs
rémanences à l’ère des satellites Swift et Fermi
La surprenante découverte des satellites VELA
La découverte des sursauts gamma s’est faite dans le cadre d’un projet à vocation non astrophysique : le programme américain de veille militaire VELA 2 . Le but de cette mission était de contrôler la mise en application du traité d’interdiction partielle des essais nucléaires, signé le 5 août 63 à Moscou. Ce traité intervient peu de temps après la crise de Cuba – début de la « détente » – et fut immédiatemen ratifié par les États-Unis, l’URSS et le Royaume-Uni. Il prévoyait l’interdiction de tout essai nucléaire dans l’atmosphère, dans l’espace ou sous l’eau – seuls les essais sous-terrains restaient autorisés. Le dispositif expérimental de VELA reposait sur une constellation de satellites (12 au total) équipés de détecteurs X et gamma, la première paire (voir Fig. 1.2) ayant été lancée le 17 octobre 63. Le réseau ainsi formé permettait une couverture complète de l’environnement terrestre (aussi bien vers la Terre que vers l’espace), mais surtout rendait possible la localisation d’un évènement. En effet, le temps d’arrivée des photons au niveau des différents satellites, espacés les uns des autres par des dizaines de milliers de kilomètres, permettait de contraindre la direction de la source par méthode de triangulation (précision de l’ordre de la dizaine de degrés). Les données étant toujours classifiées, on ne se sait pas si VELA a effectivement détecté des essais nucléaires – la France n’avait pas signé le traité et poursuivait ses campagnes d’essais atmosphériques, au Sahara, puis en Polynésie jusqu’en 74. Mais le 2 juillet 67, un flash intense et très bref (quelques secondes) de photons gamma est détecté en provenance de l’espace, sans aucune similitude avec la signature attendue d’un essai nucléaire (la courbe de lumière est représentée Fig. 1.3). D’autres évènements semblables seront détectés par VELA (73 flashs sur environ 10 ans d’activité), confirmant l’origine naturelle de ces évènements – appelés par la suite gamma-ray bursts ; sursauts gamma en français. Les localisations étaient également suffisamment précises pour pouvoir exclure toute origine terrestre, lunaire ou solaire. La découverte n’est annoncée qu’en 73 par Ray Klebesadel et son équipe du laboratoire de Los Alamos, et publiée dans un article de l’Astrophysical Journal intitulé « Observations of Gamma-Ray Bursts of Cosmic Origin » (Klebesadel et al. 73).
Discussion sur l’échelle de distance des sursauts
Une origine galactique semble l’hypothèse la plus raisonnable. La découverte des sursauts gamma, publiée en 73, suscite rapidement l’intérêt de la communauté scientifique, avec le lancement d’autres satellites gamma (cette fois-ci, à vocation astrophysique), et une grande effervescence quant à l’interprétation théorique de ces phénomènes. Jusqu’en 97, la distance des sursauts restait inconnue, ce qui donna lieu au développement de deux grandes familles de modèles : ceux qui plaçaient les sursauts au sein de notre galaxie et ceux qui les rejetaient à distance cosmologique. Jusqu’au début des années 90, les modèles galactiques restaient les plus étudiés, car l’hypothèse d’une origine cosmologique impliquait une énergie totale rayonnée colossale 3 . La plupart des scénarios galactiques reposaient sur des phénomènes explosifs ayant lieu à la surface d’étoiles à neutrons, inspirés des modèles de sursauts X produits par des binaires accrétantes. Ce type de scénario était compatible avec les principales caractéristiques connues à cette époque : (i) une durée brève et des échelles de temps pouvant atteindre 10 ms, en accord avec la petite dimension de la source (ii) les flux observés, étaient bien reproduits par les distances et les énergies invoquées (iii) la détection de raies cyclotron dans le spectre de certains sursauts. Ce dernier point restait controversé mais semblait être clairement confirmé à la fin des années 80 par les résultats de la mission japonaise Ginga. L’interprétation des raies d’absorption détectées entre 10 et 100 keV comme une signature du processus cyclotron nécessitait des champs magnétiques de l’ordre de 1013 G, et représentait un argument fort en faveur d’évènements ayant lieu à la surface d’étoiles à neutrons magnétisées. Par contre, les différentes missions semblaient également indiquer que les sursauts se répartissaient de manière isotrope sur le ciel. Cette caractéristique plaidait plutôt en faveur des modèles cosmologiques, et conduit B. Paczynski à défendre l’idée d’une origine cosmologique, dès 86. Cependant l’isotropie restait compatible avec les modèles galactiques, en supposant que seuls les sursauts produits par les étoiles à neutrons suffisamment proches – à une distance inférieure à l’épaisseur du disque galactique – pouvaient être détectés (voir Fig. 1.5).
BeppoSAX : premières détections de contreparties en optique
Jusqu’à présent les développements théoriques se basaient sur des observations obtenues uniquement dans le domaine gamma. La difficulté à localiser précisément et rapidement un sursaut gamma, compliquait grandement la détection d’hypothétiques contreparties à plus basse énergie – du domaine X au domaine radio. Une localisation difficile. Une première méthode de localisation – d’abord utilisée par VELA – consistait à collecter les différentes données d’un même sursaut, observé par plusieurs satellites. Le décalage temporel dans la réception du signal permettait de contraindre la direction de la source par simple triangulation. Deux satellites permettent de restreindre le domaine admissible à un anneau sur le ciel. Un troisième satellite donne un second anneau, les positions possibles de la source étant alors restreintes à deux points (voir l’illustration Fig. 1.7). Enfin un quatrième satellite permet de lever toute dégénérescence, en éliminant l’un des deux points restants. Les différents satellites mis à contribution se regroupent au sein du programme IPN (InterPlanetary Network) 6 . Suivant la longueur des lignes de base reliant les satellites, cette stratégie peut fournir des localisations très précises (parfois de l’ordre de la seconde d’arc). Néanmoins elle a comme désavantage de ne pouvoir s’affranchir d’un long délai d’attente (le temps de collecter toutes données), délivrant une mesure, au mieux, quelques jours après la détection du sursaut. Une seconde méthode de localisation – utilisée par BATSE – consistait à disposer plusieurs capteurs autour d’un même satellite, mais avec des orientations différentes. Le différentiel de flux reçu au niveau des différents détecteurs permettait alors de contraindre la direction de la source. Cette méthode est plus rapide, mais a une bien moindre précision, de l’ordre du degré. Une si grande boîte d’erreur rendait très difficile la recherche d’une contre-partie dans le domaine optique ou radio.
s |