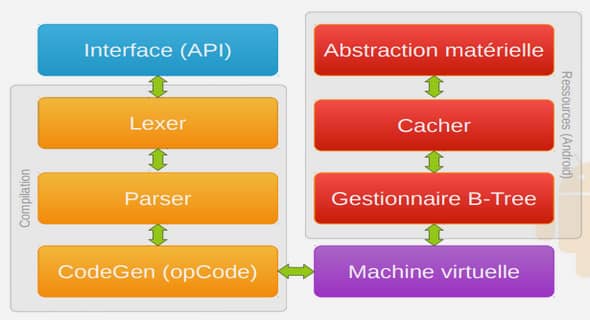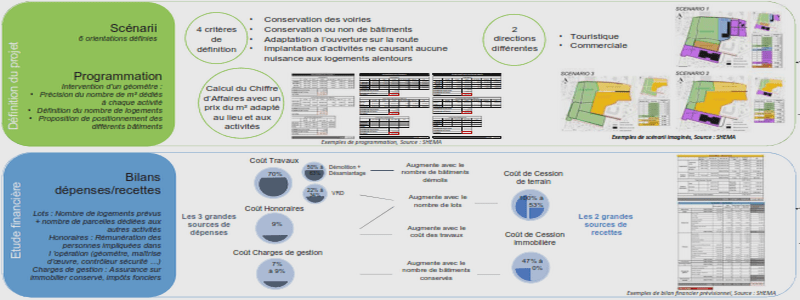HISTOIRE SOCIALE DES INFRACTIONS SEXUELLES A PARTIR DE LA REVOLUTION
Dans la France d’Ancien Régime, les traités de matière criminelle, ordonnances et édits ecclésiastiques, les parlements, confondaient souvent rapt et viol (Gaudillat Cautela, 2006, 2007 26). Comme dans l’ancienne loi romaine justinienne, le rapt supposait le viol de femmes ou de jeunes filles (Joye, 2011 : 38 27 ), de sorte qu’aucune ordonnance ne punissait le viol en tant que tel. Rarissimes étaient les jugements pour viols d’enfant : on compte en moyenne trois viols tous les 10 ans au parlement de Paris durant tout le XVIIe siècle 28. L’appréhension et la punition du viol étaient indissociables de la défense d’un ordre social fondé à la fois sur le mariage religieux et sur la notion d’ordre de naissance. Cette défense était très fortement sexuée : le viol de fillette était puni systématiquement de la peine capitale, par la roue ou le feu (Garnot, 2000 : 68 29 ) et la fillette victime était entachée par l’opprobre social, la honte, le déshonneur et le dénigrement, à la différence des garçons victimes de viol, comme l’a montré l’historien Didier Lett, dans la Bologne du XVème siècle (2015 : 212). En un mot, l’Ancien Régime chrétien, qui ne distinguait pas le politique du religieux, protégeait surtout l’honneur des familles, la sacralité du mariage et la virginité des filles 30.
La rupture de la Révolution Française : référence aux mœurs et à la pudeur
Les législateurs révolutionnaires, puis ceux du XIXème siècle ont posé les bases d’un changement. D’abord pour considérer le viol non plus comme une atteinte à la propriété d’autrui, mais comme une atteinte à l’intégrité de la personne (Chesnais, 1981). Ensuite pour sortir de la suspicion qui a pesé longtemps sur la parole de l’enfant 31. Enfin pour établir différents seuils de qualification des crimes et délits sexuels, appréhendés non plus à partir du genre, mais des âges et des liens d’ascendance ou d’autorité.
Le premier Code pénal de 1791 : crimes de viol et rapt par violence, délit d’outrage aux bonnes mœurs sur la liberté de conscience ne peut reprendre à son compte dans le droit la conception catholique du bien et du mal, ni la référence au péché ; le premier code pénal distingue désormais le juste, le légal et le bon (Ricœur, 1991).
C’est un premier bouleversement des référentiels dans cet ordre laïc qui sépare « le droit d’avec la morale et la religion » (Lochak, 1994 : 44). Ce faisant, l’inceste 33, considéré comme un péché et un problème d’ordre moral, disparaît du code pénal. Les relations sexuelles incestueuses entre adultes consentants ne sont dès lors plus sanctionnées par la loi (Poumarède, 1987). Par ailleurs, le rapt de séduction 34 , la sodomie 35 et l’adultère 36 cessent d’être incriminés en tant que tels, et les législateurs révolutionnaires ne retiennent que trois infractions sexuelles : les crimes de viol, de rapt par violence, et le délit d’outrage aux bonnes mœurs. La violence spécifique exercée sur les enfants, est prise en compte à travers la référence à la victime « fille âgée de moins de 14 ans accomplis » : dans ce cas, la peine est doublée.
Le code pénal criminel du 6 octobre 1791 ne connait en matière sexuelle que deux crimes, le viol et le rapt, qu’il définit aux articles suivants :
Article 29 : « Le viol sera puni de six années de fers »
Article 30 : « La peine portée en l’article précédent sera de douze années de fers, lorsqu’il aura été commis dans la personne d’une fille âgée de moins de quatorze ans accomplis, ou lorsque le coupable aura été aidé dans son crime, par la violence et les efforts d’un ou de plusieurs complices »
Article 31 : « Quiconque aura été convaincu d’avoir, par violence et à l’effet d’en abuser ou de la prostituer, enlevé une fille au-dessous de quatorze ans accomplis, hors de la maison des personnes sous la puissance desquels est ladite fille, ou de la maison dans laquelle lesdites personnes la font élever ou l’ont placée, sera puni de la peine de douze années de fers »
Dans le droit de l’Ancien régime, l’inceste est un commerce illicite qui a lieu entre les personnes qui ne peuvent se marier en raison de leur parenté ou alliance ; la peine de l’inceste était la peine de mort, soit qu’il eut été commis entre ascendants et descendants, soit entre frères et sœurs, soit entre beaux-pères et belles-filles, beaux-fils et belles-mères. L’inceste des beaux-frères et belles-sœurs, oncles et nièces n’était condamné que d’une peine arbitraire.
Le rapt de séduction « consistait selon les termes de l’article 1er de la déclaration du 22 novembre 1730, dans le fait d’avoir séduit et suborné par artifices, intrigues ou mauvaises voies, des fils ou filles (même des veuves) mineurs de 25 ans, pour parvenir à un mariage, à l’insu ou sans le consentement, des pères, mères ou tuteurs ». La peine était très sévère, puisque le coupable était condamné de peine de mort. Chauveau Adolphe et Faustin Hélie, Théorie du code pénal.
Le législateur révolutionnaire a intégré le crime de viol, mais sans le définir. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments constitutifs du crime, sa nature, sa gravité et les conséquences qu’il engendre pour la victime et sa famille. La jurisprudence l’assimile à un coït complet, une pénétration vaginale imposée par un homme sur une femme 37 , ce qui minimise la répression des viols sur enfants. De fait, les procédures pour viols d’un enfant et pour inceste sont très rares à cette époque. Dans son Histoire du viol, Georges Vigarello souligne que les plaintes de viol sur des petites filles aboutissent rarement à une condamnation à la fin du XVIIIème siècle : 70 % des accusés sont reconnus non-coupables 38, 2 ou 3 jugements de viols sont prononcés en 1800 au tribunal criminel de Versailles 39. A cette époque le taux de poursuite pour crimes sexuels est faible (Alline, 1987 : 155 40), les arrangements et lettres de cachet qui protégeaient les marquis, les nobles, sont nombreux ; on condamnait peu les riches commerçants, la plainte d’une servante était quasiment impossible.
En outre, le code criminel ne dissocie pas les critères d’âge et de sexe de la victime. Ils sont aggravants du viol et constitutifs du rapt par violence. La gravité du crime tient à l’abus d’innocence d’une jeune fille de moins de 14 ans. Les deux critères, âge et genre, élèvent la peine des deux crimes à la même sévérité : 12 années de fers 41. Cette peine identique rend peu perceptible la distinction des violences sexuelles opérée par le Code : dans l’opinion, les deux crimes sont encore très souvent confondus comme dans l’ancien droit (Chauveau, Hélie, 1871 : 371). Vraisemblablement on est encore proche de la vision du viol comme un vol contre la propriété d’un homme, chef d’une famille et responsable de l’honneur d’un nom. La violence faite à la femme ou à la jeune fille, est en fait une attaque contre le mari, le père 42.
Le décret du 19 juillet 1791, code de police correctionnelle a créé le délit d’outrage :
Article 8 : « Ceux qui seraient prévenus d’avoir attenté publiquement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions déshonnêtes, par exposition ou vente d’images obscènes, d’avoir favorisé la débauche ou corrompu des jeunes gens de l’un ou de l’autre sexe, pourront être saisis sur le champ et conduits devant le juge de paix, lequel est autorisé à les faire retenir jusqu’à la prochaine audience de la police correctionnelle […] si le délit est prouvé, les coupables seront condamnés selon la gravité des faits à une amende de 50 à 500 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois […] Quant aux personnes qui auront favorisé la débauche ou la corruption des jeunes gens de l’un ou l’autre sexe, seront, outre l’amende, condamnées à une année de prison 43».
Ce délit d’outrage est centré d’une part sur la pudeur « des femmes » et de l’autre sur l’innocence des jeunes gens « de l’un et l’autre sexe ». Ce choix est tout à fait révélateur de l’amorce du processus de « normalisation des mœurs » décrit par les juristes François Ost et Michel van de Kervoche (1994), avec d’un côté les femmes « agents privilégiés de sauvegarde de bonne mœurs » et de l’autre, la jeunesse, objet de protection spécifique 44 . Ce délit d’outrage témoigne de la hiérarchie des violences sexuelles puisqu’il est jugé en tribunal correctionnel tandis que le viol et le rapt le sont en tribunal criminel.
Les archives ont permis aux historiens de constater que les juges ont retenu ce délit d’outrage pour des faits de nature très différente, tel que par exemple : les propositions sexuelles faites par un voisin à une fille de 8 ans, le comportement d’une jeune femme découverte couchée avec des militaires dans une caserne, ou encore celui d’un dessinateur accusé d’avoir fouetté violement une enfant de 11 ans sans la déflorer, ou de quatre hommes accusés d’avoir violé la nuit une femme seule à son domicile 45. Tout se passe comme s’il était encore difficile d’établir des seuils de la violence sexuelle distinguant nettement entre la proposition sexuelle, l’attouchement sexuel et le viol. Un autre phénomène a été observé par les historiens, celui de l’usage du délit d’outrage par les juges pour déclasser certains faits de viols difficiles à caractériser. Ainsi, cette époque, les actes correctionnels sont les plus nombreux dans les jugements pour violences sexuelles et rares sont les viols jugés en tribunal criminel.
En somme, le premier code criminel pose les bases d’une répression nouvelle contre les violences sexuelles en distinguant de nouvelles hiérarchies dans les infractions et instances de jugements. Au plus haut degré de gravité, se trouvent les violences sexuelles commises sur les filles victimes de moins de 14 ans. A cette époque prime la stabilité des liens matrimoniaux et l’honneur des familles plus que la protection de l’intégrité de l’enfant ou de la victime. Le code pénal Napoléonien va introduire une véritable rupture, sous l’égide de sa nouvelle référence « aux mœurs ».
Le code Napoléonien de 1810 : les attentats aux mœurs
Un véritable bouleversement des référentiels est à l’œuvre dans le code civil de 1804 qui érige les mœurs comme « ciment de l’édifice social » (Géraud, 1994 : 72 46). Il ne les définit pas mais dispose à son article 6 que « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs 47». Le droit n’échappe pas au processus global de
civilisation des mœurs », tel que décrit par Norbert Elias (2005) et il est mis à contribution comme instrument de normalisation des comportements et des attitudes 48. Ainsi, on a d’un côté, un code civil qui promeut les bonnes mœurs dans le mariage et de l’autre, un code pénal censeur des mauvaises mœurs, qui protège la stabilité des liens matrimoniaux (Coste, 1997).
Le code pénal Napoléonien de 1810, qui distingue désormais les crimes et délits contre la chose publique des crimes et délits contre le particulier, regroupe pour la première fois les infractions sexuelles au sein d’un même chapitre : « les attentats aux mœurs ». D’une part, on retrouve les offenses à la pudeur tels que le délit d’outrage public à la pudeur (article 330), les crimes de viol et d’attentat à la pudeur (articles 331 à 333), le délit d’excitation de mineurs à la débauche (articles 334 et 335) ; d’autre part les offenses à l’institution matrimoniale, tel que l’adultère et la bigamie 49 (articles 336 à 340), mais aussi l’enlèvement de mineur (article 354) prévoyant le cas où la jeune fille aurait consenti à son propre rapt 50. Ce n’est plus la débauche qui est alors réprimée mais l’atteinte faite à l’honneur de la famille.
Nous en tenant aux infractions d’outrage public à la pudeur, de viol et d’attentat, d’excitation de mineur à la débauche, nous allons voir comment progressivement elles se sont étendues et précisées tout au long du XIXe siècle.
La nouvelle infraction d’outrage public à la pudeur apparaît à l’article 330 du code pénal. Elle est un délit et non un crime.
Article 330 du code pénal du délit d’outrage public à la pudeur « Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an, et d’une amende de seize francs à deux cents francs ».
Elle est caractérisée par son caractère « public », ce qui signifie que les mêmes faits, commis en privé, ne seraient pas punis. L’entrée du concept de « pudeur » est significative de ce souci de morale laïcisée dans le code pénal. La loi ne définit pas l’infraction, mais la jurisprudence retient plusieurs éléments constitutifs, dont un fait physique (acte, attitude ou geste) de nature à offenser la pudeur d’autrui, sans violence 51, commis publiquement et de façon volontaire. Le législateur n’ayant pas défini la notion juridique d’outrage à la pudeur, son champ d’interprétation est demeuré assez large. Ce qui a permis de réprimer nombre d’abus sexuels sur enfant commis sans violence (dont des viols) comme l’ont mis en exergue des travaux d’historiens (Dessertine, 1999 ; Ambroise-Rendu, 2016).