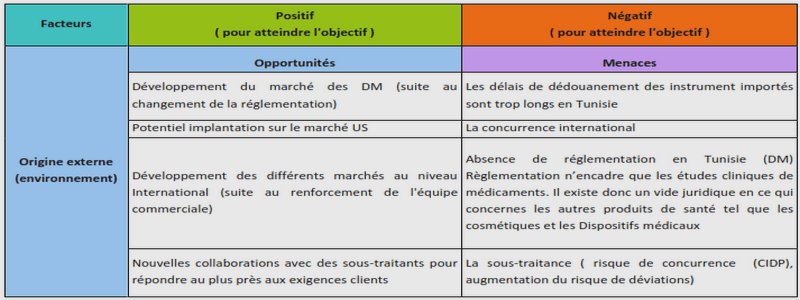Les conséquences de l’obésité
Cette thèse étudie les conséquences de l’obésité dans différents domaines : le travail et l’emploi (chapitre 1), l’usage du temps (chapitre 3) et la satisfaction/ le bonheur (chapitres 2 et 4). Elle discutera l’impact de l’obésité sur la santé (la santé étant une variable de contrôle importante, cf. infra) mais on laissera de côté l’effet sur les dépenses de santé. Il convient cependant de rappeler que l’obésité a un effet important sur les dépenses de santé. En France, son coût social atteindrait 20 milliards d’euros par an, soit 1 % du PIB (Caby, 2016), ce qui est équivalent au coût social du tabac ou de l’alcool.
Les conséquences de l’obésité seront étudiées tant à une échelle nationale qu’à l’échelle de plusieurs pays. Ainsi, les chapitres 1, 2 et 3 traitent des données similaires, à savoir des bases portant sur un seul pays (la France pour les chapitres 1 et 3, le Royaume-Uni pour le chapitre 2), alors que le chapitre 4 utilise des données portant sur plusieurs dizaines de pays.
Les chapitres 1 et 2 sont indépendants, alors que le chapitre 3 repart de deux constats réalisés aux chapitres 1 et 2 : d’une part, les femmes obèses sont moins souvent en emploi et d’autre part, les personnes en couple avec une personne de même corpulence sont plus satisfaites. L’une des explications avancées dans la littérature est que cela facilite le temps de loisir en commun et favorise la synchronisation des emplois du temps. Dans le chapitre 3, on examinera donc comment est utilisé, au niveau individuel, le temps supplémentaire dégagé et, au niveau des couples, si le temps de loisir en commun augmente quand la corpulence des individus est identique. Enfin, le chapitre 4 s’appuie sur le fait que les conséquences de l’obésité ne sont pas uniformes : elles sont notamment plus fortes pour les femmes (cf. chapitres 1 et 2). Dans ce chapitre, on analyse l’existence de normes de corpulence qui pourraient expliquer cela. A partir de ces normes, on reconstruit des groupes de pairs, et on examine les effets d’un écart par rapport à ces groupes.
Impact de la corpulence sur le marché du travail en France
S’il est possible de mettre au jour une corrélation négative entre le salaire/le chômage et la corpulence, il est plus délicat d’évaluer l’existence d’un impact causal allant de la corpulence vers le salaire ou l’emploi. D’une part, il existe un risque important de cau-salité inverse, notamment si des revenus plus faibles augmentent le risque d’être obèse. D’autre part, le risque de variables omises est également important (par exemple, les ca-pacités cognitives peuvent affecter la probabilité d’avoir un emploi et la capacité à traiter les informations concernant la corpulence). Plusieurs études ont mis font apparaître un impact négatif de l’obésité sur le salaire (Cawley, 2004 ; Lindeboom et al., 2010 ; Brunello et d’Hombre 2007, Böckerman et al., 2019) ou l’emploi (Morris, 2007 ; Grève , 2008 Lin-deboom et al., 2010, Böckerman et al., 2019), grâce à différentes techniques d’estimations. Plusieurs études recourent à des variables instrumentales, comme le poids d’un membre de la famille (Averett et Korenman, 1996 ; Cawley, 2004 ; Brunello et d’Hombres, 2007) ou la présence de gênes favorisant l’obésité (Grève, 2008 ; Böckerman et al., 2019). D’autres études utilisent le poids régional (Morris, 2006 et 2007).
A ce jour, il semblerait qu’aucune étude causale n’ait été réalisée pour la France. Dans le chapitre 1, qui reprend un article publié avec Élise Coudin dans la revue Économie et Statistique, les deux vagues de l’enquête Santé et Itinéraire Professionnel sont mobilisées pour étudier l’impact de l’obésité sur la probabilité d’être en emploi et le salaire horaire. Pour ce faire, nous mobilisons à la fois des variables instrumentales (la probabilité d’avoir fait du sport dans le passé) et la structure de panel via des effets fixes. Nous montrons qu’à niveau équivalent de compétences, les femmes obèses ont moins souvent un emploi que celles qui ne le sont pas (7 points de probabilité en moins d’avoir un emploi). Au contraire, chez les hommes, un indice de masse corporelle plus élevé est associé à une probabilité légèrement plus élevée d’avoir un emploi. Les salaires des hommes et des femmes obèses ne sont pas différents de ceux des personnes non obèses, et ce tout au long de l’échelle des salaires, mais un indice de masse corporelle plus élevé est associé à une très légère baisse du salaire chez les femmes. Par ailleurs, nous identifions un effet causal de la corpulence sur l’emploi plus fortement négatif pour les femmes, et nul pour les hommes. Les impacts causaux de l’obésité et de la corpulence sur le salaire horaire sont eux aussi négatifs mais leurs ampleurs ne sont pas toujours quantifiables en raison du manque de puissance de l’instrument. Ces résultats sont confirmés lorsque nous utilisons l’écart relatif de corpulence par rapport à la corpulence moyenne d’un groupe de référence plutôt que l’indice de masse corporelle.
Obésité et satisfaction
Les chapitres 2 et 4 s’intéressent à la question du lien entre la satisfaction et la cor-pulence, et à ses variations en fonction de la corpulence du conjoint (chapitre 2) ou d’un groupe de pairs au sens large 1 (chapitre 4). Ces deux chapitres répondent à un double objectif. D’une part, l’obésité ayant des conséquences en termes de santé, d’emploi ou de discrimination, on peut penser qu’elle a également un impact sur la satisfaction. Cet effet a été documenté dans plusieurs papiers (Oswald et Powdthavee, 2007 ; Katsaiti ; 2012 ; Stutzer et Meier, 2016). D’autre part, la satisfaction et ses variations en fonction du contexte sont souvent utilisées comme proxy pour démontrer l’existence d’effet de pairs. Ainsi, Clark et Étilé (2011) ont montré que l’impact de la corpulence sur la satisfaction pouvait varier en fonction du poids du conjoint. De même cet impact peut varier en fonc-tion de la corpulence moyenne du comté (Wadsworth et Pendergast, 2014) ou de la région (Blanchflower et al., 2009).
Le chapitre 2 repart et applique l’analyse proposée par Clark et Étilé (2011) pour le German Socio-Economic Panel sur des données britanniques (les trois premières vagues de l’enquête Understanding Society) et ajoute deux nouveautés. D’une part, dans certaines vagues de l’enquête, le poids et la taille ne sont plus déclarés, mais mesurés. D’autre part, d’autres mesures de la corpulence (le tour de taille, la masse graisseuse) sont disponibles, ce qui permet de pas se reposer uniquement sur l’IMC. Cela limite les problèmes liés à la mesure de la corpulence (cf. infra). On constate qu’il existe un effet négatif et signicatif de la corpulence sur la satisfaction pour les femmes, et que cet effet est en partie annulé lorsque que le conjoint est obèse. Pour les hommes, les résultats sont similaires, mais ne sont signiticatifs que pour certaines spécifications.
Le chapitre 4 examine à partir de deux vagues de l’enquête ISSP (International Social Survey Programme), à la fois les variations de satisfaction en fonction de la corpulence moyenne de différents groupes de pairs assez larges, mais également les représentations et les pratiques associées à la corpulence. En particulier, ce chapitre examine les différentes normes associées à la corpulence, et notamment les normes de genre. On constate alors que si les groupes de pairs ont une influence sur certaines pratiques (ici la volonté de perdre du poids), ils n’influencent pas la satisfaction individuelle. Par ailleurs, lorsque l’on contrôle par la santé, les effets négatifs de la corpulence sur la satisfaction sont le plus souvent non significatifs. Ces chapitres appellent deux commentaires méthodologiques.
– D’une part, les analyses présentées ne sont pas causales, en l’absence de stratégie permettant de régler les problèmes d’endogénéité. En particulier, il est possible qu’un faible niveau de satisfaction ait des impacts sur la corpulence. Par exemple, certains individus (y compris des personnes qui ne sont pas obèses) vont répondre à des émotions négatives par une plus grande consommation d’aliments (cf. Moskovich et al., 2011, pour une revue de cette littérature).
– Le bien-être est ici traité essentiellement à travers la satisfaction subjective, et dans le cas du chapitre 2 à partir de de certaines questions sur la santé mentale. Il s’agit donc d’une approche essentiellement hédonique. Cela revient à limiter la question du bien-être à celle de la satisfaction, en étudiant les impacts négatifs et positifs sur la satisfaction. Une analyse eudémonique, se concentrant sur l’engagement, l’es-time de soi, la capacité à donner du sens à sa vie ou la résilience (pour reprendre la typologie de Huppert et So, 2013), pourrait être intéressante dans le cas de la corpulence, même si les mesures hédoniques et eudémoniques sont fortement cor-rélées (cf. Clark et Senik, 2011). En effet, il est possible que la corpulence ait un effet au-delà de la satisfaction, et affecte par exemple l’estime de soi. Par exemple, Foster et Moore (2012) avaient montré que les adolescents américains obèses avaient une mauvaise estime d’eux-même, et des relations plus difficiles avec leurs parents et leurs camarades. Cependant, les données mobilisées ici ne permettent pas d’explorer cette dimension eudémonique.
Usage du temps
Le chapitre 3 mobilise les données de l’enquête Emploi du temps de 2010, pour essayer d’objectiver l’impact de la corpulence sur l’usage du temps au niveau individuel, et au niveau collectif.
– Le chapitre 1 permet de constater que les femmes obèses sont moins souvent en emploi en France. Il est intéressant d’examiner comment ce temps supplémentaire est alloué, et de manière plus générale d’examiner si la corpulence modifie la distribution du temps au niveau individuel. Dans ce chapitre, on montre que les femmes et les hommes obèses allouent davantage de temps au loisir, et notamment à la télévision, et pour les femmes à certaines tâches domestiques. On retrouve ainsi un résultat similaire à celui mis en avant dans la littérature analysant comment les gains de temps résultant de chocs exogènes (par exemple du fait de période de chômage ou des changements législatifs) sont alloués entre différents activités.
– Le chapitre 2 permet de voir que les individus sont plus satisfaits quand ils sont en couples avec une personne de même corpulence. Clark et Etilé (2011) avaient mis en avant un résultat similaire pour l’Allemagne, et avaient émis l’hypothèse que cela pouvait s’expliquer par un plus grand temps de loisir en commun. Cette hypothèse est donc testée dans le chapitre 3. On examine également plus globalement l’impact de la corpulence sur la répartition du temps au sein des couples. On constate alors que le fait de faire la même corpulence que son conjoint n’a pas d’effet sur le temps de loisir en commun (au contraire, cela aurait tendance à augmenter le temps de loisir seul). Plus globalement, la corpulence semble avoir peu d’effet sur la répartition du temps au sein des couples, notamment au niveau du travail domestique.
Questions méthodologiques communes à toute la thèse
Différentes mesures de la corpulence
Historiquement, la mesure de la corpulence est étroitement liée à la question de la corpulence idéale : les premières mesures de corpulence généralisées visent en effet à dé-terminer une corpulence idéale, de deux façons distinctes (Saint Pol, 2010). D’une part, suite aux travaux empiriques de Quetelet (1833) sur le poids et la taille, on peut ap-préhender le poids d’un point de vue statistique. Le poids normal est alors le poids qui, pour une taille donnée, se trouve dans un intervalle proche de la moyenne du poids dans la population étudiée. L’idéal est alors ramené à la norme statistique. A l’inverse, une seconde approche s’est développée autour de formules visant à déterminer un poids idéal différent du poids statistique. La plus ancienne est la formule de Broca : le poids idéal en kilogrammes est égal à la taille en centimètres, moins 100. D’autres formules se sont développées pour avoir une approche plus fine du poids, en incorporant par exemple l’âge, la circonférence des poignets, le sexe, la morphologie etc.).
Toutes ces mesures ont été remplacées par l’Indice de masse corporelle (IMC), qui s’est imposé depuis les années 1990 comme le principal outil de mesure de la corpulence. L’IMC est égal au rapport entre le poids en kilogramme et le carré de la taille en centimètres. Il présente l’avantage d’être facile à collecter et à calculer. Cela a favorisé sa diffusion au sein de la sphère scientifique dans un premier temps, puis dans l’ensemble des institutions sanitaires dans un second temps (Poulain, 2009). L’Organisation Mondiale de la Santé, en faisant de l’IMC l’indicateur universel de la corpulence, a joué un rôle décisif dans son adoption. Au-delà de la simple mesure de la corpulence de population, l’IMC est perçu comme un outil indispensable de contrôle de la corpulence individuelle. Par exemple, en France, le Ministre de la Santé Jean-François Mattei a souhaité en 2003 favoriser son appropriation par les médecins généralistes, pour en faire un outil de contrôle, au même titre que la tension artérielle (cf. Saint Pol, 2010).
L’IMC permet de définir des seuils, correspondant à un niveau de risque. On parlera de poids normal pour les individus ayant un IMC compris entre 18,5 et 25. C’est pour ces individus que le risque de problèmes de santé (cardio-vasculaire, diabète, hypertension) est le plus faible. Ce risque augmente pour les individus classés en surpoids (i.e ayant un IMC compris entre 25 et 30) et encore davantage pour les personnes obèses (i.e. ayant un IMC inférieur à 30). De même, le risque augmente pour les personnes en sous-poids (IMC inférieur à 18,5). Ces différentes catégories ont permis une certaine uniformisation de la recherche sur la corpulence, en favorisant la diffusion d’une définition commune de l’obésité et du surpoids.
L’IMC souffre cependant de plusieurs limites, potentiellement importantes :
– L’IMC n’évalue pas où est située la masse graisseuse. Or, l’effet de la masse graisseuse sur la santé dépend en partie de l’endroit où elle est localisée. En particulier, l’excès de graisse abdominal est ce qui est le plus néfaste (Saint Pol, 2010).
– L’IMC ne distingue pas la graisse et la masse musculaire. Une personne présentant une masse musculaire importante pourra ainsi être considérée comme obèse, alors que du point de vue médical, elle ne présente pas de risque particulier.