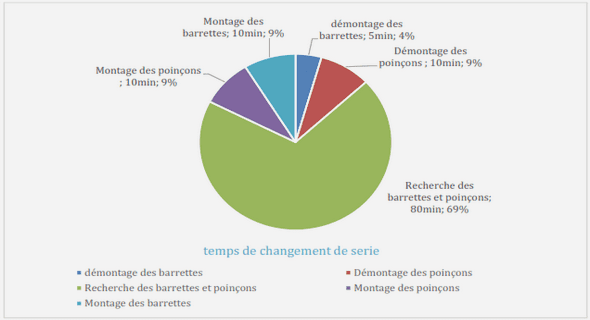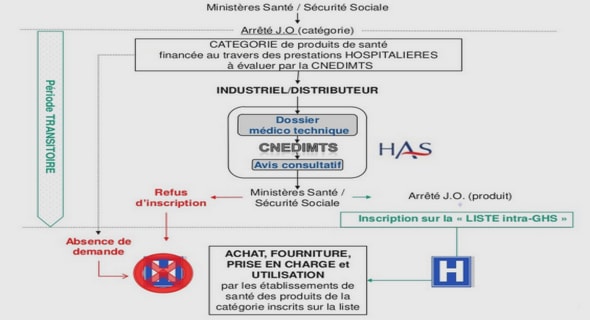Enquêter sur les maternités lesbiennes au Chili
Cette thèse sur les mères lesbiennes au Chili s’inscrit également au cœur des mutations paradigmatiques qui traversent la recherche en sciences sociales. En rendant visible une pratique marginale et très rarement étudiée dans le pays24, elle participe d’une manière ou d’une autre à une certaine politique de la reconnaissance. Il ne s’agit pas pour autant de cautionner ou de réfuter des processus de normalisation à l’œuvre dans ces configurations ; attentive aux logiques de genre, mais aussi de rapports sociaux de sexe et de classe, elle vise à problématiser davantage les conditions d’existence de ces familles dans le contexte étudié.
Au Chili, contrairement à la France, la notion d’homoparentalité ne jouit pas d’une banalisation. Elle n’a pas été adoptée dans les sphères médiatiques et politiques, et elle n’a imprégné que très récemment le discours académique et militant. Si la famille homoparentale commence à être nommée, les discours hégémoniques la renvoient plus au désir d’enfant des homosexuels qu’à une pratique d’ores et déjà en cours dans la société chilienne.
La question homoparentale s’est néanmoins brièvement invitée sur la scène publique en 2004, avec la médiatisation d’une affaire judiciaire. A l’époque, un arrêt de la Cour Suprême de Justice au Chili ordonnait le retrait de la garde de ses enfants mineurs à une femme, juge de la République qui, séparée de son conjoint, avait déclaré son homosexualité et avait refait sa vie avec une autre femme. En dépit de l’indignation manifestée par les associations des dites minorités sexuelles et par certaines associations militant pour les droits des femmes25, le sujet n’a pas suscité un débat majeur, y compris dans la sphère scientifique ; la controverse a été aussitôt close. En gros, cette décision de justice a contribué, avec le silence qui l’a suivie, à actualiser ce qui était déjà omniprésent dans l’imaginaire social : l’homosexualité et la famille sont deux réalités sociales qui s’excluent mutuellement, et qu’il convient de maintenir ainsi. Peu importe si la première repose sur une « déviance » ou sur un choix de vie », dans les deux cas elle devrait entraîner le renoncement à l’espace sacré de la famille.
Mon enquête de terrain coïncide avec la revendication de plus en plus pressante de certaines organisations homosexuelles dans le pays d’une reconnaissance juridique des unions de personnes de même sexe. Or, dans les termes où le débat était posé, la question de la filiation homosexuelle était à peine évoquée. Evacuée de la scène politique, l’homoparentalité n’existait pas26. Tandis qu’en France les clivages les plus profonds et les débats les plus passionnés ont porté sur ces enjeux, le constat étonnant qui ressortait du contexte chilien était que l’on pouvait aborder la question de la reconnaissance des couples de même sexe tout en rendant invisibles les familles formées par certains d’entre eux.
Toutefois et malgré cette illisibilité, la parentalité homosexuelle gagne du terrain chez certains homosexuels et notamment chez les lesbiennes qui – malgré leur transgression aux normes sociales et sexuelles – sont prises, à l’instar de leurs paires hétérosexuelles, dans une même « culture de la maternité »27.
En dépit de l’affaire judiciaire évoquée plus haut, au Chili la plupart des mères lesbiennes qui sont entrées dans la parentalité à partir d’une conjugalité hétérosexuelle précédente conservent la garde de leurs enfants. En effet, selon la doctrine qui fonde le code civil chilien jusqu’à l’année 2013, la mère obtient de manière préférentielle la garde des enfants mineurs. Toutefois, lorsque l´intérêt de l´enfant est remis en question (maltraitance, négligence ou toute autre cause justifiée), le texte souligne que « le juge pourra octroyer la garde à l´autre parent ». Ne pouvant pas invoquer explicitement l’homosexualité comme l’une de ces causes, la Cour Suprême mobilise dans son argumentaire que ce n’est pas l’orientation sexuelle en elle-même qui pose problème, mais plutôt le « choix de vie » de la mère. Autrement dit, sa décision de cohabiter avec sa partenaire. Dès lors, le message peut être reformulé ainsi : si la parentalité lesbienne se cantonne à la sphère privée, elle peut plus difficilement être contestée.
Par ailleurs, les lesbiennes qui entrent dans la parentalité dans le cadre d’un projet exclusivement homoconjugal bénéficient, en plus de la primauté de la maternité sur la paternité dans les représentations sociales, de leur accès privilégié à l’engendrement28. Tandis que la plupart des moyens dont disposent les gays pour devenir parents passent par l’arrangement avec une femme, le couple lesbien peut, – soit à partir d’un recours aux technologies reproductives, soit à travers un contact hétérosexuel occasionnel de l’une des partenaires, – contourner cet arrangement avec un tiers (un homme) pour mener leur projet.
Au Chili, le contournement de l’« ordre procréatif »29 est favorisé notamment par l’absence d’un encadrement légal de la procréation médicalement assistée (PMA). Certes, la pratique clinique majoritaire tend à s’accorder sur le principe que la PMA est une technologie vouée à répondre à la demande parentale des couples hétérosexuels, excluant ainsi les couples homosexuels et les femmes célibataires. Toutefois, l’enquête de terrain montre bien que malgré les entraves morales, le désir d’enfant féminin n’est presque jamais un objet de soupçon. Dans la plupart des cas, il suffit à l’une des membres du couple de se présenter comme une femme célibataire en quête de maternité pour réussir à obtenir l’accord d’un médecin.
Cette thèse propose d’interroger l’inscription et l’évolution des mères lesbiennes dans un contexte social qui rend impensables de telles configurations familiales ; mais pour être illisibles, celles-ci n’en sont pas moins possibles. Entre conservatisme et libéralisme et plus largement en absence de discours structurants, comment est-on mère et lesbienne au Chili ? Et lorsqu’on est en couple, comment devient-on des parents de même sexe ? Quels sont les bricolages » que ces mères mettent en œuvre pour concilier des identités sociales apparemment opposées ? Enfin, comment ces arrangements façonnent-ils leur pratique parentale ?
Pour répondre aux questions qui guident cette recherche, deux trajectoires distinctes sont interrogées : des parentalités lesbiennes issues des recompositions familiales, c’est-à-dire, où l’enfant a été conçu dans un contexte hétérosexuel, et des parentalités lesbiennes où le projet d’enfant est né dans un contexte homoconjugal. Dans cette enquête, ce dernier groupe rassemble notamment des configurations familiales issues d’un recours au « don »30. Ici, l’entrée dans la parentalité se fait notamment à partir du recours à l’insémination artificielle avec donneur connu ou inconnu, dans le cadre d’une procréation médicalement assistée (PMA). Du fait du non-respect de la règle de la différence des sexes dans le couple parental, cette déclinaison est reconnue par la littérature spécialisée comme la forme la plus transgressive de parentalité lesbienne31. Au Chili, il s’agit d’une pratique émergente qui commence à gagner en lisibilité pour les lesbiennes des classes moyennes, favorisée d’un côté par l’absence d’encadrement légal des techniques reproductives et de l’autre par l’essor d’un marché procréatif32. Dans un cas, cette technique est remplacée par des inséminations de type artisanal33. Si dans ce dernier cas le donneur est forcément connu, les deux modalités présentent une caractéristique commune : le géniteur masculin n’a pas de participation autre dans le système que celle du don. Enfin, deux autres types d’entrées dans la parentalité sont présents dans cette enquête : celui issu d’un contact hétérosexuel occasionnel (modalité rarement décrite dans la littérature européenne et nord-américaine) et celui dérivé d’une coparentalité34. En revanche, cette étude ne comporte aucune configuration établie à partir d’une adoption, qui constitue une autre entrée possible dans l’homoparentalité35.
Il convient de donner quelques précisions par rapport à cette démarche et à l’intérêt d’étudier ensemble des trajectoires en apparence si hétérogènes. Actuellement, la plupart des recherches s’abstiennent de mener des comparaisons entre les familles homoparentales dites recomposées et celles avec un projet homoparental d’origine. Parmi les raisons invoquées, la thèse selon laquelle ces familles seraient soumises à des logiques et à des contraintes trop différentes ; même si elles se heurtent à un même manque de reconnaissance sociale, les recompositions familiales seraient confrontées davantage à l’acceptation ou non de la nouvelle conjointe par les membres de la famille, se rapprochant bien plus des problématiques liées aux recompositions familiales hétéroparentales36. Les asymétries statutaires – c’est-à-dire en lien avec le statut légal ou non des parents au sein du couple – se manifesteraient aussi autrement : puisque l’enfant a un père, la conjointe de la mère ne se considérerait ni se réclamerait pas comme « l’autre » parent37. Dès lors, les luttes symboliques tendraient à investir le terrain des fonctions parentales et non pas celui de la parenté. Or mon terrain d’enquête relativise ces deux aspects. En général, dans les configurations recomposées visitées le problème des mères sociales n’est pas (en priorité) un problème d’acceptation mais de reconnaissance, et cela particulièrement dans les familles où domine – par accord implicite ou explicite du couple – l’ambigüité, voire le secret, autour de la conjugalité. Cette logique, intimement liée à la croyance selon laquelle le lesbianisme ne doit pas être divulgué aux enfants et donc à l’intériorisation de la déviance, n’est pas extrapolable aux recompositions familiales hétérosexuelles38. Autrement dit, les enfants ne peuvent pas accepter ou rejeter une figure parentale sans d’abord la distinguer comme telle. Par ailleurs, et même si elles ne se disent pas toutes « mère », presque la totalité des enquêtées appartenant à la catégorie de mères sociales revendiquent un lien filial avec les enfants qu’elles contribuent à élever. Des récits de certaines d’entre elles ressort un vécu unilatéral de la relation filiale (« c’est mon enfant mais je ne suis pas sa mère »), lié une fois de plus à la question de la reconnaissance. La question qui se pose alors est la suivante : comment peut-on être considérée comme mère lorsqu’on n’est pas distinguée comme figure parentale ? Par ailleurs, mon terrain d’enquête montre que la plupart des mères sociales des familles recomposées entrent dans la parentalité dans un contexte où la figure du père est plus symbolique que réelle dans la vie de l’enfant. Sans cette concurrence dans la parentalité, il n’est donc pas sûr qu’elles renoncent à investir le terrain de la parenté, rejoignant ainsi le vécu des mères sociales qui le sont devenues à partir d’un projet homoconjugal.
Enfin, l’inclusion de ces deux trajectoires distinctes permet de discuter la thèse qui s’impose de plus en plus dans les études féministes sur ces maternités, selon laquelle il y aurait d’une part les « lesbiennes mères », celles qui doivent composer avec l’héritage d’un couple hétérosexuel précédent, et d’autre part « des mères lesbiennes » qui, devenant mères en tant que lesbiennes, seraient plus à même de déconstruire le genre39. Cette catégorisation, qui semble aller de soi, s’impose-t-elle dans le contexte chilien ? Les processus qui mènent à refaire ou à défaire le genre, y compris dans la parentalité, sont-ils uniquement le ressort d’une quelconque affirmation identitaire ?
Terrain, méthode, corpus
Lorsque que j’ai entrepris cette thèse, les difficultés du terrain, inhérentes à l’invisibilité de mes sujets d’étude, sont rapidement apparues. Certes, ces femmes – mères et lesbiennes – existaient ici et là, mais à l’exception d’une ou deux, elles évoluaient en dehors de l’espace public : l’absence de porte-parole ou d’associations les rassemblant ou cherchant constituer collectivement leurs problématiques, mais aussi de recherches scientifiques les prenant pour objet ne laissaient apparaître que des pistes précaires de leur existence, à la fois en tant que telles, dans leur singularité, et en tant que groupe social. L’une de ces pistes, un atelier psychosocial destiné à ces femmes et animé par une psychologue, s’est vite refermée : le groupe s’était constitué depuis quelques mois et les règles internes du fonctionnement empêchaient de nouveaux membres de le rejoindre en cours d’année. Il aurait fallu attendre le prochain groupe, et mon calendrier de séjour au Chili s’avérait incompatible avec ces nouvelles dates. L’observation participante s’est ainsi éloignée de l’horizon de cette enquête, plaçant les entretiens, qui étaient déjà au cœur du dispositif, comme l’outil principal dans la collecte de matériaux de première main. D’autres observations plus indirectes ont toutefois été possibles au cours de colloques et des séminaires rassemblant chercheurs et société civile, notamment autour des débats portant sur l’ouverture des droits pour les couples de même sexe.40
Pour l´étude de terrain, le choix a donc reposé sur une démarche qualitative et compréhensive, visant à comprendre les pratiques – l’action en situation – ainsi que les sens que les acteurs donnent à leurs trajectoires41. La technique de l’entretien narratif, à travers le recueil de récits de vie, est apparue à ce propos comme l’alternative la plus appropriée. En effet, cette méthode permet de « situer le réseau dans lequel le narrateur se positionne et d’inscrire les phénomènes sociaux dans un enchaînement de causes et d’effets. Autrement dit, il permet de se positionner en tant que sujet qui s’exprime à la première personne, mais aussi comme individu inscrit dans une histoire collective42. Enfin, le récit de vie permet de mettre en lumière les processus43 tel celui de devenir et d’évoluer en tant que parent de même sexe.
L’une des difficultés rencontrées pendant le travail d’élaboration du projet de thèse a été mon éloignement du Chili depuis deux ans, raison pour laquelle j’ai prévu de mener une pré-enquête. Cette première étape exploratoire cherchait à soulever les ajustements nécessaires, autant théoriques que méthodologiques, pour mener à bien l’enquête. L’entrée dans le terrain a été favorisée par un premier contact avec la psychologue qui animait l’atelier que je n’ai pas pu intégrer, et qui a socialisé ma démarche auprès de ses membres. Mes deux premières enquêtées faisaient partie de ce groupe, puis elles ont parlé à leurs partenaires et ensuite à d’autres connaissances. Un premier noyau d’enquêtées s’est constitué par le bouche à oreilles ». Ce travail de pré-enquête a été réalisé en 2009 pendant un séjour de trois mois à Santiago du Chili. Dix entretiens narratifs avec des mères lesbiennes, qui correspondent aux récits croisés de cinq couples44, ont été réalisés et intégralement retranscrits. Cette étape de l’enquête a permis notamment de faire émerger du terrain et donc des matériaux les questions pertinentes à l’analyse45. Le deuxième temps de l’enquête de terrain s’est déroulé principalement en 2010. En faisant appel notamment à des réseaux amicaux mais aussi professionnels, le corpus a pu être élargi. Pendant cette étape, dix-neuf entretiens individuels et deux entretiens avec deux couples ont été réalisés et intégralement retranscrits.
Si l’entretien constitue l’outil central de cette étude, celle-ci s’appuie aussi sur le carnet rempli pour les besoins de l’enquête par ces mêmes femmes. Adapté d’une autre recherche46, ce carnet impliquait pour ces dernières de reporter, de manière aussi détaillée que possible, toutes les demi-heures sur une journée dans la semaine et sur une journée du week-end – les activités et les fonctions quotidiennes liées à la vie familiale et en particulier aux tâches parentales (voir annexe n°1). L’usage de cet outil devait contribuer d’une part à minimiser la production des discours normatifs sur la parentalité et d’autre part d’encourager les enquêtées à faire de leur récits un « récit des pratiques »47. En effet, ce registre d’activités s’est avéré spécialement utile pour la préparation de l’entretien lorsque la personne interrogée l’envoyait avant le déroulement de celui-ci. Il faut toutefois souligner les limites de ce dispositif. En premier lieu, toutes les enquêtées n’ont pas rempli le registre (en raison notamment d’un manque de temps) et certaines l’ont fait avec leur partenaire (contrairement à la consigne). Par ailleurs, il s’est montré peu adapté pour les familles avec des enfants plus âgés, moins dépendants de leurs parents. Au total, dix registres individuels et six registres remplis par les deux partenaires me sont parvenus.