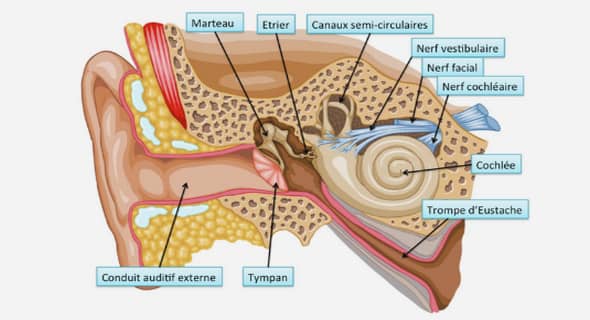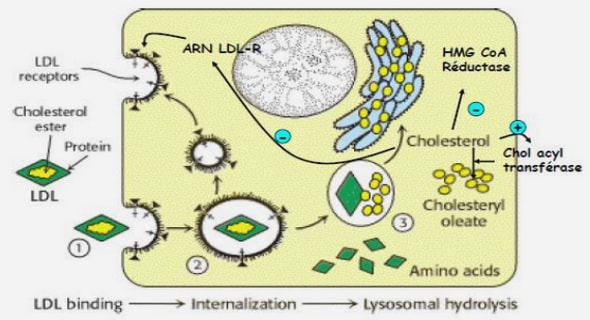Le globe oculaire
Le globe oculaire est une partie fondamentale de l’appareil de la vision ; il se présente sous forme de sphère d’environ 2 cm de diamètre et comporte : une enveloppe et un contenu.
l’enveloppe est composée de trois membranes accolées les unes aux autres. Ces enveloppes sont aussi appelées tuniques ; de l’extérieur vers l’intérieur il s’agit de : la tunique externe : la sclère et la cornée, la tunique moyenne : dont l’uvée antérieure est caractérisée par le corps ciliaire et l’iris ; et l’uvée postérieure ou la choroïde constituée par une zone richement vascularisée et la tunique interne ou la rétine qui est la couche sensorielle.
Le contenu est composé de l’humeur aqueuse qui est un liquide transparent et fluide sécrété par le corps ciliaire.
Le cristallin
Le cristallin est une lentille transparente située dans un plan frontal de la chambre postérieure, entre l’iris en avant et en arrière, le vitré auquel elle adhère fortement par le ligament de Wieger qui l’attache à la membrane hyaloïde limitant le vitré antérieur.
Cette notion anatomique est fondamentale car elle va conditionner le choix des techniques chirurgicales selon l’âge du patient : l’adhérence au vitré devient de plus en plus lâche au fur et à mesure du vieillissement, elle est maintenue en place par la zonule de Zin qui relie l’équateur cristallin (sur toute sa périphérie) au corps ciliaire. La constitution du cristallin est comparable à celle d’un fruit, avec apparition chronologique pendant l’embryogenèse
Les noyaux au centre : noyau embryonnaire, espace central optiquement vide noyau fœtal qui entoure le premier et forme les deux zones en grain de café, contenant les sutures en Y noyau adulte.
Le cortex qui entoure le noyau. La capsule ou cristalloïde qui l’enveloppe ; on distingue la capsule antérieure et la capsule postérieure. C’est l’opacification d’un de ces éléments qui conditionnera les différents types anatomocliniques de la cataracte.
Rôle du cristallin dans l’acuité visuelle
Le cristallin situé derrière le diaphragme irien permet, la focalisation des images sur la rétine, grâce à son pouvoir accomodatif.
Il est situé entre deux systèmes transparents : l’un antérieur la cornée derrière laquelle se trouve l’humeur aqueuse qui remplit la chambre antérieure ; l’autre en arrière le vitré gel semi-liquide transparent .
Sa principale fonction est dioptrique: c’est une lentille biconvexe qui participe au dioptre oculaire. Sa puissance dioptrique est dotée d’une variabilité spontanée qui lui permet la mise au point nette sur la rétine en vision de loin (lorsque la zonule est tendue) et en vision de près (lorsque la zonule se détend ce qui accroît la convergence de la lentille). Le pouvoir accomodatif se perd avec l’âge. La presbytie correspond à la perte de ce pouvoir accomodatif et débute vers 45 ans chez un sujet émétrope.
Cette fonction dioptrique du cristallin est remplacée par l’implant avec une puissance dioptrique identique qui permettra aux images d’être focalisées sur la rétine.
La cataracte
La cataracte est l’opacification plus ou moins complète du cristallin. Elle est responsable d’une baisse plus ou moins importante de l’acuité visuelle selon le degré d’opacification de la topographie des opacités cristalliennes. Elle produit une cécité évitable .
La physiopathologie : Le cristallin est un organe avasculaire dont le métabolisme se fait par diffusion active ou passive à partir du liquide dans lequel il baigne : l’humeur aqueuse.
La dégradation du glucose qui se fait dans le cristallin produit l’opacification de ce dernier. Ce trouble entraîne un désiquilibre de la synthèse protéique cristallienne, causant une dénaturation des protéines qui provoque une hausse de la pression osmotique suivie d’un appel d’eau .
Rappelons que le rôle de la synthèse protéique est d’assurer la régénération permanente des fibres qui va maintenir une bonne transparence du cristallin. Cette synthèse protéique diminue avec l’âge et se poursuit indéfiniment durant la vie à partir des cellules de l’épithélium de la capsule.
L’anatomopathologie : La dénaturation des fibres cristalliennes explique l’opacification du cristallin et gêne la transparence jusqu’au niveau de la rétine.
La cataracte peut siéger sur trois structures du cristallin Totale (opacification de tout le cristallin). Sous capsulairre : sur la cristalloïde qui peut être sous capsulaire antérieur ou sous capsulaire postérieur. Nucléaire : opacification dans le noyau. Corticale, quand le cortex est touché. La topographie des opacités permet de connaître la date de survenue de la cataracte.
La correction de l’aphakie
Le cristallin est une lentille biconvexe à haut pouvoir réfractif, son extraction entraîne une forte hypermétropisation ( de 10 à 12 dioptries). Pour aboutir à une emmétropie post-opératoire avec la meilleure acuité visuelle, il faut réaliser une intervention suivie et techniquement parfaite, en utilisant différentes méthodes, telles que :
Utilisation de l’implant intra-oculaire L’implant intra-oculaire est un cristallin artificiel qu’on va introduire dans l’œil à la place du cristallin expulsé ; il peut se présenter sous forme de lentilles de différentes natures et morphologies.
Historiquement, la première lentille intra-oculaire introduite dans l’œil humain pour remplacer le cristallin fut en 1952. Dans les années 90, la chirurgie de la cataracte a atteint un niveau de perfectionnement notoire .
Le principe de l’utilisation de l’implant Il s’agit de remplacer le cristallin opacifié par la lentille intra-oculaire .
La lentille intra-oculaire idéale serait celle qui restaurerait les propriétés optiques et accomodatives du cristallin ; il doit être bio-compatible.
Les exigences communes des lentilles intra-oculaires sont : la légèreté, la durabilité, l’absence d’aberration sphérique, la modification minime et aberration en cas de décentrement et de bascule, la réflexion interne faible, la proximité de la transmission spectrale avec celle du cristallin naturel ; la suffisance du diamètre pour le passage de toute la lumière à travers la pupille.
Table des matières
INTRODUCTION
I – RAPPELS ET GENERALITES
I – 1 Le globe oculaire et le cristallin
I – 2 La cataracte
I – 3 La correction de l’aphakie
II – MATERIELS ET METHODES
II – 1 Cadre de travail
II – 2 Bases de l’étude
III – LES RESULTATS DE NOTRE ETUDE
III – 1 L’âge et le sexe du patient
III – 2 Le déroulement de l’intervention
III – 3 Les suites opératoires
III – 4 Les suites fonctionnelles
III – 5 Les étiologies des complications
III – 6 Les conduites à tenir
III – 7 Les maladies associées
IV COMMENTAIRES DISCUSSIONS ET SUGGESTIONS
IV – 1 Commentaires et discussions
IV – 2 Suggestions
CONCLUSION
ANNEXE
LE LIONS SIGHT FIRST MADAGASCAR ET l’OPERATION DE LA CATARACTE AU SERVICE
DE L’ORL – OB DU CHU JRA
BIBLIOGRAPHIE