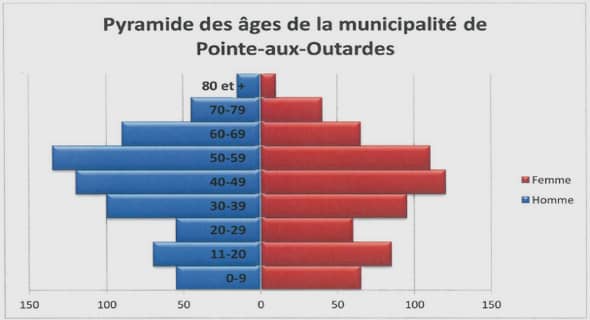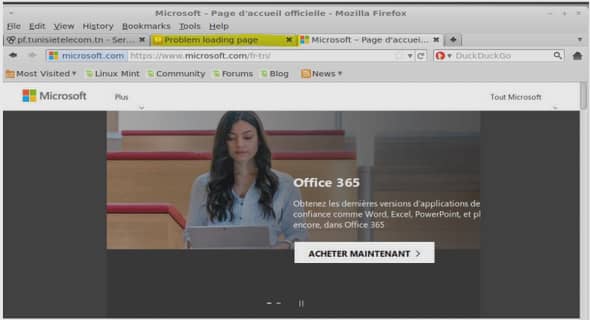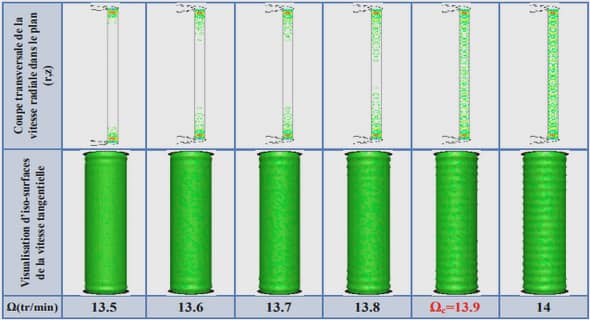Caractéristiques de la décentralisation
Modifications intempestives et trop fréquentes du niveau de CTD. La décentralisation n’avait pas de bases solides pour permettre son assise. Cette instabilité du découpage territoriale est due au changement de République et/ou à la révision constitutionnelle qui s’est accéléré(e) sous la Troisième République.
Administration très centraliste: La fréquence des crises (2002, 2009) entrainait une instabilité sur tous les plans (économique, politique, social, juridique, etc.). Cela ne fait qu’engendrer des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement du système de décentralisation. Ainsi donc, la décentralisation était mal assimilée-aussi bien par la population que par les responsables eux-mêmes-puisque l’on priorisait les solutions pour la sortie de crise (tel est le cas actuellement).
Politisation de l’Administration : le succès ou le blocage de la décentralisation dépend étroitement des choix politiques.
Mise en exergue de la décentralisation dans tout son ensemble à travers l’adoption de la Lettre de Politique de Décentralisation et de Déconcentration (LP2D) ainsi que le Programme National de Décentralisation et Déconcentration, plus communément appelé PN2D, considéré comme la traduction opérationnelle de la LP2D.
Volonté de l’Administration de se familiariser avec la décentralisation effective. D’où, la consécration de la décentralisation dans les PGE15 en tant que stratégie nationale de développement.
Le principe du «centralisme démocratique» de la deuxième République a fait place au principe de «progressivité des réalisations». Ce sont surtout les Communes qui ont été valorisées et opérationnalisées en dépit du fait que la décentralisation de la troisième République était surtout axée sur les Régions et les Provinces. Si l’on retrace l’évolution de la décentralisation à travers l’organisation territoriale de l’Etat Malagasy et surtout à travers les différents textes sur la décentralisation, seules les communes représentent la seule entité effectivement décentralisée puisqu’elles ont, entre autre, vocation à constituer une structure de base de développement avec les Fokontany en leur sein. Par ailleurs, du fait de son ancienneté, la Commune fait figure d’une entité décentralisée la plus enracinée.
La politique de décentralisation
La LP2D : C’est un processus clair mais qui nécessite une opérationnalisation accrue. La Lettre de Politique de Décentralisation et de Déconcentration connue sous le sigle de LP2D a été officiellement validée en Décembre 2005, à l’issue d’un atelier national qui a regroupé des représentants des différentes catégories d’acteurs du développement à Madagascar. Rappelons-en alors les aspects saillants :
Consolider la décentralisation en mettant les Communes et les Régions au cœur du processus de décentralisation ;
Renforcer les Services Techniques Déconcentrés (STD) pour qu’ils apportent plus de soutien aux Communes et Régions ; Renforcer la participation citoyenne et développer la coopération entre Communes et Régions d’une part et entre secteur public et privé d’autre part.
Depuis lors, les premières actions entreprises pour la mise en œuvre de la LP2D comprennent : la mise en œuvre des organes de la structure 2D : Le Comité de pilotage, la Cellule Centrale ainsi que les cellules 2D dans les Ministères clefs ;
une stratégie de décentralisation fiscale dont les premiers résultats se sont concrétisés dans la loi de finances 2008;
la création par décret du Fonds de Développement Local comme mécanisme de financement de l’investissement communal et de renforcement,…..
La lettre en tant que telle constitue l’affirmation d’une intention politique. Claire et bien articulée, elle constitue une base cohérente de réflexion et d’orientation de la mise en œuvre des 2D. Ses trois axes – décentralisation, déconcentration et démocratie locale – ont une réelle cohérence. Ceci dit, sa traduction opérationnelle s’avère plus compliquée.
Défis majeurs des programmes de décentralisation
Le défi majeur de tout programme d’appui à la décentralisation, qu’elle que soit la modalité adoptée, consiste à vouloir apporter une contribution significative à trois niveaux:
Reforme de l’Etat : Il s’agit ici de question de légitimité du service et de l’administration centrale. l’État est encore pour un grand nombre de malgaches un corps étranger, dont la fonction n’est pas clairement connue, ni davantage reconnue ; On n’est pas vraiment certain de son utilité, qui souvent ne fait sentir sa présence au quotidien que pour capturer des rentes, réprimer, interdire, sinon même, parfois, pour prendre le contrôle de ce qui pourtant paraissait inaliénable, telle forêt, tel lot de terres…La légitimité de l’État au quotidien, du point de vue du citoyen, celle qu’on pourrait dès lors dénommer la légitimité citoyenne, reste une question ouverte et figure sans aucun doute parmi les défis de l’avenir proche.
En effet, si les malgaches ne vivent pas leur État comme une nécessité absolue, s’ils ne ressentent pas le poids de ses fonctions dans leur existence de tous les jours, redistribution, justice, protection, régulation, éducation,…, il y a fort à parier qu’une réforme, quelle qu’en soit la nature, échouera sur le rivage des intentions généreuses. Dans cet esprit, des programmes d’appui à la décentralisation offrent une réelle opportunité de donner vie à des principes qui parfois sommeillent négligemment dans les textes.
Reforme de la citoyenneté : La réforme de l’État ne se limite à celle de ses services ou administrations centrales. Elle doit aussi atteindre ses structures les plus périphériques et, parmi elles, les structures de l’État à l’échelle locale. Si la réforme de l’Etat est appelée à concentrer ses efforts sur la fonctionnalité de son administration et, plus généralement, sur celle de ses instruments, ainsi que sur l’ajustement de ses missions, elle exige en contrepartie une autre réforme, celle de la citoyenneté. À vrai dire, ces deux réformes sont en position de miroir: si l’État change de perspective, il est nécessaire que la citoyenneté s’ajuste; De même, si la population change de dynamique, l’État doit s’adapter.
Appui au processus de décentralisation
Appui efficace au processus de décentralisation et de déconcentration par la constitution d’une capacité de réponse aux attentes des nouvelles collectivités communales et régionales.
Appui à l’élaboration de différents textes régissant l’effectivité de la décentralisation à Madagascar ; Appui au renforcement des capacités des CTD et promouvoir les initiatives locales en matière de développement ; Appui à l’organisation et à la coordination du transfert des moyens et ressources auprès des CTD, un transfert qui devrait nécessairement accompagner le mouvement de décentralisation ; La facilitation de la mise en œuvre des plans locaux de développement ; internaliser le réflexe « 2D » par la mise en œuvre d’un Programme Conjoint de Décentralisation et de Déconcentration ou PC2D. Ce dernier vise à ce que le Ministère de l’intérieur et le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation soient capables de mettre à jour et d’assurer la mise en œuvre et le suivi du PN2D. Il veille aussi à ce que les administrations des Régions soient capables d’assurer leurs missions en matière de développement.
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : Analyse du processus de décentralisation de la troisième République
Chapitre I : Etat des lieux et constat de la situation
Section I : Evolution historique de la décentralisation
§1-Evolution à travers les années
§2- Evolution à travers les trois législatures de la troisième République
I- Première législature
II- Deuxième législature
III- Troisième législature
Section II : Caractéristiques de la décentralisation
Chapitre II : Orientations des actions en matière de décentralisation
Section I : Décentralisation et stratégie nationale de développement
§1-La décentralisation à travers la PGE
A- Décentralisation et DSRP
B-Décentralisation et MAP
§2- La politique de décentralisation
A- La LP2D
B- De la LP2D au PN2D
1- Les avancées du PN2D
2- La difficulté de la transformation de la LP2D en PN2D
§3- Dispositifs d’appui
Section II : Conditions critiques et risques du programme au niveau
§1- Politique
§2- Institutionnel
§3- Financier et fiscal
A- Risques financiers
B- Risques fiscales
§4- Culturel
DEUXIEME PARTIE : Critiques et perspectives du processus de décentralisation de la troisième République
Chapitre I : Les acquis de la décentralisation de la troisième République
Section I : Les points forts de cette décentralisation
Section II : Les failles et les obstacles au succès de la décentralisation
§1- Défis majeurs des programmes de décentralisation
A- Réforme de l’Etat
B- Réforme de la citoyenneté
C- Développement local
§2- Facteurs de blocages de la décentralisation
A- Projets et/ou programmes de développement au niveau des CTD
B- Compétences des personnels
C- Autonomie des collectivités
D- Processus
1- Capacités insuffisantes pour la dynamisation du processus 2D
2- Incohérence du processus de décentralisation avec les réalités locales
E-Textes
F-Système de financement et/ou subvention
G- Leadership et participation citoyenne
1- Problème de leadership
2- Manque de participation citoyenne
H- Appui technique
§3- Les menaces du passé et du moment
Chapitre II : Conditions préalables à une décentralisation réussie
Section I : Au niveau de l’Etat
Section II : Au niveau des institutions administratives
Section III : Quelques préconisations à considérer
Section IV : Appui au processus de décentralisation
CONCLUSION
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE