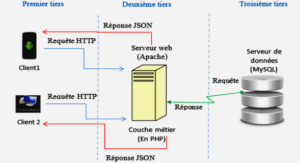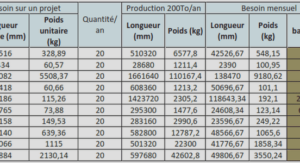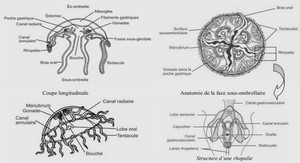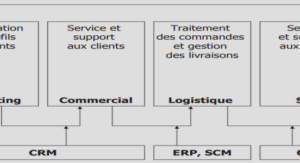Réitération parodique la marque du carnavalesque
Le récit de la route comme réitération parodique
Présence d’un hypotexte au sein du récit de la route
Continental Drift, avec sa structure bipartite, permet à notre avis de révéler un trait fondamental du récit de la route : son rapport avec d’autres récits d’errance qu’il absorbe et conteste d’un même mouvement. Nous avons exposé plus haut les raisons qui nous ont poussé à travailler sur trois aires géographiques particulières : les États-Unis, l’Allemagne ainsi que le Canada et notamment sa partie québécoise. Or, il est intéressant de constater que, sans que cela ne constitue une règle, les hypotextes sous-tendant les différentes œuvres de la route à l’étude relèvent parfois de traditions artistiques propres à chacune de ces régions : ainsi, les récits de la route américains pourront s’inspirer de la figure du cow-boy ou du hobo ; le corpus allemand puisera volontiers dans le Bildungsroman, tandis que les œuvres québécoises connaîtront l’influence de récits ramenant aux premiers instants de la colonisation française du continent. Il est ainsi possible de mettre au jour dans notre corpus un certain nombre de nuances relatives à l’origine culturelle des œuvres à l’étude.
Le corpus américain
Si le roman de Russell Banks s’établit de façon évidente sur l’entrelacs de deux récits distincts – un road novel et un récit d’exil – dont l’un constitue le pendant dégradé de 322 l’autre, nous constatons que les œuvres de la route qui composent notre corpus d’étude semblent également se construire en relation avec un autre type de récit d’errance qu’elles contiennent et à partir duquel s’établit une forme de distanciation. Ainsi par exemple, On the Road, qui, rappelons-le, constitue en quelque sorte le road novel originel, est d’emblée défini par son auteur comme une version altérée d’un roman picaresque. En effet, dans une lettre datée du 4 juillet 1957 qu’il adresse à son éditeur Malcolm Cowley, Kerouac met de l’avant son projet d’un nouvel opus, dont l’intrigue serait calquée sur le modèle d’On the Road. Il précise à son sujet : « It will be another “Road” picaresque530 . » La référence à une forme littéraire tutélaire est ainsi non seulement assumée mais programmatique. Si l’on repère surtout, dans On the Road, une référence aux récits de la Grande Dépression dans lesquels des vagabonds traversent l’Amérique à bord de wagons de marchandise531, il est vrai que l’on retrouve, dans le personnage du hobo, quelque chose du picaro : tous deux ont en partage cette même rage de survivre dans un contexte de grande précarité, quitte à employer des moyens illicites pour parvenir à leurs fins. On pense par exemple à la figure de Bertha Boxcar, l’héroïne du roman de Ben Reitman (1937), qui, jetée à la rue à la mort de son père, s’allie à une bande de malfaiteurs et circule clandestinement par voie de chemin de fer pour échapper aux autorités. Et de fait, les différents voyages entrepris par Sal Paradise et Dean Moriarty s’inscrivent dans la lignée des exploits du père de Dean – un vagabond fameux dont l’ombre plane sur l’ensemble du récit. Ce sont les traces de cet homme d’une autre génération que s’efforcent de suivre les jeunes gens, Dean recherchant dans chaque clochard croisé sur le chemin les traits de son géniteur disparu. Cependant, alors que la route constituait la seule alternative pour le vieux Moriarty et qu’il s’y est probablement perdu, les deux protagonistes disposent chacun d’un filet de sécurité : ainsi, Dean s’établit ponctuellement auprès de Camille et de leur petite fille sur les côtes de la Californie, entre deux épisodes de frénésie routière, tandis que Sal se réfugie dans les jupes de sa tante dès que les temps deviennent difficiles. Nous voyons donc poindre cet effet d’édulcoration déjà mentionné au sujet de Continental Drift : les protagonistes du roman de Kerouac reproduisent le geste du hobo, dépourvu cette fois du danger et de la nécessité qui le caractérisent initialement. Le terme « Road », que l’auteur associe à l’idée d’un roman picaresque pour évoquer l’originalité de son œuvre, permettrait alors d’exprimer cet élément de distanciation parodique que nous nous efforçons de mettre au jour533. De la même manière, nous avons eu l’occasion de montrer précédemment comment Easy Rider et les premiers road movies de l’histoire du cinéma se sont appropriés les caractéristiques du western, qu’ils ont remodelées et détournées afin d’établir l’impossibilité de l’utopie américaine. Nous constatons donc que dès ses origines, littéraires et cinématographiques, le récit de la route se construit dans une relation d’absorption et de distanciation par rapport à une autre forme de récit d’errance, dont la quête – que nous pourrions qualifier de « sérieuse » car motivée par des raisons politiques ou par un instinct de survie – est dévoyée et détournée de ses buts initiaux.
Le corpus germanique
Quoiqu’inscrites dans un contexte culturel sensiblement différent, les œuvres de notre corpus allemand produisent le même effet de mise à distance vis-à-vis d’un récit d’errance sous-jacent, ce qui tend à nous conforter dans notre hypothèse. Ainsi, la trilogie de Wim Wenders, sur laquelle nous nous sommes déjà longuement étendu, semble elle aussi s’appuyer sur un ensemble d’hypotextes à partir desquels s’élabore un discours critique. Alice in den Städten, rappelons-le, débute par la relation du périple d’un écrivain allemand le long de la côte Est des États-Unis. Le voyage effectué par Philip Winter a pour objet de le confronter à la réalité du rêve américain et redouble, à quelques dizaines d’années de distance, le mouvement des migrants débarquant à Ellis Island après une interminable traversée de l’Atlantique. On songe bien évidemment au héros d’America, America de Kazan, qui, à l’issue de son périple, découvre la statue de la liberté depuis le pont d’un navire, et perçoit dans ce symbole la fin de son calvaire. L’Amérique représente alors à ses yeux l’espérance d’une vie meilleure, où chacun peut tenter sa chance et accéder à la réussite. Cependant, l’image du Nouveau Monde véhiculée par le film de Wenders est sensiblement ternie et laisse entrevoir le caractère fallacieux du mythe américain : nous renvoyons par exemple à l’abondance de panneaux publicitaires qui dénaturent le paysage ou encore à la télévision qui diffuse en boucle des réclames pour des paradis de pacotille. Il semblerait que la société n’ait rien d’autre à offrir qu’une existence vaine, fondée sur le principe d’une consommation excessive. Devant l’ampleur du mensonge auquel il est confronté, Winter est comme aspiré par le vide et se révèle incapable de créer. Ayant dépensé ses derniers dollars, il décide finalement de rentrer chez lui en Allemagne et, tout comme les motards désabusés d’Easy Rider avant lui, il parcourt à rebours le chemin des migrants. À l’instar des œuvres évoquées précédemment, Alice in den Städten se construit donc sur un hypotexte relevant du récit d’exil, dont il prend le contre-pied. Le contenu d’Im Lauf der Zeit renvoie pour sa part à deux moments de conquête successifs qui impriment leur marque sur l’histoire allemande. Ainsi, nous avons évoqué plus haut l’omniprésence du spectre de la Seconde Guerre mondiale dans le dernier volet de la trilogie de Wenders. Nous pensons notamment aux noms de village (Machtlos, Friedlos, Toterman) qui permettent d’évoquer les horreurs des combats, mais aussi à tous ces symboles du nazisme, qui sont ici détournés de leur fonction première : la croix de fer associée au régime militaire, devenue croix de Malte entre les mains de Bruno Winter ; la jeune ouvreuse rencontrée à la fête foraine qui cache sous sa veste une bougie à l’effigie du Führer, Hitler apparaissant alors sous un jour à la fois kitsch et inoffensif, etc. Im Lauf der Zeit se présente alors comme l’écho distancié d’un film tel que Ich war 19 de Konrad Wolf, dont l’intrigue ramène le spectateur aux derniers instants de la Seconde Guerre mondiale, en avril 1945. Tourné en 1968 sous le patronage de la DEFA, ce récit à teneur hautement autobiographique permet de suivre le parcours d’un jeune allemand de 19 ans ayant passé 325 sa jeunesse en Russie, et qui retourne dans son pays d’origine en tant que soldat, lors de l’invasion du territoire allemand par les troupes soviétiques534. Au fur et à mesure d’un voyage qui dépeint l’avancée de l’armée russe vers l’Ouest, nous assistons, à travers le regard de ce personnage, à la débâcle des nazis et à la chute du IIIe Reich. L’errance du jeune soldat est ici liée à une nécessité d’État – celle pour la Russie d’assurer sa domination sur une Allemagne en perte de vitesse. En ce sens, Ich war 19 relèverait plutôt de ce que nous désignons par l’appellation de « film de conquête535 » – au même titre que le western dans la culture américaine – et Im Lauf der Zeit en convoque le souvenir tout en faisant montre, à l’égard de cette période, d’une raillerie discrète mais constante. À ce premier récit sous-jacent vient se superposer la représentation d’un autre temps fort de l’histoire, à savoir celui de la Guerre Froide, qui aboutit à la création des deux Allemagnes. C’est en effet la frontière entre la RFA et la RDA que longent les protagonistes du film, sans jamais la traverser. Quoique omniprésente à l’image, cette ligne de démarcation est en quelque sorte banalisée, et sa dangerosité est continuellement donnée à voir sous un jour comique. Ainsi, au cours de la séquence d’ouverture, Robert plonge avec sa Coccinelle dans les eaux de l’Elbe, qui permettent de tracer la séparation entre les deux États, et en ressort piteux et dégoulinant, sous le regard amusé de Bruno.