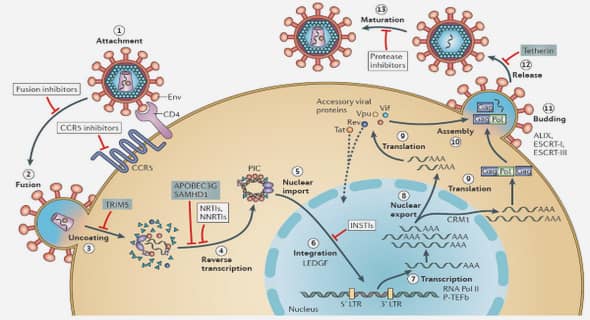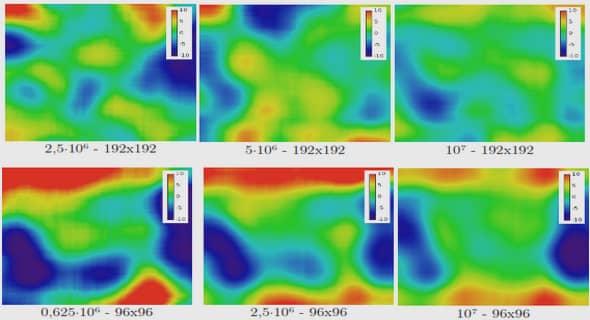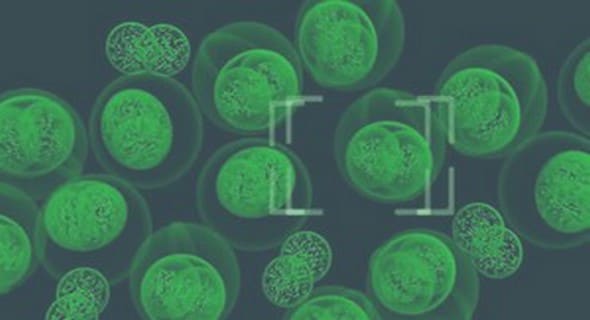Relations sulfates/carbonates pendant la diagenèse des sédiments marins
Introduction
Les concrétions dolomitiques découvertes lors de campagnes de terrain en Juin 5 contiennent différents ciments carbonatés et sulfatés supposés s’être formés au cours de la diagenèse d’enfouissement (dolomite, calcite, célestine et barytine). Ils apparaissent dans des structures telles que des fractures septariennes, tectoniques ou encore des traces de bioturbations (Hoareau, 6). Les marnes qui contiennent ces concrétions sont elles-mêmes recoupées par des fractures tectoniques contenant de la calcite et de la célestine, témoignant de mouvements cisaillants associés à la structuration tectonique du bassin d’Ainsa. Dreyer et al. (99) ont montré que les dépôts constituant le complexe deltaïque du Sobrarbe ont subi un enfouissement inférieur à 2 km. Les concrétions contenant les phases diagénétiques étudiées au cours de ce travail ont initialement été décrites dans deux affleurements très proches (Sud et Biñas d’Ena) puis, au fur et à mesure des investigations effectuées au cours des missions de terrain (Septembre 6, Janvier 7, Novembre 7 et Mars 8), décrites à différents endroits, au nordouest du delta et toujours dans des marnes du FA1. Après avoir localisé et décrit les différents emplacements contenant les concrétions carbonatées, nous présenterons les méthodes analytiques utilisées pour leur étude. Par la suite, les premiers résultats seront présentés grâce à une étude des concrétions et des ciments qu’elles contiennent réalisée sur un emplacement découvert dès 5 (Biñas d’Ena) (Hoareau et al., 9). Dans la section suivante, nous présenterons les résultats obtenus au cours des deux années suivantes sur l’ensemble des affleurements à partir d’une étude intégrant relevés de terrain, observations pétrographiques, analyses isotopiques et microthermométriques. Une section sera par la suite consacrée aux conditions de précipitation des dolomites, grâce à une étude de la composition des marnes et des concrétions sur roche totale. Enfin, nous proposerons une interprétation des résultats en termes de conditions de précipitation des différentes phases et les comparerons aux études déjà effectuées dans le bassin d’Ainsa, au sein des dépôts du Hecho Group.
Localisation des concrétions carbonatées dans le delta
Les concrétions carbonatées étudiées au cours de ce travail ont été échantillonnées à 8 emplacements différents (Figure 2.1), qui seront nommés champ par la suite. Parmis les champs étudiés, 4 appartiennent à une seule séquence (séquence de Biñas) définie pendant le travail de Callot et al. (9) (Figure 2.2). Du sud vers le nord, nous trouvons les champs suivants, nommés en fonction de la microtoponymie locale ou de repères topographiques utiles (les noms des échantillons, prélevés lors de différentes missions depuis 6, ne respectent pas toujours la nomenclature élaborée au fur et à mesure des découvertes): – le champ Sud (Figure 2.3) dont les concrétions sont au nombre de et nommées « S », est situé à seulement m du champ Biñas d’Ena, dans la même série. La succession marneuse contenant la majorité des concrétions a une épaisseur d’environ 3 mètres. Elle repose sur une série marneuse épaisse constituant le sommet de la formation de Las Gorgas, dans laquelle passe la cicatrice d’instabilité S2 définie par Callot et al. (9). Les deux séries sont séparées par un niveau de grès silteux bioturbés (FA2) d’environ 1 m d’épaisseur et contenant aussi des concrétions dolomitiques comparables à celles décrites par Dreyer et al. (95). Le sommet de la série évolue vers le faciès FA2, marquant le passage à l’unité de Barranco El Solano. Les faciès marneux sont bien lités, ont une couleur gris foncé et sont riches en nodules d’oxydes de fer résultant de l’altération de pyrite. Les concrétions sont principalement alignées dans une même couche, 1 m au-dessus des grès FA2. Elles présentent plusieurs types de morphologies : ovoïdes, allongées ou de forme complexe (Figure 2.3C) et renferment des ciments de calcite et de célestine. Leur diamètre varie entre environ 3 cm et presque 2 m ;
Pétrographie : optique, MEB et cathodoluminescence
Les concrétions carbonatées et les marnes qui les contiennent ont été caractérisées sur échantillons bruts et polis et à partir de 65 lames minces, en utilisant la pétrographie optique, la cathodoluminescence et la microscopie optique à balayage (MEB), associé à un spectromètre à énergie dispersive (EDS). Les observations optiques ont été réalisées sur échantillons bruts et polis à la loupe binoculaire, et sur lame mince polie. Les observations au MEB, réalisées au LMTG, ont été faites sur un appareil JEOL 636LV avec un voltage d’accélération électronique de kV, en mode rétrodiffusé ou secondaire selon les circonstances. La spectrométrie EDS associée au MEB utilise un détecteur Sahara PGT. Les observations en cathodoluminescence ont été faites sur un appareil CITL Cold Cathode Luminescence 8 MK4, avec un voltage d’accélération de 12.5kV en moyenne et une intensité de 2 µA au Laboratoire Géosystèmes de Lille. L’acquisition des images, réalisée avec une caméra Diagnostic SPOT FLEX, a été faite sur des temps de pose d’environ 3 minutes en raison de la très faible luminescence de la majorité des phases étudiées.
Pétrographie et microthermométrie sur inclusions fluides
Les inclusions fluides sont des cavités piégées dans les minéraux durant ou après leur croissance. Piégées dans des minéraux diagénétiques, elles peuvent fournir des informations sur la nature des fluides au moment de la précipitation du minéral considéré ou sur des fluides postérieurs à sa formation. Leur étude passe par plusieurs techniques : observations pétrographiques, analyses microthermométriques ou encore analyse géochimique direct du contenu des inclusions. Au cours de cette étude nous avons uniquement procédé à une étude pétrographique et microthermométrique détaillée des calcites, célestines et barytines. L’étude pétrographique s’est basée sur l’approche proposée Goldstein and Reynolds (94) : la discrimination de plusieurs types d’inclusions fluides pouvant avoir une origine différente au sein d’un même cristal passe par l’identification de différents assemblages d’inclusions fluides (fluid inclusion assemblage ou FIA) en fonction de leur taille, forme, rapport vapeur/liquide pour les inclusions biphasées mais aussi de leur position au sein du cristal : le long d’une fracture cicatrisée (inclusions secondaires ou pseudo-secondaires) ou le long de bandes de croissance du cristal (inclusions primaires). La pétrographie des inclusions fluides a été effectuée sur des lames minces polies, des lames épaisses polies sur les deux faces (1µm) ou sur des esquilles polies sur les deux faces à l’aide de poudre d’alumine .4 µm. La microthermométrie sur inclusions fluides consiste à chauffer puis à refroidir les inclusions afin d’obtenir, via les températures de transition de phase, des informations quantitatives sur les conditions thermiques et barométriques lors de la précipitation des minéraux ainsi sur la nature des fluides piégés dans les inclusions. Pour cela, plusieurs températures de transition de phase doivent être mesurées avec précision lors des manipulations de refroidissement : la température de début de fusion de la glace ou eutectique (Te) à partir de laquelle est déterminée la composition du sel présent dans l’inclusion, la température de fin de fusion de la glace (Tfg) qui permet de déterminer la concentration en sels de l’inclusion et la température d’homogénéisation (Th), mesurée au cours du chauffage, qui permet de déterminer une température minimale de piégeage des fluides à partir d’inclusions biphasées (liquide + vapeur). Les mesures microthermométriques ont été réalisées à l’aide d’une platine chauffante et refroidissante (cooling heating stage) USGS Fluid Inc.TM au Laboratoire Géosystèmes de Lille, ainsi qu’à l’aide d’une platine automatique Lincam THMSG6 au LMTG. La salinité des fluides piégés dans les inclusions a été déterminée dans le système NaCl-H2O à l’aide du programme BULK (Bakker, 3).
INTRODUCTION |