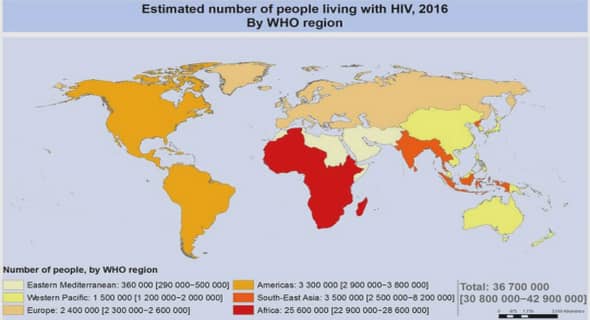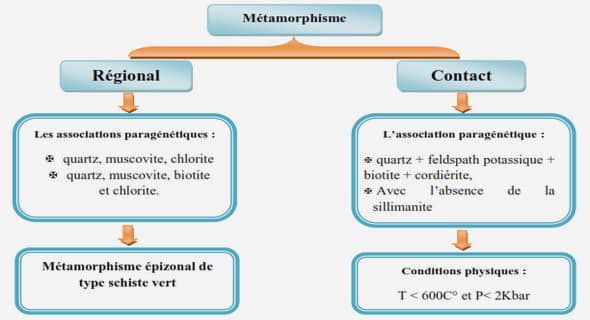La conférence de Messine : une date importante ?
Il est donc acquis que la conférence de Messine permet la relance de la construction européenne. Si cette idée semble acquise au sein de travaux historiques, en est-il de même parmi les acteurs de l’époque et dans la presse régionale ?
Voyons d’abord comment cette conférence est traitée au sein des journaux. Il est noter que cette conférence n’est placée en première page dans aucun des quotidiens. De plus, le traitement qu’en font les trois journaux est très différent.
Parlons tout d’abord du Républicain Lorrain qui consacre très peu d’articles à la conférence qui se tient du 1er au 3 Juin 1955. Pas de une donc mais aussi des articles très courts12. Ce traitement tranche avec celui de Ouest-France qui est plus fourni. Toutefois, il ne faut pas croire que le quotidien de l’ouest propose des articles détaillés. Néanmoins, contrairement au Républicain Lorrain, l’intérêt de Ouest-France pour la conférence de Messine est présent. Le quotidien y consacre donc 3 articles entre le 2 et le 5 Juin 1955. Aucun d’entre eux n’est présent en première page. Il est possible de trouver ces articles dans les pages d’actualité nationale et internationale (dans Ouest-France il s’agit des pages 3-4-5)13. Le Dauphiné Libéré traite de cette conférence dans trois articles dont les titres figurent en première page14. Maintenant que nous avons traité la question du placement des articles sur la conférence au sein des quotidiens, voyons la lecture qu’en font les trois journaux.
Pour le Républicain Lorrain, la question est plutôt simple et rapide. En effet, le quotidien présente cette événement comme une simple réunion du pool charbon-acier. Aucune référence n’est faite à une potentielle relance européenne. Au mieux, on trouve quelques indications très brèves sur les décisions prises. Mais il n’y a pas d’enthousiasme notable15.
Le suivi effectué par Ouest-France est plus fourni. Tout d’abord, le journal parle clairement de « relance européenne ». Une relance qui fait donc suite à l’échec de la CED. Le journal va même plus loin et donne à la conférence de Messine « un intérêt particulier dans l’histoire de l’édification de l’Europe ». Dans l’article du 2 Juin 1955, le journaliste parle d’une proposition d’intégration économique par la suppression des droits de douane. Cette idée est issue d’un mémorandum des pays du Benelux. L’auteur trouve donc ce projet intéressant mais émet une première réserve. Il estime que « l’Europe des Six n’est pas encore mûre pour une union douanière ». Il semble convaincu que les autres projets du mémorandum ont une chance d’aboutir : en revanche, les suggestions d’un mémorandum qui visent une mise en commun pour la CECA du réseau des transports européens, de l’énergie électrique et de l’utilisation pacifique de l’énergique atomique, semblent devoir aboutir à des résultats plus tangibles »16. Cette remarque est intéressante, dans la mesure où c’est exactement l’effet inverse qui se produira : à l’exception de la mise en place de l’EURATOM pour l’énergie atomique, les autres dossiers évolueront très peu au cours de la période qui nous concerne. À l’inverse, l’union douanière pourra être réalisée. Le 3 Juin 1955, Ouest-France traite dans ses pages internationales de l’examen par les Six des propositions du Benelux. L’article est plutôt court et comporte relativement peu d’éléments. On peut néanmoins noter les prémices du débat sur la supranationalité. En effet, l’auteur évoque les positions des différents pays. Il souligne la préférence du Benelux et de l’Italie en une « intégration » afin d’aller plus loin dans la construction européenne tandis que la France et l’Allemagne semblent davantage favorables à la création de communautés spécialisées17. Il faut souligner que les termes d’intégration et de construction sont employés de la même façon par les quotidiens. Il ne font aucune distinction entre les deux termes. Ce qui n’est pas le cas de certains historiens dont Marie-Thérèse Bitsch qui sépare l’intégration européenne, qui correspond simplement aux structures supranationales crées, de la construction européenne, qui est un processus plus large18. Ainsi lorsque ces termes seront employés dans ce travail, ils seront utilisés suivant le sens que leur donne les quotidiens c’est-à-dire celui de simples synonymes. La conférence de Messine se terminant, le journal dresse un premier bilan. Tout d’abord, le titre de l’article des 4 et 5 Juin évoque donc un accord sur un programme d’intégration progressive. Sur les conditions de cet accord, aucune mention n’est faite. Au final, l’auteur estime que le bilan est plutôt bon : « Ainsi la conférence de Messine a fait une œuvre beaucoup plus positive que les sceptiques ne l’imaginaient ». Il juge donc que la conférence est réussie et on sent dans ce constat, une adhésion à l’idée d’une Europe unie. Un sentiment confirmé par la conclusion de l’article : « La relance est faite. Le rythme est fixé. Il est prudent plutôt que rapide. Mais la marché est reprise ». En revanche, aucune remarque n’est faite sur la création d’un comité chargé d’élaborer un texte en vue d’une intégration économique. Ce groupe de travail qui porte le nom de comité Spaak, du nom de son président, Paul-Henri Spaak, homme politique belge, ne fait l’objet d’aucun article durant ses travaux.
La conférence de Messine ne fait pas l’objet d’un intérêt particulier au sein du Dauphiné Libéré. Bien sûr, le journal traite l’évènement et y consacre tout de même une partie de sa première page. On retrouve dans ce suivi deux idées. Tout d’abord, celle d’une « relance européenne » que doit permettre cette réunion des Six. Pour reprendre les termes du quotidien, il s’agit de « tenter de dégager le mouvement d’unification européenne d’une stagnation de neuf mois »19. Ensuite, le journal présente les conceptions européennes des différents pays : « une fusion générale et progressive de certains droits souverains » pour le Benelux et l’Italie, « une intégration progressive par secteurs » pour l’Allemagne et la France20. On retrouve ici les prémices de ce qui sera plus tard le débat sur la supranationalité. Ouest-France faisait d’ailleurs une observation similaire dans son traitement de la conférence.
Donc, le Républicain Lorrain se contente de relayer l’information. En revanche, Ouest-France et dans une moindre mesure le Dauphiné Libéré, analysent cette conférence. Ils en font d’abord un moyen pour relancer l’intégration européenne.
Ainsi, des acteurs de l’époque, en l’occurrence la presse régionale, considèrent la conférence de Messine comme celle de la « relance européenne ». Cette idée n’est donc pas admise uniquement par les historiens. Elle est déjà évoquée par des contemporains. Ouest-France est le seul à véritablement prendre position. En se félicitant des avancées des Six, le journal prouve son adhésion à la construction de l’Europe. Néanmoins, il estime que cette construction doit se faire en suivant les mêmes voies que celles empruntées par la CECA. En effet, la proposition de mise en commun des transports et de l’énergie (électrique ou atomique) suscite une approbation plus grande que le projet d’union douanière. Un projet pour lequel l’Europe des Six n’est pas mûre »21. Toutefois, la perspective d’une politique énergétique commune est dans la lignée de la CECA qui a présidé la mise en commun de deux ressources énergétiques majeures : le charbon et l’acier. Le suivi de cette réunion ouvre également la voie à des débats ultérieurs. Ouest-France et le Dauphiné Libéré mettent en avant les différences de conception entre les partenaires européens sur le sujet de la gouvernement européenne. Enfin, Ouest-France souligne le caractère historique de ce rendez-vous qu’est la conférence de Messine montrant que le quotidien estime que la construction européenne s’inscrit dans l’histoire et que chaque grand moment de la conception de l’Europe est une date historique majeure.
Si la conférence de Messine est considérée comme celle de la relance, la conférence de Venise doit aboutir à un accord sur le rapport Spaak. Le Républicain Lorrain y consacre deux courts articles. Ces derniers évoquent d’abord une unification européenne qui marque le pas depuis l’échec de la CED. Nous avons à nouveau ici l’idée de « relance européenne ». Cette notion fait, pour la première fois, son apparition dans les pages du journal. Les propositions du comité Spaak sont très rapidement résumées : le marché commun, pour une union douanière et la libre circulation des marchandises et capitaux, et l’Euratom, pour une « mise en commun des ressources et des capitaux destinés aux travaux nucléaires »22. Le second article n’est pas plus dense que le précédent mais comporte quelques informations en plus. En effet, bien qu’un accord se dessine, le journal insiste sur les propos du ministre italien des Affaires Étrangères, Gaetano Martino, qui précise qu’un accord sur le rapport Spaak ne veut pas dire une acceptation de « toutes les modalités des futures conventions ». Le journal ajoute que les points litigieux (sans les préciser) seront tranchés par les ministres des Affaires Étrangères des Six23. Autant dire que cette conférence n’éveille pas un vif intérêt au sein du Républicain Lorrain. De plus, le journal ne montre pas son approbation à la construction européenne.
Ouest-France est, en revanche, plus loquace sur le sujet. Deux larges articles traitent de cette conférence dans les pages internationales. Dans le premier d’entre eux, Jacques Niobel revient d’abord sur les évènements qui ont conduit à cette réunion des Six à Venise en insistant particulièrement sur l’idée de « relance européenne ». Il présente ensuite les projets issus du rapport Spaak. On y retrouve plus ou moins les mêmes définitions que le Républicain Lorrain si ce n’est que celles données par Ouest-France sont plus détaillées. Le quotidien breton évoque par exemple la suppression des contingentements d’importations là où le Républicain Lorrain se contente de parler uniquement de la suppression des taxes douanières. Pour l’Euratom, Ouest-France parle d’une politique commune de l’énergie nucléaire (investissements, installations communes…). Il apporte également quelques précisions sur le mode de fonctionnement de ces institutions et évoque un mode de direction similaire à celui de la CECA (Haute Autorité, conseil des ministres). Sur la conférence, Jacques Niobel ne s’attend pas à de grandes avancées : « Les six ministres auront certainement du mal à se mettre d’accord sur ces deux communautés en une seule conférence. Il ne faut donc pas s’attendre à des résultats décisifs ». Il explique cela par le fait que la France sera sans doute réticente à l’idée d’un marché commun à cause du manque de compétitivité de ses entreprises face à la concurrence extérieure. En revanche, la France semble plus intéressée par l’Euratom. Ainsi, selon Jacques Niobel, on peut s’attendre à une sorte de « marché » : les partenaires accepteraient l’Euratom à condition que la France accepte le marché commun. Jacques Niobel pense également qu’il serait possible de commencer par l’Euratom et de poursuivre les négociations sur le marché commun afin de tenir compte des spécificités françaises. Toutefois, rien n’indique non plus que l’Euratom sera accepté par tous. En effet, Jacques Niobel souligne les réticences de l’Allemagne qui estime que la France aurait trop d’avance dans le domaine du nucléaire24. Le premier article pose donc les objectifs et enjeux de la réunion des Six. Le second porte plutôt sur les résultats. D’abord, Jacques Niobel fait part de la satisfaction des milieux diplomatiques face à l’accord sur les propositions du rapport Spaak. Une situation qui surprend le journaliste qui, dans son article de la veille, ne s’attendait guère à de grands résultats :
• On n’espérait pas aboutir si vite, ni faire un si grand pas en avant ». Jacques Niobel conclut finalement son article en estimant que la « relance européenne soit entrée à Venise dans une bonne voie : celle de la compréhension mutuelle et de l’efficacité »25.
Tout comme les deux autres quotidiens, le Dauphiné Libéré consacre deux articles à la conférence de Venise. On y retrouve là encore une définition courte des projets européens. Le Dauphiné Libéré insiste davantage sur l’Euratom. Tout comme Ouest-France, il estime que l’Euratom devrait entrer en application avant le marché commun. Le journal justifie cette position par le fait que l’énergie atomique est encore « dans l’enfance » en Europe et que l’Euratom ne viendra pas bousculer de situation établie26. Toutefois, le Dauphiné Libéré met en avant un problème que pourrait poser l’Euratom. Il s’agit là d’un problème politique et militaire puisqu’il concerne la question de l’arme atomique. Le journal s’interroge : « L’Euratom sera-t-il limité aux utilisations pacifiques de l’énergie atomique ou son activité s’étendra-t-elle à la fabrication des armes nucléaires ? ». Le quotidien ne prend toutefois pas position sur ce problème27. Du côté du marché commun, le Dauphiné Libéré voit dans les différences de fonctionnement économique, de graves difficultés, ne serait-ce que sur la question des charges sociales. Au final, la conférence de Venise se conclut sur un « résultat positif » toutefois nuancé par de nombreuses réserves dont la compétitivité économique de la France fait partie. Le journal se satisfait également de la possible intégration des TOM français dans le marché commun28. Il s’agit là d’un thème sur lequel le Dauphiné Libéré se démarque. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Comme avec la conférence de Messine, Ouest-France rentre davantage dans le détail. Le Républicain Lorrain reste dans la simple transmission de l’information. La notion de « relance européenne » est à nouveau présente et elle fait même son apparition au sein du Républicain Lorrain29. Donc, le processus partant de la conférence de Messine est bel et bien, du point de vue des contemporains, un moment de relance de l’unification européenne. Le Dauphiné Libéré fait part de son sentiment pro-européen puisqu’il parle de « résultat positif » lors de la conférence de Venise, ce qui montre son accord à un processus d’intégration européenne30. Enfin, le Dauphiné Libéré manifeste un intérêt plus vif pour l’Euratom. Au delà du projet d’Euratom, le quotidien pose un problème politique lié à ce projet : la question de l’arme nucléaire. Ainsi, il faut remarquer que le Dauphiné Libéré adopte une vue plus large et montre bien la dépendance entre les projets européens et la situation internationale. La question des armes nucléaires et notamment de leur prolifération est très présente dans le monde de l’époque; l’Euratom est au cœur de ce problème et le Dauphiné Libéré est, des trois quotidiens, le seul à souligner cet aspect. Il est aussi possible d’y voir un début d’intérêt pour un thème précis, en l’occurrence, l’Euratom. La conclusion d’un des deux articles du Dauphiné Libéré qui évoque une possible association des TOM au processus d’intégration économique européenne peut constituer un autre thème susceptible d’attirer l’attention du quotidien.
Ces conférences conclues, l’Euratom et le marché commun, projets pouvant permettre la relance de la construction européenne, sont en bonne voie. Les traités doivent, une fois rédigés, être acceptés par l’Assemblée Nationale. Le débat les concernant est l’occasion pour les journaux de donner leur position sur l’Europe et d’employer divers arguments visant à défendre l’intégration européenne.
Le débat parlementaire français : enjeux et prises de positions des journaux
Le débat parlementaire sur les traités de Rome débute le 15 Janvier 1957 à l’Assemblée Nationale. Le Républicain y consacre des articles quasi-quotidien. Les deux premiers jours de débat font l’objet d’une mise en première page31. Le vote favorable aux traités fait aussi l’objet d’un article en première page32. La situation est identique pour Ouest-France et le Dauphiné Libéré : articles quasi-quotidiens en première page33. Dans chacun des journaux, les débats sont rapportés et les arguments principaux des élus qui interviennent sont repris. Ces arguments sont les suivants : les « anti » craignent de devenir le vassal économique d’une Allemagne plus solide alors que les « pro » estiment que le rejet de l’intégration économique européenne entraînerait le déclin et la misère de la France34. À noter que le Républicain Lorrain a la particularité d’évoquer les interventions et les votes des députés locaux: l’on apprend ainsi que M. Engel, député de Moselle, voit dans le marché commun une nécessité, et un moyen pour « survivre et même pour mieux vivre »35. Ouest-France, de son côté, s’intéresse davantage aux positions du MRP et notamment celle de Pierre-Henri Teitgen, député breton d’Ille-et-vilaine36.
La couverture du débat parlementaire française est aussi l’occasion de découvrir différents intervenants sur les questions européennes et politiques. Faisons un rapide tour d’horizon de ces journalistes. Du côté du Républicain Lorrain, nous pouvons citer Jean Benedetti. À son sujet (et aux sujets des intervenants des autres journaux), peu d’informations sont disponibles. Du côté de Ouest-France, François Desgrèes du Lou et Bertrand De Jouvenel. Le second est particulièrement connu. Né en 1903 et décédé en 1987, Bertrand De Jouvenel a plusieurs casquettes : journaliste, écrivain, politologue. Il n’interviendra qu’une seule fois dans Ouest-France37. François Desgrées du Loû est le cofondateur de Ouest-France dont il sera le directeur adjoint de 1944 à 1965. Il est également le beau-frère de Paul Hutin-Desgrées qui intervient également dans Ouest-France38. Enfin, Pierre-Laurent Darnar réalise des éditoriaux sur la question européenne au sein du Dauphiné Libéré. Né en 1901 (décès en 1979), il est le rédacteur en chef du Dauphiné Libéré depuis 195139.
Maintenant que les présentations des intervenants sont faites, il est temps de se pencher sur le contenu de ces articles et surtout sur la position prise par ces intervenants. Commençons d’abord par le Républicain Lorrain. Avant d’en venir aux arguments en faveur du traité, le marché commun est d’abord présenté comme un des volets de la relance européenne. L’EURATOM est également brièvement évoqué mais peu de précisions sont apportés. Le journal s’efforce de donner une définition simple du marché commun, il parle même d’une « CECA en plus simple ». Cette présentation n’oublie pas les problèmes qui pourraient se poser : la question de l’intégration des DOM-TOM dans le marché commun et la spécificité de l’agriculture dans le cadre d’une union douanière. De plus, le journal souligne également les grandes différences sociales entre les Six et de la nécessité d’harmoniser ces dernières (salaires différents, congés payés, sécurité sociale, retraite). Le Républicain Lorrain se demande si les avantages sociaux français ne risquent pas de pénaliser la France au sein du Marché commun40. Ainsi sans harmonisation des charges sociales, s’engager dans le Marché commun serait « périlleux »41. L’un des premiers arguments mis en avant est l’efficacité économique de la France qui se trouverait améliorée par le marché commun42. En effet, pour Jean Benedetti, l’entrée de la France dans un marché commun permettrait d’accélérer son développement économique43. Le marché commun représente la « dernière chance » de la France qui, en cas de refus, s’isolera et déclinera44. Nous pouvons donc voir ici des arguments économiques. Jean Benedetti est favorable à une adoption rapide du traité afin d’éliminer le spectre de la CED : il faut « Décider clair et net »45. Enfin, le quotidien s’interroge également sur l’attitude qu’adoptera l’Angleterre vis-à-vis de ce marché commun46. Mais nous aurons l’occasion d’en reparler dans la troisième sous-partie.
L’un des premiers arguments de Ouest-France est de présenter le marché commun comme un marché du même ordre que celui des États-Unis et de l’URSS. Ce marché commun permettrait « d’éviter la décadence de l’Europe », car « la dispersion en une poussière de nation est une mort à bref délais »47. Le journal insiste également sur les efforts d’adaptation que devra faire l’économie française avant d’entrer dans ce marché commun48. Nous pouvons voir ici une argumentation proche de celle du Républicain Lorrain. Toutefois, à ces arguments d’ordre économique, Ouest-France ajoute une dimension plus politique. Le journal estime que la construction de l’Europe est « d’un importance primordiale » dans la « situation internationale »49. L’Europe pourrait représenter un « troisième pôle » face aux deux grands blocs que sont les États-Unis et l’URSS50. Cet argument revient à de nombreuses reprises dans les interventions des différents journalistes. Il est ainsi mis en avant par Bertrand De Jouvenel et par François Desgrées du Loû51. L’Europe constitue enfin un « postulat pour la paix » comme l’indique le titre d’un article du 23 Janvier car elle représente à la fois un contrepoids aux puissances américaine et soviétique mais symbolise également la fin du conflit France-Allemagne52. Néanmoins, le journal se pose de nombreuses questions sans y apporter de précisions. Nous l’avons dit plus haut, Ouest-France estime que l’économie française devra faire un important effort d’adaptation afin d’entrer dans le marché commun. Mais tout comme le Républicain Lorrain, le quotidien s’interroge sur les différences de charges sociales entre les Six. L’argument revient à plusieurs reprises. Tout d’abord, le 17 Janvier 1957 dans un avis de Bertrand De Jouvenel53. On en trouve également trace dans un article des 19-20 Janvier. Dans les deux cas, on insiste sur la nécessité d’harmoniser les charges sociales entre les Six. Enfin, le journal s’interroge sur la place de l’agriculture54 et l’attitude de l’Angleterre vis-à-vis de la CEE55, sans toutefois donner plus d’éléments.
Du côté du Dauphiné Libéré, on peut retrouver les mêmes arguments qu’ailleurs. Ainsi, le journal parle de la « nécessité de salut commun »56. Mais globalement le Dauphiné Libéré semble moins s’intéresser à ce débat parlementaire. Les articles sont certes tout aussi nombreux mais plus courts et prennent rarement parti. Comme le Républicain Lorrain et Ouest-France, le Dauphiné Libéré pose la question du poids des politiques sociales dans les Six57. Le journal s’efforce de poser les risques et les avantages du marché commun et tente d’adopter une démarche explicative et démonstrative, chiffres des productions des Six à l’appui58. Ces avantages et inconvénients du marché commun sont les mêmes que ceux évoqués dans les deux quotidiens : ce marché évitera à la France de se retrouver isolée59 à la condition que les politiques sociales des Six soient harmonisées60. Toutefois, le Dauphiné Libéré se démarque sur quelques points. D’abord, il s’intéresse à l’intervention dans le débat parlementaire de Maurice Faure, député radical-socialiste du Lot qui souligne le rôle que pourrait jouer l’Europe comme investisseur permettant la reconversion d’entreprises et la mise en valeur de régions sous-développées61. Il s’agit de la première fois que la question des régions apparaît dans ce débat sur la construction européenne. En effet, Le Républicain Lorrain et Ouest-France n’ont pas évoqué la question du développement régional dans le cadre de ce débat sur le marché commun. Ensuite, si les deux autres quotidiens s’inquiètent soit d’éventuelles difficultés sur l’agriculture soit s’interrogent sur sa place dans ce marché commun, le Dauphiné Libéré estime qu’il est, au contraire, une chance pour cette dernière d’obtenir plus de « sécurité et de prospérité »62. Mais le journal n’apporte pas plus de précisions sur cet argument. Il doit sans doute penser ici au chances de débouchés pour les agriculteurs dans le cadre du marché commun. Enfin, nous pouvons noter un dernier élément intéressant. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un argument en faveur de l’Europe mais plutôt d’une idée sur son développement et sur le rôle que la France pourrait occuper en son sein. C’est le titre d’un éditorial de Pierre-Louis Darnar dans l’édition du 23 Janvier 1957 qui attire l’attention sur une thématique qui sera propre au Dauphiné Libéré : « De la France à l’Europe et à l’Eurafrique ». Plutôt avare en information sur cette thématique, cet article constitue toutefois le point de départ d’un thème apparaissant uniquement au sein du Dauphiné Libéré.
Nous avons donc pu voir ici différents points de vue et arguments sur la création d’un marché commun, ce qui nous permet de connaître les causes du soutien des quotidiens à la construction européenne. D’abord, il faut noter que le thème intéresse les journaux étant donné le nombres d’articles sur ce thème et leur présence en première page. Au delà du rôle de retranscription des débats parlementaires, chacun des titres met en avant ses propres arguments et insiste davantage sur certains d’entre eux. Bien sûr, nombre d’entre eux peuvent se recouper. C’est le cas des arguments économiques et du risque de déclin de la France en cas d’isolement. L’Europe devient donc un « multiplicateur de puissance » permettant d’éviter un déclin63. Toutefois, les journaux s’intéressent à certaines thématiques bien précises. Par exemple, le Républicain Lorrain ne traite que des aspects économiques et des avantages que l’économie française pourrait en tirer. En revanche, Ouest-France voit dans ce marché commun un moyen de faire contrepoids aux deux géants du monde et de garantir la paix européenne via un axe franco-allemand. Les arguments géopolitiques sont beaucoup plus présents dans les pages du quotidien breton alors qu’ils sont relativement absent dans celle du Républicain Lorrain. Le Dauphiné Libéré reprend à la fois des arguments politiques et économiques mais pose également les germes d’une thématique qu’il faudra approfondir : l’idée d’Eurafrique. Enfin, les quotidiens traitent des problèmes que pourraient poser la construction du marché commun : ils s’interrogent sur la place de l’agriculture dans cette structure et la position qu’adoptera l’Angleterre vis-à-vis de ce processus. Ils évoquent aussi la condition sine qua non au succès de cette entreprise : l’harmonisation des politiques sociales des Six.