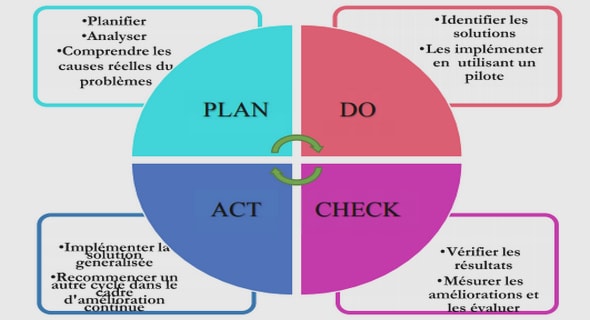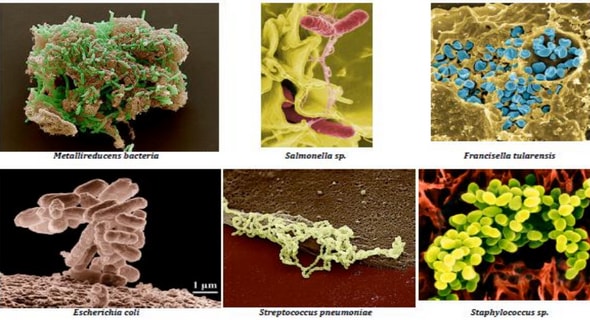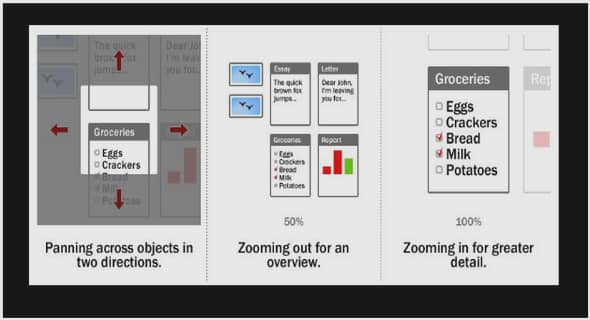Connaître : naissance des études slaves et premières missions géographiques (1840-‐1910)
L’idée que la France révolutionnaire a été un modèle pour les mouvements de libération nationale et sociale dans l’Europe balkanique comme ailleurs, imprègne les historiographies nationales des pays de la région depuis le XIXe siècle. La France, matrice des idées nouvelles, attirerait les élites de toute la péninsule qui viendraient se former à Paris. Même si elle doit être relativisée -les autres capitales européennes comme Vienne, Berlin, Moscou ou Londres sont aussi des lieux importants de formation des élites du Sud-Est européen-, l’attraction française est réelle et plusieurs générations de Balkaniques ‘parisiens’ formeront des précieux intermédiaires pour le développement de la connaissance de cette région en France. Ils seront particulièrement nombreux côté serbe et roumain au début du XXe siècle, et encore plus après 191488.
Au milieu du XIXe siècle, l’élément essentiel qui va structurer les savoirs mais aussi les relations culturelles, intellectuelles et scientifiques entre l’Europe du Sud-Est et la France, est la naissance et le développement des études slaves. On peut fixer le début de leur développement autour de 1840, après l’instauration de la chaire de Littératures d’origine slaves au Collège de France, occupée d’abord par le poète polonais Adam Mickiewicz puis par Cyprien Robert. « Il y a dans la slavistique –plus que dans d’autres disciplines- une forte charge idéologique liée au contexte politique, même si les acteurs s’en défendent », écrit Antoine Marès à propos de la slavistique au XXe siècle. Cette remarque nous semble juste aussi pour le XIXe siècle89. Ce contexte est d’abord celui de l’Europe post-1848 et de la disparition de la Pologne, puis de l’isolement français après la guerre de 1870-1871, et finalement de la nouvelle alliance franco-russe (1890). Dans ces enjeux, les Balkans occupent une position périphérique. Ils ne sont pas non plus au centre de l’intérêt des savants et de la nouvelle slavistique. En effet, en abordant ces territoires par la slavistique, on comble certes une lacune, mais on fixe en même temps pour les années à venir et d’une certaine façon jusqu’à aujourd’hui, le cadre d’une approche de la région qui exclut les populations non slaves, en particulier les Grecs, les Roumains, les Albanais, les Hongrois et bien sûr les Turcs. Il s’agit d’une approche par la langue et la culture, mais qui prête moins d’attention à la continuité territoriale et s’intéresse d’abord aux nations chrétiennes naissantes. Pour les Balkans, cela aura des conséquences sur l’invisibilité des continuitéshistoriques byzantines et ottomanes et donc sur l’histoire de la longue durée est-européenne et balkanique qui commence seulement en France à être défrichée90.
Les études slaves et les Slaves du Sud
C’est dans les années 1880 que les études slaves prennent leur envol en s’affranchissant du cadre posé par les émigrants polonais et les amateurs éclairés grâce à Louis Leger, qui après avoir étudié plusieurs langues, occupera la chaire de langue et littérature slaves du Collège de France de 1885 à 1923 à la succession d’Alexandre Chodźko. En effet, Leger est le premier à ouvrir la voie à l’expression de la diversité de l’Est européen, alors que la vision française restait jusqu’à la fin du Second Empire largement influencée par une immigration aristocratique polonaise, très présente dans la presse et la sphère politique. Des Polonais, souvent prompts, selon Leger, à dénigrer le panslavisme et à défendre les Autrichiens ou les Turcs, à condition qu’ils s’opposent à la Russie, et à minimiser en France les revendications légitimes des Slaves, soumis à la domination des Empires. Durant cette période pionnière, le professeur d’université est aussi un voyageur, un des premiers Français maîtrisant plusieurs langues de la région, un témoin privilégié de son temps et un ami des intellectuels de l’Est qui, pour un grand nombre, deviendront des hommes politiques de premier plan à la faveur des indépendances en 191991.
Leger, grand connaisseur de l’espace slave, a les moyens d’une vraie comparaison. Il n’est pas uniquement un spécialiste de la Russie, contrairement au tropisme que prendront après 1945 les études slaves qui négligeront particulièrement sa composante balkanique. L’évolution de ses positions sur l’Autriche-Hongrie nous donne une indication précieuse sur l’évolution de la vision politique de l’Est européen dans la France de la seconde moitié du XIXe siècle. En particulier sous l’influence de l’homme politique et grand historien tchèque František Palacký et de son gendre František Ladislav Rieger, il est d’abord partisan du fédéralisme et croit encore en 1878 que la Double Monarchie a un rôle à jouer dans les Balkans contre l’influence russe. Dans ce cadre, il apporte son soutien aux Slaves du Sud92, auxquels il propose le nom de Confédération illyrienne ». En 1878, après l’annexion de la Bosnie-Herzégovine, il est beaucoup plus critique envers la Double monarchie qui se transforme à ses yeux en vassale de l’Allemagne et à partir des années 1890, il se prononce clairement en faveur de sa disparition93.
Significatif est le rôle de l’archevêque catholique de Djakovo, Josip Juraj Strossmayer, dans l’adhésion des érudits français à la cause des Slaves du Sud. Louis Leger le rencontre pour la première fois à Vienne en 1867, alors que le prélat a été éloigné de Zagreb par l’Empereur, au moment où se négocie l’Accord croato-hongrois complétant le Compromis austro-hongrois. Avec lui, l’archevêché de Djakovo est devenu un foyer culturel important visité par de nombreux étrangers, parmi lesquels les Français sont, des Occidentaux, les plus nombreux94. Ainsi, avant les guerres balkaniques et la Grande Guerre, la cause de l’union des Slaves du Sud est-elle introduite en France via des liens intellectuels avec des Croates plutôt que par des relations directes politiques ou intellectuelles avec le jeune Royaume de Serbie. La destruction de la Yougoslavie dans les années 1990-2000 a ré-ouvert le débat chez les historiens sur le rôle de la France dans le développement de l’illyrisme, du yougoslavisme puis dans la création du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en 1919. Controversé déjà auparavant, il reste un point d’achoppement dans l’écriture de l’histoire de la Yougoslavie après 1991, en particulier en Croatie. En effet, la vision d’une Yougoslavie, créée sous influence d’une France, amie de la Serbie et qui n’aurait été qu’une grande Serbie déguisée, vient servir l’idée de l’ingérence extérieure et donc légitime sa destruction.
Louis Leger, dans ses écrits, donne la parole à un monde d’intellectuels, de politiques et de ‘patriotes’ européens avides d’échanges, avec lesquels des combats communs s’organisent. On est loin désormais des récits de voyage produits par les diplomates napoléoniens ou d’une littérature en quête d’exotisme pleine de bons sauvages, de brigands cruels et de croyances obscures de la première moitié du siècle. On vient de changer d’époque, avec l’instauration de la IIIe République (1871).
Développement des études slaves et émancipation des peuples
Après Leger (1843-1923), d’autres slavistes ont joué un rôle pionnier dans les relations franco-balkaniques, en particulier Ernest Denis (1849-1921), professeur d’histoire allemande à la Sorbonne, qui, bien que de cinq ans seulement le cadet de Leger et comme lui traumatisé par la défaite de 1870, appartient d’une certaine façon à une autre génération par le rôle qu’il jouera au moment de la Grande Guerre. Après lui, André Mazon (1881-1967), fort également de son expérience militaire et diplomatique développera les études et les échanges pendant plusieurs décennies.
Alors qu’ils sont tous deux des slavisants généralistes, Leger connaît mieux l’espace balkanique que Denis dont l’approche apparaît plus livresque. Cependant c’est ce dernier qui a eu l’influence la plus grande sur le monde politique français et le grand public. La question des Slaves du Sud aurait été une « pomme de discorde entre les deux savants »95. Léger, influencé par Strossmayer et ses idées sur la solidarité slave, exprimait de la sympathie pour les Bulgares et se déclara déçu par la guerre serbo-bulgare (1913). Même pendant la guerre 1914-1918, quand l’opinion publique française fut particulièrement bulgarophobe, il défendit leurs droits. Pour Denis, le moment décisif dans sa perception des Balkans et son engagement en faveur des Serbes a été l’annexion de la Bosnie-Herzégovine par l’Autriche en 1908.
L’influence de ces savants sur la diffusion des connaissances sur les Balkans et l’évolution des perceptions est visible de moult façons. Comme enseignants à l’université française, ils publient dictionnaires, traductions d’œuvres littéraires -en particulier de contes populaires-, ouvrages d’histoires et préfaces de nombreux auteurs secondaires. Ils se révèlent des passeurs efficaces grâce aux liens nouveaux qu’ils ont tissés avec les intellectuels et les politiques est-européens. Ils sont aussi à l’origine des fonds documentaires les plus importants sur la région. Ce sont eux qui constituent les premières bibliothèques spécialisées en langues originales, recevant parfois toutes les publications qui paraissent dans un domaine. Ainsi Louis Leger se vantait-il d’être devenu le correspondant de la Matica serbe de Novi Sad et de l’Académie des sciences de Belgrade96. Intervenant dans des revues, colloques, conférences, ils ont été aussi sollicités par les responsables politiques. Ce rôle politique ira grandissant avec la Première Guerre mondiale et le règlement des conflits.
Comme leurs aînés diplomates, ces savants sont convaincus de l’influence française dans les idées d’émancipation qui animent les peuples du Sud-Est. Nicolae Iorga interprétait le militantisme français pour les petits peuples opprimés des Empires avant 1870 à la lumière des aspirations révolutionnaires déçues des mêmes Français. Pour leur part, les universitaires de la fin du siècle s’appuient sur leur vision d’une France inspiratrice des libertés, qui renforce aussi la croyance en leur propre mission. Cette croyance peut être cependant clivée, car elle s’enracine dans le traumatisme de la défaite de 1870 contre l’Allemagne. L’histoire des Slaves du Sud qui s’écrit à la fin du XIXe siècle, affirme la vision d’une France ‘naturellement’ amie des peuples valeureux qui tentent de s’émanciper d’Empires oppresseurs voués à la disparition. Selon Denis, la France, comme ces peuples, vont dans le sens de l’Histoire.
Sous l’influence à la fois de la philosophie française que les armées révolutionnaires et impériales avaient répandue à travers l’Europe vaincue et docile, et du romantisme qui prêchait le culte des souvenirs populaires et le respect des traditions nationales, les divers groupes de Slaves méridionaux, soulevés et soutenus par l’exemple des Tchèques et le réveil polonais, avaient peu à peu secoué leur torpeur et s’étaient étonnés de leur morcellement97.
Le filtre émancipateur gomme, avant les guerres balkaniques les distinctions et éventuels antagonismes entre les peuples. Chez Denis en particulier, les références à la Serbie sont toujours liées à une interprétation élastique du terme ‘Serbe’ qui recouvre souvent un groupe défini par sa langue, sans marqueur religieux apparent. Il est en cela proche du géographe serbe Jovan Cvijić dans la tradition établie par Vuk Karadžić.
Les missions géographiques
L’autre élément qui contribue à la connaissance des Balkans dans la seconde moitié du XXe siècle, ce sont les missions géographiques effectuées par les Occidentaux pour le compte de leurs gouvernements -mais souvent aussi grâce à des initiatives individuelles- pour combler les lacunes de la connaissance cartographique et ethnographique sur la péninsule. Elles se mettent en place plus tardivement que dans le reste de l’Europe de l’Est, en particulier à cause du manque de coopération déjà mentionné des autorités ottomanes. Les savants sont en France missionnés par l’État, alors qu’ailleurs, comme en Grande Bretagne, les missions sont financées par des fondations. Un des pionniers, côté français fut Ami Boué qui parcourut avec une équipe de collaborateurs l’ensemble des Balkans entre 1836 et 183898. Avant 1850, les savants français s’intéressent d’abord à la Grèce, à Constantinople et aux principautés roumaines, puis, après la guerre de Crimée (1853-1856) au reste de la péninsule.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle et surtout après 1970, dans l’ambiance scientiste de l’époque, les travaux de ces géographes voyageurs sont surtout utilisés pour fixer des réalités objectives concernant les populations, en particulier la description des différents groupes ethniques et leurs localisations, quitte à gommer les zones de mélanges et les incertitudes. C’est le cas des travaux du breton Guillaume Lejean99, le secrétaire de Lamartine déjà mentionné, qui rêve de remonter aux sources du Nil et des Celtes. Il effectuera six missions dans les Balkans pour le compte du gouvernement français. Lejean est notamment l’auteur d’une Carte ethnographique de la Turquie d’Europe et des états vassaux autonomes en 1861, qui se donne comme objectif d’aider à comprendre la question d’Orient. C’est cette carte qui aura la postérité la plus grande dans son œuvre restée inachevée. Elle est pourtant souvent imparfaite et simplificatrice, en particulier parce qu’en fournissant des tracés de grandes zones de peuplements unifiés, elle a pu laisser croire que des États homogènes étaient facilement réalisables100. Cette carte, encore dans le débat lors de la Première Guerre mondiale et en 1919, au moment du tracé des frontières, a aussi été utilisée par différents groupes balkaniques pour faire valoir leurs droits. Les Bulgares notamment, s’y réfèrent pour appuyer leurs revendications sur la Macédoine.
Sans le savoir, Lejean contribue au grand processus de discrimination nationale qui va déchirer les Balkans jusqu’à nos jours. Il fournit des arguments aux tenants de l’État-nation, qui militent pour des territoires ethniquement homogènes et qui n’hésiteront pas à convertir, dénationaliser, déporter ou massacrer ceux qui ne rentrent pas dans le grand dessein unificateur101.
Les corrections que Lejean a apportées lui-même dans des productions ultérieures sont restées sans écho102. Après Lejean qui meurt prématurément en 1871, il faudra attendre le début du XXe siècle pour qu’une nouvelle génération de géographes français commence à s’intéresser aux Balkans, avec souvent comme expérience déterminante les tranchées de 1914-1918 ou le front de Salonique.
Les guerres et la destruction des Empires (1912-‐1919)
Avec les guerres des années 1912-1913 puis le déclenchement du conflit mondial, l’actualité se déroule dans les Balkans : il s’y passe certes des événements locaux, mais surtout des évènements dont les enjeux semblent dépasser de beaucoup le cadre local. Ernest Denis peut écrire en 1915 : « Ainsi s’ouvre le grand conflit qui pour longtemps sans doute, va décider des destinées du monde. Avec les batailles de Koumanovo, de Bitolié, de la Drina et du Roudnik, s’est ouvert une nouvelle période de l’histoire »103. L’attention se focalise sur les Balkans et l’information qui en arrive prend une nouvelle forme : la dépêche d’agence. Les correspondants de guerre deviennent des intermédiaires indispensables, alors que la presse écrite se développe et se massifie. Leurs récits hauts en couleur sont faits pour frapper un large public, ce sont eux qui cristallisent les éléments de balkanisme évoqués plus haut, « en discours articulé »104.
Regard sur les guerres balkaniques
Dans les monarchies européennes -dans les Empire centraux autant que dans l’Empire britannique-, l’assassinat et la défenestration du roi et de la reine de Serbie en 1903 ont profondément choqué l’opinion105, puis l’attentat de Sarajevo du 28 juin 1914 contre l’héritier de la Couronne d’Autriche a propagé l’image du terroriste balkanique. Dans la France républicaine, la perception de ces événements politiques est certes différente, mais la violence des guerres balkaniques, -la première où la coalition serbo-bulgaro-grecque affronte l’Empire ottoman (1912-1913) et puis la seconde où une coalition entre la Serbie, le Monténégro et la Grèce se retourne contre la Bulgarie (1913)-, n’en alimente pas moins l’image de peuples enclins à commettre des actes de barbarie. Ces deux guerres donnent lieu à des protestations contre la cruauté des combats, notamment contre les civils, de la part du monde politique mais aussi des écrivains et intellectuels en Europe et aux États-Unis106. C’est le moment où en France, les prises de position en faveur des Serbes se généralisent.