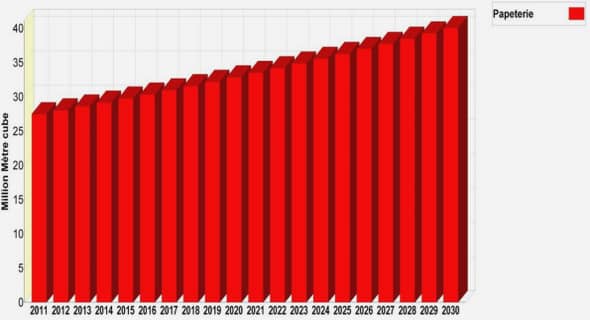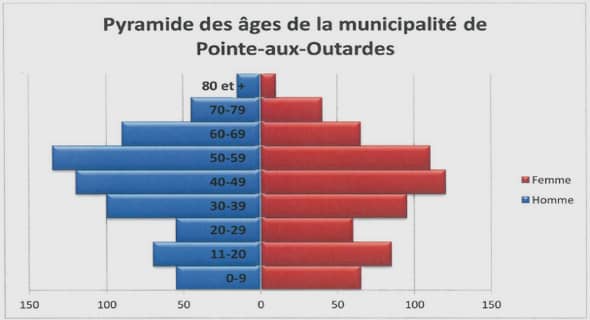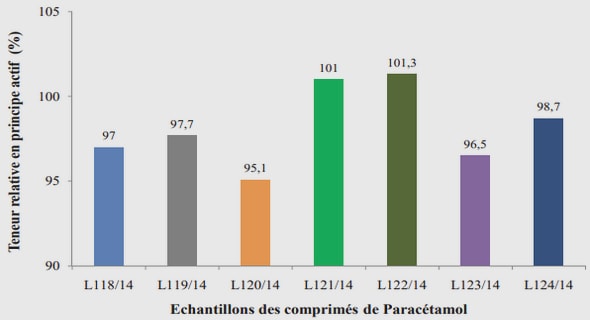La construction des variables
L’enquête Pratiques culturelles ne nous permet d’approcher ces dynamiques que de façon indirecte, en particulier car elle ne renseigne ni un degré de familiarité avec les sciences dans la vie courante ni un niveau de maîtrise des savoirs scolaires considérés comme scientifiques. Pour autant, il nous semble possible d’examiner les différentes formes d’acculturation aux sciences et techniques qui peuvent se faire jour dans les réponses des enquêtés, en nous inspirant de plusieurs des démarches précédemment exposées (Cordier, 1989 ; Archer et al., 2015). Nous avons en particulier repris au projet ASPIRES l’idée de réaliser une analyse en composantes principales (ACP): dans ces études, les sociologues soumettent plusieurs ensembles de questions relatives aux pratiques et attitudes liées aux sciences à une ACP afin de construire des variables composites qui captent un phénomène sous-jacent. Dans notre cas, comme nous ne disposions pas d’autant de variables pertinentes, nous avons décidé de nous limiter à la mise au jour d’une seule variable composite, à savoir le goût pour les sciences.
Pour ce faire, nous avons sélectionné comme variables contributives toutes les pratiques dont nous pouvons penser, en nous appuyant sur la littérature existante, qu’elles puissent indiquer un intérêt pour les sciences qui se serait manifesté au cours de l’année écoulée (Tableau 15): avoir visité un musée ou une exposition scientifique, avoir visité un musée ou une exposition, avoir visité un parc dédié aux sciences (comme la Cité des Sciences), avoir visité un zoo, avoir suivi l’actualité scientifique, avoir consommé des contenus scientifiques sur Internet, avoir lu des livres scientifiques, avoir regardé une série liée aux sciences (en l’occurrence la série « The Big Bang Theory »), avoir fait du bricolage, avoir pratiqué une activité scientifique en amateur. Plusieurs de ces choix méritent cependant d’être explic-ités car ils ne vont pas forcément de soi. Tout d’abord, l’inclusion des visites au zoo, une activité qui peut être perçue a priori comme une simple sortie de divertissement, tient au fait que celles-ci s’articulent en fait fréquemment à des pratiques d’éducation au monde an-imal3 (Vitores, 2019). Il peut également sembler surprenant d’inclure la visite d’un musée ou d’une exposition en général alors qu’une variable renseigne déjà les sorties muséales spé-cifiquement scientifiques. Nous avons ici estimé que nous restreindre aux seuls dispositifs muséographiques explicitement perçus comme scientifiques ou techniques risquait d’occulter que certains supports, bien que non-fléchés comme tels, peuvent parfois remplir un rôle sim-ilaire, par exemple dans des musées d’histoire, des musées d’artisanat ou des écomusées4. Enfin, il nous est apparu pertinent d’ajouter la pratique du bricolage car la littérature exis-tante a mis en lumière que l’initiation à des activités manuelles durant l’enfance constitue un terrain propice au développement d’un sens de l’expérimentation et peut donc favoriser un intérêt durable pour les sciences (Gail Jones, Taylor et Forrester, 2011 ; M. Gail Jones et al., 2017).
Comme nous ne disposons pour toutes ces variables que d’un codage dichotomique (« avoir fait »/« ne pas avoir fait ») et non de fréquences de pratiques, nous avons entrepris de les recoder au format binaire. Nous y avons également adjoint deux variables numériques destinées à capter respectivement le goût pour les contenus documentaires et le goût pour le genre de la science-fiction. Si ce dernier aspect peut paraître plus surprenant, il se justifie selon nous au regard de l’existence documentée de fortes affinités entre consommation de science-fiction et goût pour les sciences, que ce soit chez les enfants (Ho, 2010) ou chez les adultes (Hommel, 2017). Nous avons construit ces deux variables à partir d’un décompte de la consommation déclarée par chaque individu sur plusieurs supports: d’une part « regarder des films de science-fiction », « aller voir des films de science-fiction au cinéma », « regarder des séries de science-fiction » et « lire des livres de science-fiction », d’autre part « regarder des documentaires à la télévision », « aller voir des documentaires au cinéma », « regarder des séries documentaires », « regarder des documentaires sur Internet » et écouter des documentaires à la radio ». Cela nous fait donc un ensemble de 12 variables contributives numériques (Tableau 15).
En parallèle, nous avons mobilisé des variables supplémentaires catégorielles déjà présentes dans la base et pour lesquelles nous avons parfois regroupé certaines modalités: le genre de l’individu, la taille de sa commune de résidence, le nombre de livres lus dans l’année, la filière d’études qu’il suit éventuellement et le fait de résider ou non chez ses parents. Nous en avons également construites certaines. Ainsi, une variable relative à l’origine migratoire éventuelle a été déterminée à partir du pays de naissance renseigné pour les deux parents. Une PCS ménage du foyer parental a été codée en suivant la nomenclature de l’INSEE (dans le cas où un seul des parents renseignait sa PCS, celle-ci était choisie comme référence). Une variable de niveau de diplôme a été constituée à partir du plus haut niveau de diplôme atteint par un des deux parents. Une variable d’activité artistique, destinée à capturer une potentielle interaction du goût pour les sciences avec des pratiques témoignant d’un haut degré de légitimité culturelle, a aussi été codée à partir du fait d’avoir pratiqué au moins une des activités suivantes: peinture, sculpture, musique, photographie. Enfin, nous avons adjoint à ces variables catégorielles une variables numérique renseignant le nombre d’équipements numériques présents dans le logement de l’individu. Nous avons donc utilisé 11 variables supplémentaires, ce qui porte notre total de variables mobilisées à 23. Il faut noter que nous avons choisi de ne pas utiliser la variable de revenu car celle-ci est codée différemment selon que l’individu réside ou non chez ses parents, ce qui produit une distorsion problématique pour notre échantillon. De même, la variable de la spécialité de diplôme n’a pas été exploitée dans la mesure où elle n’est pas indiquée pour les diplômes inférieurs ou égaux au baccalauréat et n’est donc renseignée que pour une petite part de notre échantillon.
La permanence des distinctions de genre et de classe
Dans un premier temps, il est possible de nous demander si le constat dressé précédemment d’un éloignement structurel des filles et des enfants issues des classes populaires vis-à-vis des activités scientifiques se vérifie toujours. Un premier tableau croisé nous permet par exemple de constater que les filles de notre population d’étude sont deux fois moins nombreuses que les garçons à avoir une pratique scientifique amatrice (7,5% contre 18,5%, avec un écart significatif au seuil de 1%), ce qui tend à aller dans ce sens (Tableau 2). De même, le croisement de la PCS ménage des parents et de la pratique scientifique en amateur montre que celle-ci tend à s’accroître significativement (au seuil de 1%) à mesure que l’on progresse vers des milieux plus fortement dotés en capital culturel, passant de 6,6% pour les individus issus d’un ménage à dominante ouvrière à 27,5% pour les individus issus d’un ménage à dominante cadre (Tableau 3).
Pour autant, il semble également nécessaire d’être attentif au fait que d’autres pratiques peuvent rendre compte d’une situation plus nuancée. C’est par exemple le cas de la lecture de livres scientifiques, où l’écart entre filles et garçons n’est pas significatif (Tableau 4). Ce genre d’éléments ne remet pas forcément en cause l’image d’ensemble dressée plus tôt mais invite à mieux saisir la diversité des pratiques selon les groupes sociaux considérés, ce qui implique de replacer le goût pour les sciences dans un environnement plus large pour voir comment les centres d’intérêt peuvent se cumuler ou au contraire s’opposer.
Les différentes dimensions du rapport aux sciences
L’espace des pratiques scientifiques
La construction des facteurs de notre ACP a ainsi été menée dans un double objectif: d’une part, obtenir un premier axe permettant d’objectiver le goût pour les sciences et, d’autre part, inclure autant d’axes qu’il est possible d’en interpréter de façon à pouvoir mettre à jour les principes de structuration des pratiques liées aux sciences. Pour cette raison, nous avons choisi de conserver les 4 premiers axes, au-delà desquels nous n’avons plus été en mesure de formuler d’interprétation satisfaisante. Ces quatre axes cumulent près de la moitié de l’inertie totale (52,17%), ce qui rend cette sélection satisfaisante (Tableau 5).
Le premier axe, nettement prédominant (Figure 7), représente à lui seul 24,11% de l’inertie totale. Il est fortement corrélé avec les variables relatives à la consommation de médias (au sens large) liés aux sciences, dans la mesure où ce sont les variables de suivi de l’actualité scientifique, de consultation de contenus scientifiques sur Internet, de goût pour la science-fiction ou encore de lecture de livres scientifiques qui contribuent le plus à sa structuration (Tableau 16). Le fait que l’axe soit corrélé positivement à toutes les variables contributives, bien qu’à des degrés divers, indique qu’il oppose essentiellement les gens ayant pratiqué ces activités à ceux ne l’ayant pas fait (Figure 1). Nous pouvons dès lors l’interpréter assez naturellement comme le facteur de « l’intérêt pour les sciences ». Le calcul du Coefficient alpha de Cronbach, qui permet de mesurer la cohérence entre nos différentes variables, nous donne une valeur de 0,618: si celle-ci est plutôt faible dans l’absolu, elle demeure cepen-dant acceptable dans notre contexte d’étude (Grimault-Leprince et Merle, 2008) et conforte l’idée que nos variables contributives saisissent bien une même dimension. La projection des variables supplémentaires dans l’espace factoriel dessine des clivages à la fois sociaux et culturels, mais aussi, dans une plus faible mesure, genrés, géographiques et d’âge (Figure 2). On trouve ainsi du côté droit, associé à un fort niveau d’intérêt, les enfants issus de familles à dominante cadre et avec un haut niveau d’étude, les lecteurs réguliers, les pratiquants d’activités artistiques et, plus près du centre, les garçons, les habitants de métropole et les 22-25 ans. À l’opposé, le côté gauche concentre les enfants de familles à faible niveau de diplôme et à dominante populaire, les détenteurs de diplômes courts, les non-lecteurs, et, de manière moins marquée, les filles, les habitants de communes rurales et les 15-18 ans. Si nous retrouvons ici les liens déjà établis entre le niveau d’intérêt pour les sciences et le milieu d’origine, le capital culturel ou le genre, la présence d’une division en fonction de la taille de la commune est plus originale, sans qu’il soit possible à ce stade de savoir si le plus faible intérêt associé aux villages tient à leur isolement géographique à proprement parler ou au fait qu’ils concentrent davantage de ménages populaires.
Le deuxième axe, qui conserve 10,47% de l’inertie totale, est surtout organisé par les variables relatives aux visites (Tableau 17). Viennent ensuite des pratiques davantage centrées sur l’espace domestique, comme la lecture de livres, l’usage d’Internet, ou le suivi de l’actualité, qui sont elles projetées à l’autre extrémité de l’axe. On peut ainsi penser que ce facteur nous permet d’appréhender un clivage entre des formes de sociabilité tournées vers l’extérieur et d’autres restreintes à l’espace domestique (Figure 1). Nous pouvons de la sorte le voir comme le facteur de « l’ouverture vers l’extérieur ». Les variables supplémentaires font cette fois ressortir une opposition entre d’un côté les filles, les 15-18 ans et les enfants de ménage dominante cadre, situés sur la partie supérieure de l’axe, et de l’autre les garçons, les étudiants de premier cycle, les 19-21 ans et les enfants de ménage à dominante ouvrière (Figure 2). Ce contraste est notamment intéressant du point de vue du genre car elle place les filles plutôt du côté des sorties et les garçons du côté de l’espace domestique, ce qui semble plutôt aller à l’encontre de l’idée d’un ancrage traditionnel féminin dans la sphère privée. Une explication possible à ce constat serait que les filles commencent tendanciellement à effectuer des sorties culturelles en autonomie à un âge plus précoce que les garçons (Détrez et Piluso, 2014): par conséquent, le différentiel de sorties observé refléterait principalement un effet d’âge. Mais, dans le même temps, le fait que cette population jeune ait un plus fort niveau de sorties culturelles pourrait aussi tenir au fait qu’elle soit issue d’un milieu favorisé, ce qui rend délicat d’en tirer une interprétation univoque.
Le troisième axe, qui préserve 8,87% de l’inertie totale, est essentiellement porté par la pratique du bricolage, la visite de parcs scientifiques, le visionnage d’une série scientifique, la pratique scientifique en amateur et la lecture d’ouvrages scientifiques (Tableau 18). Si nous nous intéressons aux coordonnées de ces variables, nous pouvons constater qu’elles s’organisent suivant deux pôles: l’un regroupant, du côté négatif, les pratiques que l’on peut vraisemblablement qualifier de « légitimes » car étant tournées plus explicitement vers la réflexion intellectuelle et l’apprentissage (lecture, pratique en amateur, suivi de l’actualité) et l’autre rassemblant, du côté positif, les pratiques « illégitimes » (bricolage, visionnage d’une série, visite d’un zoo) (Figure 3). Il nous est donc possible de qualifier ce facteur de facteur de « la légitimité culturelle ». Dès lors, il est assez peu étonnant que les variables supplémentaires fassent ressortir des lignes de clivage déjà maintes fois mises en évidence par les travaux portant sur les logiques de distinction entre groupes sociaux (Robette et Roueff, 2017): la partie gauche de l’espace associe ainsi les enfants de ménages à dominante cadre, les étudiants de second cycle et les lecteurs assidus, tandis que celle de droite réunit plutôt les enfants de ménages à dominante indépendante, les jeunes qui ne suivent pas d’études et les non-lecteurs (Figure 4). Au-delà d’une simple convergence avec des résultats bien établis en sociologie de la culture, cette projection a aussi l’intérêt d’attirer l’attention sur une disparité d’âge, dans la mesure où les 15-18 ans sont localisés sur la portion « légitime » de l’axe là où les 22-25 ans se retrouvent eux sur sa portion « illégitime ». Cette constatation d’une plus grande proximité des plus jeunes à l’égard de pratique légitime pourrait à notre sens trouver son explication dans des stratégies d’encadrement parentales plus fortes au sein des classes supérieures, qui cherchent généralement à inculquer tôt à leurs enfants des dispositions favorables à la « culture cultivée » (Mennesson et Julhe, 2012).
Enfin, le quatrième axe, qui illustre 8,72% de l’inertie totale, se construit autour des variables de visionnage d’une série scientifique, de visite d’un parc de sciences, de goût pour la science-fiction, de visite d’un musée et de visite d’un zoo (Tableau 19). La prise en compte des coordonnées laisse ici à penser que l’axe, qui pourrait à première vue ressembler au précédent, reflète en réalité davantage une opposition entre des activités que l’on peut dire « ludiques » (visionnage d’une série, consommation de science-fiction) et d’autres plus « sérieuses » et pratiques (visite d’un musée, lecture, bricolage) (Figure 3). Il nous parait de ce fait justifié de concevoir ce facteur comme le facteur de « la ludicité ». Cette conception se trouve d’ailleurs recouper relativement bien la notion de « serious leisure », conceptualisée au début des années 1980 par le sociologue Robert Stebbins (Stebbins, 1982). Celui-ci défend en effet que si les pratiques de loisir ne relèvent pas du travail, elles ne sont pas pour autant nécessairement segmentations des activités de loisir et les contextes dans lesquelles celles-ci prennent place. De ce point de vue, la répartition des variables supplémentaires montre que ce sont plutôt les habitants des villes de petite et de moyenne taille, les détenteurs d’un diplôme professionnel et les enfants de ménages au capital scolaire faible qui sont les plus adeptes d’activités scientifiques « récréatives ». Le fait que ces individus possèdent des profils sociaux plutôt rattachables aux classes populaires peut selon nous amener à deux lectures très différentes, qui ne sont cependant pas mutuellement exclusives: soit ces personnes ne disposent pas des ressources matérielles ou temporelles nécessaires à l’entretien de hobbys scientifiques, soit elles étendent la préférence ancrée dans les milieux populaires pour les œuvres de fiction et de divertissement aux contenus scientifiques (Masclet, 2021). À l’autre bout du spectre, l’attrait pour les formes plus « sérieuses » d’activités scientifiques se retrouve chez les personnes habitant à Paris ou dans des communes rurales, chez les enfants de ménages au capital scolaire élevé et chez les enfants de cadres. Selon nous, la présence de membres des classes supérieures tient au fait que la culture valorisée au sein des milieux bourgeois valorise fortement les activités artistiques (comme la pratique d’un instrument) et que celles-ci sont précisément des loisirs « sérieux » au sens de Stebbins (Mennesson et Julhe, 2012), ce qui pourrait davantage disposer ces individus à entretenir un rapport intellectuel et exigeant vis-à-vis des contenus scientifiques. Quant aux indications géographiques, elles se révèlent plus ambiguës. Si la présence de Paris peut vraisemblablement s’expliquer par la large offre d’infrastructures culturelles tournées ver les sciences dans la capitale et ses alentours (comme la Cité des Sciences), celle des communes rurales est plus délicate à décrypter. Même si ce n’est ici qu’une hypothèse, nous pouvons notamment penser que l’enclavement de ces zones et leur éloignement des services culturels urbains pourraient précisément agir comme un terreau propice pour que les personnes qui y vivent puissent, sous certaines conditions (par exemple avoir un goût pour le travail manuel), développer un attrait pour des activités en amateur relativement solitaires.