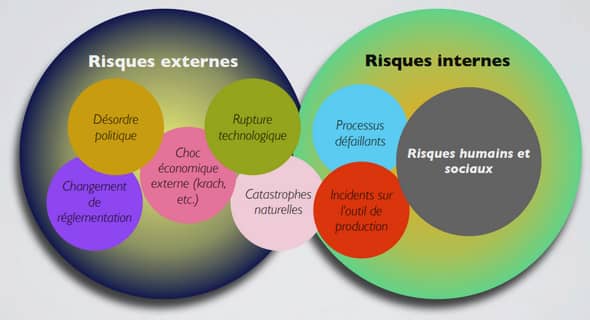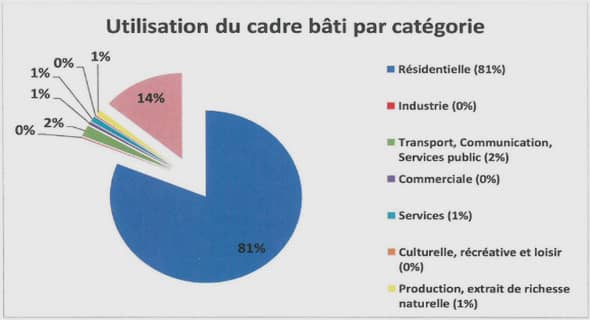Problèmes environnementaux
En plus de l’accroissement continu de la consommation d’énergie, le secteur des transports dans ses branches terrestres, maritimes et aériennes est fortement responsable des émissions de polluants tels que le SO2 le CO2. En effet, ces émissions sont proportionnelles à la consommation de carburants fossiles qui représente actuellement 95% de l’approvisionnement mondial en énergie utilisée dans le secteur des transports [7][12]. Par ailleurs, les polluants provenant des transports, en particulier pour la branche routière, sont classés selon deux catégories ; d’une part, les polluants primaires, qui sont émis directement à l’échappement, d’autre part, les polluants secondaires, qui résultent de la transformation chimique des premiers dans l’atmosphère [13]. En plus des gaz, le transport routier est à l’origine d’émissions de polluants sous forme de particules fines de métaux lourds, de nuisances sonores… Ces polluants ont un impact direct sur la santé publique et sont responsables des changements climatiques dus l’effet de serre (cf. Figure. I. 2).
L’effet de serre est un phénomène naturel sans lequel la vie ne pourrait exister sur notre planète. Cependant, depuis l’ère industrielle, l’activité humaine tend à fortement augmenter ce phénomène, essentiellement par l’accroissement des rejets de CO2, au risque de provoquer un bouleversement climatique. Ce phénomène agit comme le verre d’une serre, c’est à dire que les gaz à effet de serre emprisonnent la chaleur produite par le soleil. La plus grande partie de l’énergie solaire traverse directement l’atmosphère (couche d’air qui entoure la terre) pour réchauffer la surface de la terre. Lorsque les rayons du soleil atteignent la Terre, 30 % d’entre eux sont directement réfléchis vers l’espace par les hautes couches de l’atmosphère. Ces dernières en absorbe 20 % et les 50 % restants atteignent le sol [11]. Les gaz à effet de serre permettent de conserver une partie de cette chaleur et l’empêche de repartir vers l’espace [12]. Sans l’effet de serre, la température moyenne de la Terre serait de – 18 °C, contre + 15 °C actuellement. Mais si la concentration des gaz à effet de serre est trop élevée, ce fonctionnement est perturbé et la chaleur reste piégée par l’atmosphère et la planète se réchauffe [12].
Les derniers rapports du GIEC3 renforcent la certitude de l’existence d’une augmentation de l’effet de serre due à l’activité humaine. Il donne des prévisions d’augmentation de la température moyenne du globe et d’élévation du niveau moyen des mers sur le globe. Ainsi, selon les scénarios plus ou moins pessimistes, la température moyenne sur la terre s’élèverait en 2100 de 1,8° à 4° [15]. Par conséquent, la fonte des glaciers et la dilatation des océans sous l’effet de la chaleur provoqueront une élévation du niveau de la mer estimé entre 29 et 82 cm. Actuellement, de nombreuses régions côtières sont déjà confrontées à des phénomènes de submersion, d’accélération de l’érosion, d’intrusion d’eau de mer dans les nappes d’eau douce. Une autre conséquence du changement climatique est la diminution des ressources en eau douce qui va frapper certaines régions sèches des latitudes moyennes et tropicales. L’effet va se traduire par des déplacements massifs des populations du littoral (74 de la population mondiale) vers l’intérieur des terres pour ne pas être submergé par la montée des eaux. Cependant, à cause des sécheresses et des inondations, les habitants des régions sinistrées risquent de souffrir de famine [12]. Sur le plan de la santé publique, le changement climatique influe sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé : air pur, eau potable, nourriture en quantité suffisante, sécurité du logement. Le schéma suivant (cf. Figure. I. 3) décrit les impacts environnementaux liés aux changements climatiques.
Evolution des normes d’émission automobile
Dans le sillage du sommet mondial sur l’environnement et le développement organisé en 1992 à Rio de Janeiro au Brésil, des conventions internationales ont été adoptées pour fixer un cadre et pour définir les actions à mener en vue d’agir contre les problèmes environnementaux globaux : réchauffement du climat, érosion de la biodiversité, sécheresse et désertification[17]. Par la suite, le protocole de Kyoto a été élaboré en 1997 pour servir de cadre international à la lutte contre le réchauffement de la Terre. Il avait fixé pour objectif la réduction moyenne de 5.2% des émissions des gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 pour les ramener à leur niveau de 1990 [18]. L’essentiel de l’effort repose sur les pays développés et les pays d’Europe de l’Est à économie en transition. Les pays en développement, y compris les pays dits émergents comme la Chine, le Brésil, l’Inde ou l’Argentine sont dispensés d’engagements contraignants. Le protocole de Kyoto est entré en vigueur en février 2005 après sa ratification par la Russie à la fin de l’année 2004. L’Australie a ratifié le protocole en décembre 2007, ce qui porte à 175 le nombre de pays qui ont adhéré au protocole et sont donc tenus de l’appliquer entre 2008 et 2012. Les Etats-Unis sont le seul grand pays développé qui n’ait pas ratifié ce protocole, comme quelques pays du Sud [18]. L’après Kyoto fait l’objet de discussions et de négociations internationales depuis quelques années en vue d’un autre accord. Les discussions portent notamment sur l’augmentation des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre des pays développés et sur l’implication des pays en développement et surtout des pays émergeants. Cette implication [17] est largement basée sur des incitations financières, ce qui implique des conséquences importantes sur l’économie industrielle et le développement des nouveaux produits. Dans ce contexte, lors de la conférence climatique de Doha en 2012, les négociations ont enfin abouti à un accord. Celui-ci porte sur la période 2013-2020 et implique l’Union Européenne, l’Australie et quelques autres pays industrialisés. Le suivi du Protocole de Kyoto est évidemment positif mais il faut aller plus loin. En effet, cet accord ne va pas permettre d’atteindre une diminution suffisante des émissions puisque seules 15% des émissions globales sont concernées. De plus le Japon, le Canada, la Russie, la Nouvelle Zélande n’ont pas ratifié cette prolongation et les États-Unis n’ont jamais ratifié l’accord initial [20].
Lors de la conférence climatique COP 20 organisée du 1er au 12 décembre 2014, à Lima, au Pérou, les 195 pays ont ratifié la Convention-Cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique (CCNUCC)[21]. Dans un contexte de forte mobilisation internationale, un accord international juridiquement contraignant permettre de maintenir l’augmentation de la température mondiale en dessous de 1,5 degré a été approuvé fin 2015 à Paris lors de la COP 21 [4].
Selon l’Organisation Mondiale de l’Environnement (OME), les principaux polluants émis par les secteurs industriels et faisant l’objet de réglementation sont les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2), les poussières, le monoxyde de carbone (CO) et les composés organiques volatiles non méthaniques (COV non méthaniques), certains métaux et leurs composés, le plomb (Pb), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) [22]. Bien que tous les secteurs d’activité soient concernés, les émissions dues au transport et à l’automobile en particulier, ont été la cible principale des mécanismes réglementaires mis en place par différents pays [7]. A titre indicatif, la France a lancé, en janvier 2000, le programme PNLCC4 fixant une centaine de mesures devant permettre de satisfaire les objectifs gouvernementaux pris dans le cadre du protocole de Kyoto. Plusieurs de ces mesures concernent le secteur des transports. Il s’agit de mesures existantes qu’il fallait poursuivre et/ou renforcer (diminution des consommations unitaires des véhicules neufs, développement du transport intermodal de marchandises, rattrapage de la fiscalité sur le gazole, etc…), et des mesures nouvelles, telles que la mise en place de la taxe carbone, la réduction des émissions des véhicules routiers, le développement de l’inter modalité des transports interurbains, le soutien de la Recherche & Développement [23].
Cette prise en compte de l’environnement dans le cadre législatif des transports a été uniformisée entre l’US EPA (United States Environnemental Protection Agency) et l’Union Européenne (Directive 2005/13/CE) avec plusieurs normes. Elles se nomment TIER I à IV (US) ou Euro I à IV (UE).
L’évolution de la norme américaine (TIER) est montrée dans le Tableau. I. 2. Chaque niveau de ces normes antipollution impose une valeur limite maximale admissible des polluants suivants :
Oxyde d’azote (NOx)
Monoxyde de carbone (CO) Hydrocarbure (HC)
Poussières fines / particules de suie (PM)
Les normes européennes fixant les limites de taux de pollution en mg/km (Euro I à VI) sont, comme toutes les normes, à chaque fois revisitées et les seuils d’émissions sont revus continuellement à la baisse[7]. Ces normes deviennent de plus en plus strictes afin d’inciter les constructeurs à poursuivre les recherches pour des solutions plus sobre en énergie. La norme Euro 1, entrée en vigueur en 1992 pour les moteurs diesel, imposait un maximum de 2,72 de CO, 0,97 de HC+NOx et 0,14 de particules fines. En 7 ans (1993 à 2000), les rejets de particules sont passés de 0,36 g/kWh (norme Euro I) à 0,1 (norme Euro III). De plus, pour tous les polluants cités précédemment, il est constaté une diminution supérieure à un rapport 5 entre les normes Euro1 et la norme Euro 6 entrée en vigueur le 1er septembre 2014[25].
Evolution des performances des véhicules thermiques
Les industries automobile et pétrolière ont réalisé d’énormes progrès ces dernières années pour parvenir à suivre l’évolution des normes d’émission. Dans ce contexte, une voiture particulière diesel neuve actuelle émet 94 fois moins de monoxyde de carbone (CO), 20 fois moins d’hydrocarbures et d’oxydes d’azote (HC+NOx), et 5 fois moins de particules qu’une voiture neuve d’il y a 30 ans [13]. Pour atteindre ce résultat, de nombreux efforts ont été réalisés par les constructeurs automobiles :
Amélioration de la dynamique des véhicules (réduction du coefficient de pénétration dans l’air) pour réduire la consommation et l’émission des gaz à effet de serre.
Adaptation des réglages moteurs : au niveau de l’injection, nouvelle calibration et nouveaux réglages des sondes.
Montée en puissance du contrôle électronique (calculateurs haute performance, modèles embarqués, capteurs, etc.)5.
Choix des pièces à la conception : Impact sur la conception et les matériaux injecteurs, pistons et segments renforcés, compatibilité des matériaux utilisés (réservoir, filtres, circuits carburants, échappement).
Ajout éventuel d’éléments : Système d’aide au démarrage à froid (Scandinavie).
Réduction de la cylindrée pour accroitre la pression effective moyenne à un niveau de puissance bien défini afin d’améliorer l’efficacité énergétique.
Développement de nouvelles architectures moteur (3 cylindres, 2-temps, etc.).
Utilisation de carburants dont la molécule contient un nombre d’atomes de carbone faible relativement au nombre d’atomes d’hydrogène (rapport H/C plus élevé).
Analyse du cycle de vie : outil de référence pour la conception des nouveaux véhicules.
Même si les performances des véhicules thermiques ont fortement progressé ces dernières années, leur impact sur la qualité de l’air et la santé publique reste préoccupant. Dans un contexte où le nombre de voitures ne cesse d’augmenter, l’électrification partielle ou totale des chaines de traction thermique doit avoir un impact positif sur les émissions des gaz à effet de serre en local, voire plus selon le type de source primaire utilisée pour produire l’électricité.
Véhicules hybrides et électriques
Véhicules hybrides
De façon générale, on dénomme hybride, tout véhicule qui, en plus de sa source d’énergie primaire (énergie chimique du carburant en général), dispose d’un stockage réversible d’énergie sous une seconde forme : énergie pneumatique ou hydraulique d’un fluide sous pression, énergie cinétique d’un volant d’inertie, énergie électrique d’une batterie ou d’un supercondensateur, etc… [26]. Le véhicule hybride est aujourd’hui une option crédible, et est d’ores et déjà commercialisée malgré les contraintes intrinsèques liées à la double motorisation et au surcoût des équipements. Cette technologie d’hybridation offre des possibilités d’usage parfaitement adaptées à une utilisation urbaine de l’automobile. En ville, la conduite saccadée et à basse vitesse profite du rendement élevé de la chaine de conversion électrique [27]. Le véhicule hybride présente de nombreux avantages tout en maintenant l’autonomie qu’offre le carburant classique : diminution de la consommation de carburant et donc des émissions des gaz à effet de serre et des autres polluants atmosphériques, diminution du bruit en ville. Ces dernières années, les constructeurs automobiles ont intégré un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires au véhicule hybride : Optimisation de la gestion d’énergie des accessoires électriques, Stop & Start (STT) (arrêt du moteur à l’arrêt et démarrage automatique), récupération d’énergie au freinage, assistance électrique à la traction ou booster, mode tout électrique6 ou Zéro Emission Véhicule [28] .