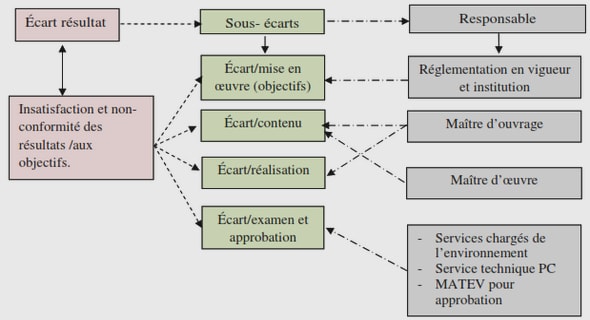Travail et intégration de la femme
Mode de production et travail
Le caractère du travail est déterminé par le mode de production auquel il appartient. Le prix du travail dépend du caractère de répartition des produits du travail. Or ce dernier est déterminé par le rapport de possession des moyens de production. Pour la commodité de l’exposé nous allons nous arrêter sue les caractéristiques du travail au sein du mode de production capitaliste. L’analyse ultérieure de la succession des modes de productions dans la société tsimihety nous permet de cadrer notre projet.
Selon la théorie marxiste celui qui n’a pas de moyens de production vend sa force de travail pour assurer sa subsistance. Dans une société capitaliste le travail est une marchandise que le prolétaire vend à la bourgeoisie. Le travail a un prix.
Machinisme et travail
Les moyens et les techniques de production changent au fur et à mesure que se développe la connaissance de l’homme. L’appropriation de ces moyens de production demande la possession d’un capital considérable. Ces innovations sont à l’origine d’une monopolisation du marché par un produit. Les petits fabricants sont fermés.
Ce machinismea aussi réduit la quantité de la force de travail nécessaire à la production d’une quantité quelconque de produits. Les conditions d’accès deviennent de plus en plus strictes. Cela a amélioré le prix du travail des spécialistes qualifiés et diminue celui des travailleurs sans qualification qui constituent la main d’œuvre. Ainsi le salaire diminue tandis que le profit réalisé par le bourgeois s’agrandisse. Marx dit : «le premier résultat de la machine est l’augmentation de la plus-value». La plus-value acquise se mesure en argent.
La production matérielle fondement de la vie et du développement
La production des biens matériels comporte des éléments en interdépendance à savoir les forces productives et les rapports de production. Sans nous étaler sur la présentation de la théorie marxiste du mode de production un exposé succinct nous semble nécessaire pour la clarté de cette étude.
La base économique ou l’infrastructure est composée par les forces productives et les rapports de production. La transformation de l’objet de travail en produits nécessite des moyens de production (outils, matériaux…) et de la force de travail fournie par l’homme. Si l’individu est possesseur de moyens de production et y travaillent il jouit de l’entière rémunération son travail, autrement dit il n’y a pas de rapport de production. Tandis que dans une société capitaliste où la propriété des moyens de production revient à la bourgeoisie qui achète la force de travail du prolétaire. Ainsi naissent des rapports de distribution du fruit de travail.
Selon le marxisme les forces productives évoluent plus vite que les rapports de production. Ces éléments rentrent alors en contradiction et de cette lutte naisse le développement du mode de production. L’histoire des révolutions montre la perspicacité de cette théorie. L’apparition de la propriété privée par exemple est à l’origine du salariat, de l’Etat comme institution destinée à maintenir l’exploitation de la bourgeoisie sur le prolétariat.
Sans trop nous étaler sur l’exposé de la théorie marxiste du mode de production (nous allons le cadrer plus tard en explorant notre terrain d’étude), nous allons passer à la présentation de la commune urbaine de Mandritsara.
L’argent mesure général de la valeur
Marx en étudiant la société capitaliste a conclu que l’argent est l’équivalent général de toutes marchandises. En ce sens le prix du travail est donc estimé en valeur monétaire. La bourgeoisie a optimisé l’achat des forces de travail en intégrant dans la fabrique femmes et enfants. L’acquisition des forces de travail à bon marché constitué par des femmes et des enfants est une stratégie adoptée par le capitaliste d’optimiser son profit.
En tant que mesure général le salariat est le système qui correspond à la rémunération du travail. Dans une société capitaliste le travail est une sécurité pour le travailleur. Et on a tendance à exclure de la définition du travail toute activité non salariée. Le travail c’est le salaire.
Le salaire du marché de travail
Comme toute autre marchandise le travail obéit au mécanisme de l’offre et de la demande. Plus un service est rare plus il devient chère et plus il abonde sur le marché moins il est chère. Car c’est sa rareté qui est la mesure de sa valeur. Selon Ricardo, le travail est cher quand il est rare et bon marché quand il est abondant.4 Autrement dit la spécialisation demandée par le travail détermine son prix sur le marché.
Cette théorie est d’une importance cruciale pour notre investigation car cela nous permet non seulement d’évaluer la valeur du travail mais en même temps de mesurer l’accès au marché du travail. L’abondance de demande d’une même spécialisation sur le marché du travail réduit la possibilité d’accéder à un poste alors que la rareté d’une quelconque spécialisation est un enjeu non négligeable pour comprendre le monde du travail.
L’offre du travail est de plus en plus réduite à cause de la mécanisation du processus de production. La capacité à manier ces machines est l’une des conditions du recrutement.
Table des matières
INTRODUCTION
1.contexte
2.motif du choix du thème et du terrain
3.objectifs
4.Problématique
5.Hypothèses
6.Méthodes
7.Techniques
8.Echantillonnage
9.Problèmes rencontres et limites d’étude
10.Plan global de ce document
Partie 1 : APPROCHE CONCEPTUELLE ET CONTEXTE DU TRAVAIL ET PRESENTATION DU TERRAIN D’ETUDE
Chapitre 1: généralités sur le travail
1.1.Mode de production et travail
1.2.La notion de statut et de rôle
1.3.La production matérielle fondement de la vie et du développement
Chapitre 2: Monographie de mandritsara
2.1.Présentation géographique
2.2.Situation démographique et économique
2.3.Renseignement d’ordre économique
2.4.HISTORIQUE
CONCLUSION PARTIELLE
Partie 2 : LA PARTICIPATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT
Chapitre 3: l’organisation sociale traditionnelle tsimihety
3.1.L’économie agricole
3.2.Les valeurs sociales traditionnelles tsimihety
Chapitre 4: l’impératif du modernisme
4.1.Le pouvoir de l’argent
4.2.L’optique d’égalité
4.3.La difficulté de la scolarisation des filles
4.4.La participation de la femme au modernisme
4.5.L’émancipation de la femme
CONCLUSION PARTIELLE
Partie 3 : pour une société égalitaire
Chapitre 5: pour une démocratie effective
5.1.La décentralisation
5.2.Le fédéralisme unitaire
Chapitre 6: démocratisation de l’enseignement
6.1.Contre la logique d’assistance
6.2.L’intégration de l’égalité homme/ femme
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES