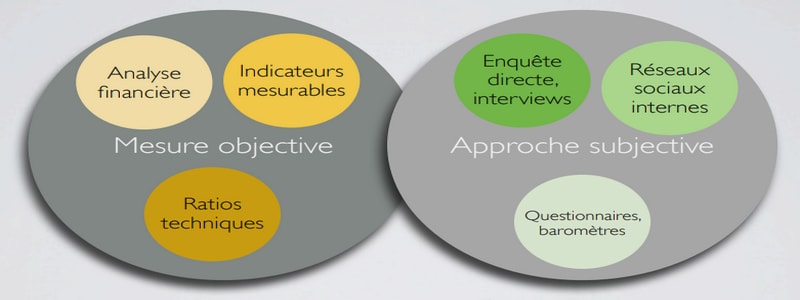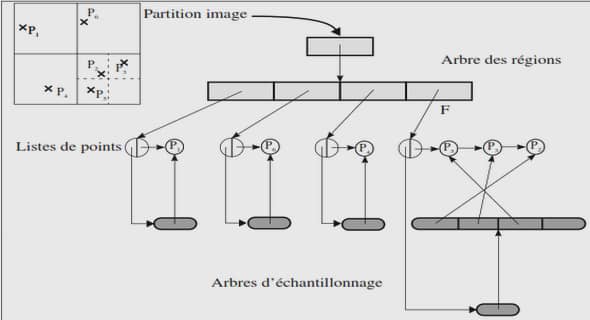Introduction aux industries culturelles
Le discours de l’exception culturelle semble tenir pour acquis que les biens produits par les industries culturelles ne sont pas des biens comme les autres, et qu’en conséquence ils méritent un statut et une attention particuliers 2. Ce discours s’appuie essentiellement sur l’idée, parfaitement recevable en soi, que la valeur des biens et services culturels ne découle pas de leurs seules caractéristiques physiques mais du contenu symbolique dont ils sont le support (le texte pour un livre). Les modes de production, de diffusion et de réception de ces contenus relèvent pour une large partie d’éléments extra-économiques dont l’étude relève d’autres domaines des sciences sociales. Par conséquent, si on suit cette idée, le processus de formation de valeur des biens culturels est profondément influencé par des facteurs qui n’interviennent que beaucoup plus légèrement pour d’autres biens. Cette influence conduit à prendre en considération de multiples dimensions de l’idée de valeur, dépassant son expression dans les prix, et souligner un certain nombre d’externalités liées à la consommation des biens culturels.
Pour le praticien de l’organisation industrielle toutefois, la définition des industries culturelles ainsi que l’opportunité de leur réserver un traitement particulier peuvent ne pas être évidentes. Il convient donc ici d’explici-ter les termes utilisés et de montrer quelles caractéristiques précises des biens étudiés requièrent une adaptation du cadre d’analyse habituel de l’organisation industrielle.
Le problème de la définition
Il n’est pas rare que les ouvrages dédiés à l’économie de la culture consacrent un temps important à la délimitation de leur sujet, c’est-à-dire la définition de ce qu’est un bien culturel. On comprend que cette question occupe une place importante dans un ouvrage programmatique comme Economics and Culture (Throsby 2001). Il est en revanche plus surprenant d’y voir consacrée une partie entière du Handbook of the Economics of Art and Culture (Ginsburgh et Throsby 2006), pratique inhabituelle dans cette collection. C’est que, comme le souligne Françoise Benhamou 3, ni l’unité ni la spécificité des secteurs composant le secteur culturel ne vont de soi. La pensée économique a en effet longtemps considéré la culture dans son ensemble soit comme hors de son champ d’analyse, soit avec une certaine méfiance face à ce qui était considéré comme une dépense somptuaire ou un usage peu productif des ressources. À titre d’exemple, Marshall emploie fréquemment les biens culturels comme contre-exemple des lois générales qu’il énonce, comme la décroissance de l’utilité marginale, et Keynes, membre du Bloomsbury Group et un des premiers directeurs du British Arts Council, s’est gardé de faire entrer la production de biens et services culturels dans le cadre de son discours économique 4.
Si l’analyse séminale de Baumol et Bowen 1966 a donné ensuite lieu une littérature démontrant l’existence de problématiques communes aux beaux-arts, au cinéma, à l’édition et aux médias, la perception de l’unité de ce champ et de la pertinence des ses problématiques reste inégale. Ainsi l’économie des médias 5 a-t-elle un périmètre qui ne recoupe que partiellement le champ culturel. Plus généralement, la cohésion du champ de l’économie de la culture ne tient pas à un jeu d’outils particuliers, mais plutôt à l’ensemble de sujets et aux problématiques traitées.
Les objets des chapitres centraux de cette thèse, l’édition et la vente de livres d’une part, la diffusion radiophonique de musique d’autre part, ne posent pas de problème d’appartenance au champ culturel. Il semble en effet clair que l’activité de chacun de ces secteurs est organisée autour de la conception et de la diffusion de contenus dont la nature créative est indéniable. Le flou autour de ce que recouvre exactement ce terme de nature créative » est ici délibéré. Les caractéristiques qui sont mises en évidence dans la section suivante (section 1.2) découlent de la nature des biens considérés et non de leur contenu précis.
Ce dernier point appelle un développement particulier. Définir en des termes économiques les caractéristiques propres des biens culturels doit se faire de manière indépendante de tout jugement de valeur sur la qualité ou l’intérêt du contenu de ces biens. Comme je l’explique plus avant dans l’introduction du chapitre consacré au prix unique (section 1), la notion, au demeurant floue, de qualité des contenus culturels relève d’éléments de nature sociale, historique et esthétique qui échappent très largement aux outils de l’économiste. Dans la mesure où il n’existe pas non plus de dé-monstration convaincante que cette notion de qualité soit significativement corrélée avec la formation des prix des biens concernés, il faut donc que les propositions portant sur ces prix ainsi que sur l’allocation des ressources que ces prix résument soient le plus indépendantes possibles de ce concept de qualité. Pour des raisons similaires, la notion de diversité appliquée aux biens culturels est difficile à manier 6, les dimensions pertinentes du concept dépassant celles que les économistes sont habitués à manier. C’est pourquoi je me cantonnerai à des acceptions limitées de cette dernière notion en fonction des problèmes étudiés.
Ceci fait, une difficulté particulière peut encore surgir dans l’application des outils de l’économie à ce secteur. L’expression industries culturelles est en effet chargée de la réprobation qui, depuis Walter Benjamin et Theodor Adorno, entoure la reproduction en grande série des biens culturels et la culture de masse qu’elle incarne. La réticence des milieux culturels à être l’objet de l’analyse économique semble toutefois assez largement partagée, comme en témoignent la description que donne David Throsby des relations entre économie et culture, ou la réception controversée de l’ouvrage de Tyler Cowen In Praise of Commercial Culture (Cowen 1998).
Dans les secteurs qui intéressent cette étude, les exemples d’acteurs majeurs se présentant comme des serviteurs désintéressés de la Culture et proclamant leur mépris pour les objectifs de maximisation du profit ne manquent pas. À ce niveau, les réticences sont fortes, et la commu-nication entre économistes et praticiens prend à l’occasion la forme de véritables chocs culturels 7. Pour autant, l’application des outils de l’ana-lyse économique standard au domaine culturel a montré que les pratiques peuvent être, en la matière, éloignées des discours. L’existence de facteurs irrationnels dans le mécanisme de la création ou l’existence de bénéfices non-monétaires à l’exercice d’une activité artistique s’accompagnent en effet de choix d’allocation des ressources propres à l’analyse en termes de choix rationnel 8. En outre, les secteurs concernés dans cette thèse, moins dépendants de régimes de subvention que les arts vivants, sont inclus dans des structures de marché qui justifient la pertinence d’une analyse de ce type.
La question à ce point est ainsi de savoir quels sont les contraintes particulières que la nature culturelle des biens considérés imposent aux stratégies et à l’information des acteurs concernés.
Caractérisation théorique
La caractérisation proposée ici s’appuie largement sur la caractérisation développée par Caves 2002. Celle-ci, en mettant en avant des caractéris-tiques du mode de production et des biens produits, procède explicitement d’une analyse en termes d’organisation industrielle, contrairement à celle proposée par Throsby 2001. Cette dernière est en effet orientée vers la mise en évidence d’éléments de valuation des biens culturels n’apparaissant pas dans leur prix de marché mais pertinents pour l’analyse économique. Plus précisément, pour le propos de cette thèse, je montre l’influence sur les marchés du livre et de la radio des propriétés que Caves désigne sous les termes de nobody knows, infinite variety et A list/B list 9.
Nobody knows (« Personne ne sait ») Issue du monde du cinéma, cette expression capture la double incertitude portant sur les biens culturels. Du point de vue du consommateur, un bien culturel est en effet un bien d’expérience. Ce n’est que dans le processus même de consommation qu’il peut, et encore, déterminer avec une certaine certitude l’utilité qu’il retire de cette consommation. Des éléments d’information (résumés, critiques, recommandations) existent, mais il ne sont qu’une indication imparfaite du résultat de l’appariement entre les caractéristiques précises du bien et les goûts idiosyncratiques du consommateur. Réciproquement, du point de vue du producteur, le bien culturel est un bien prototype. La demande finale, en d’autres termes, le succès d’un bien culturel n’est en règle générale connue qu’après l’achèvement complet du bien, alors que la quasi-totalité des coûts de production ont été dépensés (et ne sont pas récupérables, sunk costs). Cette double incertitude a de multiples effets sur l’organisation du secteur. Un premier effet est de mettre en relief l’importance des intermédiaires, en position de fournir de l’information sur les caractéristiques d’un bien et de réduire ainsi l’incertitude à laquelle fait face le consommateur. Dans le présent travail, c’est au travers de la fonction du libraire sur le marché du livre que ce rôle est étudié.
Infinite variety (« Diversité infinie ») Contrairement au monde indus-triel classique, où les caractéristiques d’un bien ou de sa production peuvent faire l’objet d’une liste limitative, les biens culturels se différencient les uns des autres selon des dimensions qui ne peuvent faire l’objet d’une énumération. Le style d’un auteur, la patte d’un peintre ou la virtuosité d’un interprète ne se capturent pas dans une partie de l’œuvre ou de la performance, mais ressortent d’une appréciation du bien dans son inté-gralité. De ce fait, deux biens présentant de très fortes similarités selon des dimensions observables (genre, budget, type de scénario) peuvent être unanimement considérés comme très différents par le public ou faire l’objet de jugements très contrastés. En termes d’organisation de la propriété intellectuelle, cette différence s’inscrit dans le passage d’un système de brevet, requérant des conditions d’originalité et de publication des procédés, un système de droit d’auteur, sans exigence d’originalité, où la protection porte sur le bien lui-même et non sur son processus de production. Cette propriété caractérise des marchés proposant un très grand nombre de biens différenciés horizontalement, chaque bien ayant de proches substituts. Dans l’étude du marché du livre, cette propriété est convoquée pour mettre en évidence l’effet que produit la concurrence entre biens similaires sur l’organisation du secteur. Cette propriété étant une propriété d’équilibre (s’il y a une très grande diversité de biens, c’est qu’il y a à la fois des agents prêts à fournir de nouvelles variétés et des agents disposés à consommer ces variétés), elle reflète l’existence sous-jacente d’une infinie diversité des goûts. C’est sous cet aspect que l’étude sur la diffusion radiophonique envisage cette caractéristique des biens culturels, mettant en évidence la manière dont l’arbitrage entre fournir plus d’une même variété ou fournir une nouvelle variété est affecté par l’existence d’une réserve inépuisable de goûts non servis. Pour les besoins de cette thèse, le cadre conceptuel de Dixit et Stiglitz 1977 est le plus souvent suffisant. Pour des concepts plus riches de diversité, ce cadre peut en revanche se montrer trop restrictif.
A list/B list (« Liste A/liste B ») Si les biens culturels sont différen-ciés horizontalement, un petit nombre d’entre eux jouissent, sur chaque marché, d’une position spécifique. Qu’il s’agisse de superstars quand il s’agit d’artistes ou de blockbusters quand il s’agit de produits, ces biens bénficient d’une notoriété qui leur permet de s’affranchir en partie des problèmes d’incertitude du côté du consommateur. Ils constituent ainsi une « liste A » des biens, attirant une large demande de non-initiés qui n’est pas accessible aux biens de la « liste B ». Les fondements d’une telle hiérarchisation verticales de biens a priori très similaires ex ante ainsi que les phénomènes informationnels conduisant à ces résultats font l’objet d’un programme de recherche propre 10. Pour les besoins du présent travail, je prends cette stratification comme une donnée des marchés culturels et m’attache à montrer en quoi elle modifie la manière d’envisager la structure des marchés concernés. Dans le cas du livre, cette propriété se traduit par une dualité du marché, avec d’une part un marché horizontalement différencié classique pour les blockbusters et d’autre part un marché pour les titres de la liste B, où les problèmes liés à l’incertitude sur les biens d’expérience deviennent pertinents. Dans le cas du chapitre portant sur la diffusion radiophonique, cette hiérarchisation motive l’hypothèse d’une hiérarchisation des genres, du plus au moins populaire, ainsi que la foca-lisation de l’analyse sur l’idée que la demande est très concentrée sur les genres les plus populaires.
D’autres propriétés listées par Caves, peuvent avoir une influence im-portante sur le fonctionnement de ces marchés. Je fais le choix d’en faire abstraction. Parmi ces propriétés, on peut citer le fait que les artistes retirent une utilité du seul accomplissement de l’acte créatif (art for art’s sake ), le fait que la mise sur le marché de biens culturels complexes néces-site l’opération d’une chaîne de production présentant des problèmes de risque moral à chaque étape (motley crew), les difficultés liées à la faible durée de vie de la plupart des biens culturels ( time flies) et inversement de la capacité de certains à générer des revenus sur des périodes de temps très longues (ars longa).
Coûts fixes et coûts marginaux En revanche, les travaux présentés dans cette thèse s’appuient largement sur un autre aspect de la nature de prototypes des biens culturels : la faiblesse des coûts marginaux au regard des coûts initiaux de production. Cette propriété est particulièrement importante pour les industries culturelles, qui se caractérisent précisément par la reproduction en masse d’un original. Cette caractéristique procède de la nature même des biens culturels, dont la valeur est liée à leur contenu symbolique plus qu’au véhicule physique servant de support à ce contenu 11. La vente en ligne de musique sous format informatique en fournit une illustration claire. Une fois payé le coût de production ou d’achat d’un contenu (émission, chanson), le coût marginal du stockage du bien ou le coût de transmission à un acheteur sont négligeables. La forme même des contrats ayant cours dans ces secteurs atteste d’ailleurs de cette propriété : dans la plupart des cas, les licences de diffusion de chansons sont des licences globales, donnant au diffuseur le droit d’utiliser un nombre illimité de fois l’ensemble des chansons d’un catalogue qui peut, selon les cas, recouvrir la quasi-totalité de la production d’une maison d’édition musicale, voire d’un pays 12. Dans le cas de la diffusion radiophonique, on a donc une absence simultanée de coût marginal direct à diffuser une fois de plus un morceau déjà dans le programme et de coût marginal direct à diffuser un nouveau morceau. Cette absence illustre sous une forme pure l’arbitrage entre répétition et introduction d’une nouvelle variété présent dans les modèles de diversité optimale à la Dixit-Stiglitz ou à la Hotelling-Salop- Diamond 13, révélant ainsi apparaître l’effet propre des coûts d’opportunité, indépendamment des questions de coûts de développement d’une nouvelle variété d’une part et des économies d’échelle d’autre part.
La démonstration de l’importance de ces caractéristiques dans l’organi-sation précise des secteurs concernés par cette thèse constituant l’un des objets des chapitres centraux, la section suivante de cette introduction a simplement pour objectif de donner les grands traits de ces secteurs et d’expliquer brièvement en quoi les caractéristiques listées ci-dessus jouent un rôle dans leur organisation économique.