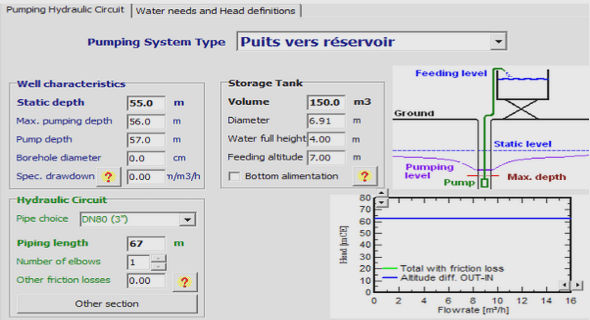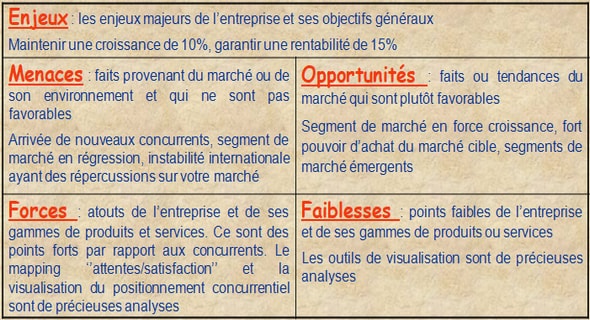La famille, un produit d’institution(s)
S’affranchissant d’une conception naturaliste de la famille, la sociologie a montré, dès ses débuts15, comment le social – et notamment l’État – la faisait exister en consacrant certains agen-cements privés plutôt que d’autres. En procédant à la « généalogie de la morale familiale »16 ou à l’anamnèse des interventions multiples qui ont conduit à la constitution progressive de la famille comme problème et objet de gouvernement, elle a notamment montré à quel point « cette famille que nous sommes portés à considérer comme naturelle parce qu’elle se présente avec l’évidence du toujours » était d’abord « un mot d’ordre », « une fiction sociale », en somme « une catégorie réali-sée » 17. Soulignant que la famille est à la fois privée et publique, le regard que lui portent les sciences sociales ont permis de « prendre la mesure des diverses forces qui s’exercent sur elle “de l’extérieur” et des divers instances et processus sociaux qui la définissent, la construisent, la ré-gulent ou la légitiment »18. Aussi, le discours critique qu’elles formulent invite à examiner le « tra-vail d’institution » dont la famille est le produit19.
Lorsqu’il s’agit d’engendrer, d’aimer, d’éduquer, de procréer, en bref lorsque l’on est une famille ou que l’on désire faire famille, rien n’est “naturel”, instinctif ou spontané. Les possibles sont limités, et nos vies familiales régies par des demandes, des exigences et des prescriptions »20. Les débats suscités par les évolutions du droit familial nous le rappellent régulièrement. Qu’il s’agisse, par exemple, des réformes du droit de garde et de l’autorité parentale, de l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes célibataires ou en couple de même sexe, du statut de beau-parent ou du développement d’un « droit des origines », les mutations familiales n’en finissent pas d’être un problème. Mais les controverses qui ponctuent l’agenda législatif ne doivent pas faire oublier que « la politique de la famille » 21 se détermine également, et peut-être surtout, par le travail quotidien des agents en charge de sa régulation, de son administration et de son trai-tement. En effet, si la force publique prescrit, par le droit, qui peut en être et comment, la famille fait aussi l’objet d’un pouvoir régulateur lorsque les institutions travaillent avec et sur les individus pour faire de leurs agencements privés des configurations normalisées et normalisantes »22.
Au tournant des années 1970-1980, plusieurs recherches se sont attachées à décrire et analy-ser la façon dont travailleurs sociaux, médecins ou « psy » participaient à l’ordonnancement familial23. Certes, la nécessaire « conservation »24 des enfants a fait l’objet d’un traitement politique an-térieur25, mais leur avènement en « raison d’État »26, depuis au moins le XIXème siècle, en a trans-formé l’appréhension et a étendu le regard étatique et son pouvoir disciplinaire « à domicile »27. Ces recherches ont examiné, chacune à leur manière, l’intervention croissante de l’État et de ses agents – ou plus largement des classes dominantes – dans l’intimité des familles, et en particulier des fa-milles de classes populaires. Pour la plupart inscrits dans le sillage des analyses de Michel Foucault, ces travaux insistent sur la nature de la contrainte qui s’exercerait dorénavant sur la famille. Davan-tage régulateur que coercitif, le pouvoir n’interviendrait plus par la seule entremise de la loi et de l’institution judiciaire mais aussi par celle de la norme et des institutions sociales et médico-sociales travaillant à son intériorisation.
Parmi ces publications, l’ouvrage de Jacques Donzelot a particulièrement marqué les esprits, au point que son titre, La Police des familles, donne par métonymie son nom à tout cet ensemble de travaux. Rémi Lenoir en résume le propos de la sorte : « la ligne générale de l’ouvrage (…) consiste à montrer que le pouvoir n’a jamais cessé de surveiller les familles et que la famille est elle-même un instrument de surveillance des individus, ceci grâce à l’action normalisatrice des instances judi-ciaire, pénitentiaire, psychiatrique et des institutions philanthropiques auxquelles ont succédé les institutions de service social »28. En sociologue et historien, Jacques Donzelot montre comment, tout au long des XVIIIème et XIXème siècles, l’État déploie un dispositif de régulation douce de la famille, s’exerçant de manière différenciée selon les milieux sociaux par la « normalisation » et la « moralisation ». Le poids de l’institution médicale, et en particulier l’extension du pouvoir des psy-chiatres, occupe une place importante dans son analyse.
Révélant combien la famille constituait un espace d’intervention prioritaire pour la régulation de l’ordre social – l’ « instrument privilégié pour le gouvernement des populations » 29 –, ces recherches ont posé les bases d’une sociologie de la régulation familiale. Toutefois, malgré l’impor-tant succès qu’elles ont rencontré, de nombreuses réserves ont depuis été émises. Faute d’ « une analyse des normes inscrites dans des pratiques de normalisation » et d’ « une évaluation de l’effet de ces normes dans les pratiques des “normalisés” », l’approche adoptée apparaît éloignée de l’ex-périence des acteurs, écrasée par le caractère a priori implacable d’ « une imposition normative qui va directement des discours normatifs à la conformité présupposée des conduites »30. Pour éviter un tel écueil, une proposition stimulante a depuis été formulée : considérer les médecins, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, éducatrices de jeunes enfants, magistrats, psychologues, infir-mières, auxiliaires de puériculture, etc. comme des « professionnel·les de la morale familiale » – ni “entrepreneurs de morale” agissant pour leur propre compte », ni « “agents de l’État” qui se – raient de simples courroies de transmission d’un pouvoir transcendant »31 –, et observer leur travail in situ.
Les enquêtes conduites, par exemple, par Delphine Serre auprès des médecins, puéricul-trices et auxiliaires de puériculture de PMI, et des assistantes sociales scolaires suggèrent bien l’in-térêt qu’il y a à ancrer l’analyse de l’encadrement des familles dans une sociologie du travail atten-tive aux pratiques quotidiennes, aux propriétés sociales et au rapport au travail de celles et ceux qui font la politique de l’État32. Prendre en compte les hiérarchies internes entre et au sein des différents groupes professionnels33, tout comme les enjeux relatifs à la division morale du travail et aux stra-tégies de légitimation entre parents et professionnel·les de l’enfance, constitue une piste supplémen-taire susceptible d’affiner l’analyse34. De la même manière, considérer l’identité sociale des destina-taires des normes s’avère riche d’enseignements pour comprendre les appropriations différenciées des prescriptions normatives35. Enfin, examiner au plus près les pratiques d’encadrement permet de plonger « au coeur de l’État » pour « appréhender les valeurs et les affects qui traversent les poli-tiques des gouvernants et les pratiques des agents »36. Car pénétrer le fonctionnement ordinaire des institutions publiques revient en effet souvent à éprouver les ambivalences inhérentes aux interven-tions sociales, sanitaires ou éducatives, et les tensions morales entre contrôle et protection, entre contrainte et soin, entre « surveiller » et « veiller sur » qui ne manquent pas de se glisser dans les mécanismes contemporains des « présences sociales »37. Ensemble, ces différentes perspectives de recherche soulignent, en creux, les limites des approches pionnières de la régulation des familles, marquées par la forte sensibilité des sciences sociales françaises de leur temps aux logiques d’impo-sition normative. Elles ne les désarment pas pour autant de leur potentiel critique et invitent au contraire à complexifier l’analyse de la police contemporaine des familles.
Depuis les années 2000, l’attention portée aux modes de contrainte qui s’exercent sur les individus via l’encadrement de la forme familiale façonne en effet un programme de recherche re-vivifié par l’institutionnalisation des études féministes, le renouvellement des études de la gouver-nementalité et, plus récemment, par le développement des parenting culture studies38. Alors que la privatisation de la vie familiale »39 a pu faire croire à un retrait de la puissance publique de l’inti-mité domestique, de nombreux travaux ont montré, en France et ailleurs, que l’intervention sur la famille, plutôt que d’être suspendue, s’était reconfigurée. Parenting turn40, parentalisme41, parental determinism42, parentalisation du social43, police de la parentalité44… de nouveaux instruments conceptuels ont été proposés pour rendre compte des « habits neufs du familialisme »45. Alors que le seul lien dorénavant pérenne pour « faire famille » serait celui qui lie un parent à son enfant 46, l’examen de « la parentalité » et de sa régulation renouvelle l’analyse de l’encadrement institution-nel des familles.
La parentalité, objet privilégié de la régulation des familles
Le terme « parentalité » sature aujourd’hui les discours sur l’enfance, sans qu’il ne soit tou-jours interrogé plus avant. Son usage est pourtant potentiellement problématique, tant sa diffusion participe d’ « une véritable opération de redéfinition d’une epistemé (…), c’est-à-dire d’une confi-guration de savoirs divers qui néanmoins produisent une régularité discursive, voire autorisent le déploiement de modalités d’actions spécifiées dans différents domaines de la vie sociale »47. « Ca-tégorie de l’action publique »48 d’invention récente, le néologisme émerge en France, sur la scène politico-médiatique, dans la seconde moitié des années 1990. Dans un contexte sécuritaire visant à réduire les déviances juvéniles imputées à l’incompétence et l’irresponsabilité de parents jugés dé-missionnaires, il désigne un nouveau problème public : l’exercice de la fonction parentale49. Issue des savoirs du psychisme, la notion est toutefois antérieure à sa politisation. Désignant la prise en charge matérielle, affective et éducative d’un enfant, elle défend une perspective constructiviste et dynamique : être parent n’est jamais une évidence (naturelle ou sociale) mais un processus de maturation psychologique et un accomplissement pratique50. En dépit de la perspective anti-essentialiste que cette notion invite à adopter, elle est, dès sa formulation, évaluative. Elle ne se limite en effet pas à décrire le contenu de la fonction parentale mais se voit mobilisée pour déterminer la capacité des parents à « assumer leurs rôles » et « remplir leurs obligations », vis-à-vis de leurs enfants comme de l’ordre public51.
Dès lors, s’impose progressivement une idée forte. Ne découlant d’aucunes prédispositions innées, l’exercice parental – parce qu’il s’apprend – doit bénéficier du regard et de la supervision d’expert·es, et ce d’autant plus qu’un pouvoir immense est attribué aux parents – à ce qu’elles et ils font, pensent ou ressentent – sur le devenir de leur enfant52. Au-delà des formes singulières qu’adoptent les interventions auprès des parents, elles se rejoignent sur une dimension centrale de la culture de la parentalité » 53 contemporaine : « le “bon” parent est celui qui fait appel au savoir dont disposent les spécialistes »54. Comme la famille pathogène d’hier55, la « parentalité » offre dès lors un espace d’investissement professionnel qu’occupent « nombre de psychologues, médecins, psychiatres, psychanalystes, et plus largement tous ceux que l’on pourrait qualifier, avec Robert Castel, de “thérapeutes pour les normaux” »56. En définissant les attentes des enfants, et en propo-sant de transmettre aux parents des techniques pratiques et discursives visant à assurer leur bien-être, la manière conforme d’exercer la fonction parentale participe à la constitution de ce qui semble correspondre à un vaste « champ d’intervention professionnelle » 57. Si le développement des conseils et prescriptions à destination des parents répond en partie à une logique de marché, il « correspond aussi à une forte demande politique qui, en écho aux inquiétudes et incertitudes des parents sur leur mission éducative, se soucie de garantir au mieux la réussite de cette mission, ou plutôt d’éviter son échec et les risques supposés qu’ils feraient courir à la collectivité toute entière »58. À l’heure où il est devenu nécessaire d’accompagner des parents potentiellement dépassés par les charges et les responsabilités que leur impose leur fonction, de nouveaux dispositifs émergent pour les « soutenir ».
Les politiques publiques nous ont habitués à la construction de termes qui surgissent dans le so-cial comme des évidences. Promus par le discours public et médiatique, supports de dispositifs et de pratiques professionnelles qualifiées de nouvelles – voire d’innovantes au moment où elles émergent –, ces termes recouvrent des réalités souvent bien plus complexes que ne le laissent en-tendre leurs usages convenus. C’est le cas du « soutien à la parentalité », dimension aujourd’hui transversale à différents domaines d’action publique et priorité de certaines politiques nationales. Il désigne un paradigme d’interventions éducative, sociale et sanitaire revendiquant rompre avec des pratiques institutionnelles en direction des familles jugées trop normatives et disqualifiantes. Dans ces « nouveaux » modes d’intervention, les relations familiales « bénéficient – voire nécessitent – pour se révéler et se maintenir face aux difficultés, de la médiation de tiers se situant non dans une position de contrôle hiérarchique, mais dans une posture d’accompagnement »59. Considérant les parents à l’aune d’un horizon capacitaire, la logique du soutien entend valoriser et développer leurs compétences, quand bien même les parents seraient considérés momentanément « défaillants » 60. Elle s’opposerait en cela à une logique adverse, dont elle cherche à se départir, fondée sur des formes d’action plus contraignantes inscrites dans un contexte où prédominerait la suspicion à l’égard d’une figure parentale à redresser61. Entre ces deux conceptions se profileraient deux moda-lités radicalement contradictoires d’intervention auprès des familles : le soutien versus le contrôle62. Pourtant, une telle opposition discursive ne résiste pas à l’épreuve des faits. Plusieurs travaux in-vitent ainsi à considérer le « soutien à la parentalité » comme « le volet préventif d’une action d’encadrement des familles »63 participant, qui plus est, à la production d’un ordre singulier reprodui-sant la force et la permanence des inégalités et hiérarchies sociales, notamment de genre.
Alors que « le parent d’aujourd’hui est presque devenu un être unisexe, voire asexué »64, l’ana-lyse de l’action publique en direction des familles montre à quel point les activités visant la « paren-talité » réservent à la maternité et à la paternité un traitement différencié, participant à la reproduc-tion des rôles sexués65. Comme l’écrit Thierry Blöss, « une forme d’essentialisme imprègne en effet encore l’action des politiques publiques dont les ressorts restent pour le moins ambigus, car au cœur d’une tension entre d’un côté une logique égalitaire marquée par la volonté de l’État de rendre plus équitable l’exercice des rôles parentaux, et de l’autre une logique différentialiste […], fondée sur un souci de protection du statut maternel »66. Dans les institutions et dispositifs du travail social, par exemple, les mères constituent les cibles prioritaires des prescriptions et des mesures de soutien et d’accompagnement : « [elles] restent encore (…) largement comptables de l’ordre familial »67. Co-line Cardi révèle combien les dispositifs de « soutien à la parentalité » de l’action sociale ont tout lieu de figurer dans la « cartographie du contrôle social institutionnalisé réservé aux femmes » qu’elle dessine68. Rappelant que la protection et l’assistance sont des ressorts essentiels du contrôle social, la sociologue met en évidence « les liens étroits entre ordre social, ordre familial et ordre du genre » que ces interventions viennent réactiver « sous des formes renouvelées par le registre de la psychologie »69. Ses recherches ont largement contribué à lever, en France, les silences de la socio-logie de la régulation des familles sur les enjeux de genre jusqu’alors singulièrement absents. Elles ont également actualisé l’analyse de la place occupée par les savoirs du psychisme dans les activités visant la « parentalité », soit en premier lieu la maternité.
L’examen de la construction psychanalytique d’une certaine « cause de l’enfant » que propose Sandrine Garcia nous renseigne encore davantage sur le « processus de naturalisation de la division sexuelle du travail parental et l’avènement d’une “police des mères” [qui] font sortir de l’espace privé les relations qu’elles entretiennent avec leurs enfants, pour s’immiscer dans l’économie affec-tive familiale (…) »70. La sociologue montre comment la définition de nombreux « risques psycho-logiques » a fonctionné « comme une ressource au service d’un magistère moral, lequel, sans jamais se référer formellement à la figure de la “bonne mère”, ne cesse de rappeler les mères à de nou-veaux devoirs »71. Restituant les conditions d’émergence de l’« orthopsychanalyse » – cette « péda-gogie psychanalytique destinée à éduquer les parents » – sa recherche contribue à mettre au jour les ressorts du « puérocentrisme maternel » contemporain : il s’adosse sur et assoit une conception hié-rarchisée des rôles dans la famille, et en particulier l’assignation prioritaire des femmes à leur rôle maternel et au travail parental72. Portant l’essentiel de son propos sur les « entrepreneurs de morale » et la « bataille des normes » qui les oppose, son ouvrage ne traite qu’à la marge des façons dont opère en pratique l’ « influence » des mots d’ordre de la psychanalyse des enfants. Sa lecture n’en est pas moins heuristique. Dans un contexte où la « cause des enfants » s’est élargie, vers l’amont, à une « cause des bébés », elle invite en creux à interroger les formes contemporaines de cette « police des mères », la circulation des savoirs psy et les enjeux de leur appropriation par les professionnel·les de la naissance.
La médicalisation du travail procréatif
La procréation est un objet de recherche relativement peu légitime des sciences autres que médicales. La sociologie dispose pourtant de solides bases théoriques pour la penser. Les analyses des féministes matérialistes ont ainsi armé les sciences sociales contre « le discours de la Nature »73. Rappelant que l’espèce humaine est relativement infertile, l’anthropologue italienne Paola Tabet a mis au jour les logiques au principe de l’appropriation de la sexualité féminine dans les relations hétérosexuelles, soit toute « l’organisation sociale de l’exposition [des femmes] au risque de gros-sesse » dont les modalités varient d’une société à l’autre74. Parmi elles, la socialisation à la sexualité coïtale, le mariage ou la répression de la contraception, de l’avortement et de l’infanticide sont compris comme autant de moyens pour contraindre les femmes à la sexualité reproductive. Dans son sillage, Nicole-Claude Mathieu a pris le contre-pied de l’idée communément admise selon la-quelle la maternité relèverait d’une certitude biologique là où la paternité, définie par différents mé-canismes sociaux comme le mariage, la reconnaissance ou l’adoption, serait par essence hypothé-tique. Travaux ethnologiques à l’appui, l’anthropologue française a montré qu’enfanter ne suffisait pas à faire d’une femme une mère. Socialement prescrite ou proscrite à certaines selon les configu-rations dans lesquelles elles se trouvent, la maternité n’est pas moins sociale que la paternité et ne découle en rien mécaniquement de la gestation ou de l’accouchement75. En dénonçant « la base “na-turelle” qu’[…] offre [la maternité] à l’explication de la subordination féminine »76, ces travaux ont contribué à donner à la procréation le statut de fait social et ont ouvert la voie à l’analyse des res-sorts politiques de l’assignation des femmes à la « production d’enfants »77.
Maîtrise de la fécondité, surveillance de la gestation, accouchement, élevage des nouveaux-nés… faire des enfants relève en effet d’une multitude de tâches accomplies essentiellement par les femmes « toujours au nom de la nature, de l’amour ou du devoir maternel »78. Or, là où elle n’était envisagée autrement que comme « un état naturel, évident au point qu’il n’est ni nécessaire, ni légi-time d’en parler »79, considérer la reproduction, et l’enfantement en particulier, comme un travail80 permet de dégager la maternité de toute conception réifiante supposant sa préexistence aux opéra-tions par lesquelles elle se produit et se réalise. Fondamentale, cette étape conceptuelle a toutefois surtout contribué à l’analyse (et à la défense) du refus de la maternité81. En montrant que la production d’enfants relevait d’une forme d’exploitation de la potentialité procréatrice des femmes, cette perspective a en effet pour partie conduit à soupçonner d’essentialisme toute entreprise scientifique privilégiant la question de l’expérience subjective et/ou corporelle de la maternité sur celle de la gestion sociale de la reproduction »82, comme si l’une devait nécessairement occulter l’autre83. Le relatif désintérêt pour la maternité que connaît, en France, la sociologie du genre en est un héritage : le parti-pris critique s’est notamment mué en évitement de la question »84. Un tel constat semble cependant de moins en moins de mise, comme en témoigne la multiplication des travaux relatifs à l’enfantement réalisés par de jeunes chercheures formées aux études féministes85.
Sans nécessairement prendre la maternité directement pour objet, les sciences sociales, et en particulier l’anthropologie de la parenté et de la reproduction, ont contribué à poursuivre sa dénatu-ralisation. En portant le regard sur les situations où l’évidence du lien entre procréation et filiation est mise à mal, elles ont dévoilé la force de l’arbitraire qui les unissait. Les recherches sur les tech-nologies d’assistance à la reproduction86, pratiques permettant de ne plus faire dépendre la procréa-tion de la sexualité et autorisant, en principe, des expériences parentales indépendantes du couple hétérosexuel, ont conduit à interroger « la nature de la maternité »87. Parce qu’elle permet de diviser le travail reproductif entre une donneuse d’ovocytes, une gestatrice et une femme assurant la fonc-tion parentale, l’évolution des techniques a mis en évidence le caractère potentiellement fragmenté du processus procréatif. Or, quand la production d’enfants peut être scindée entre plusieurs femmes, l’évidence physiologique du corps maternel est battue en brèche88. « La définition même de la ma-ternité n’est plus assurée »89. Pourtant, la maternité ne s’en est pas trouvée radicalement dénaturée.
En France, une femme qui donne naissance à un enfant ne peut en être que la mère : l’accouche-ment demeure « une présomption irréfragable de maternité »90. Et alors qu’une femme qui accouche peut ne pas transmettre ses gènes à l’enfant qu’elle met au monde, « la loi singe la biologie, pour confondre l’artifice avec la nature »91 en ne réservant cette possibilité qu’aux seules femmes qui, du fait de leur âge, de leur situation conjugale et de leur sexualité, sont susceptibles de faire illusion92. Un constat qui dit bien la place qu’occupe l’État non pas seulement dans la régulation des familles mais également dans leur génération même.
Les travaux portant sur l’encadrement des corps reproducteurs féminins le rappellent : la (non) production d’enfants, quelles qu’en soient les modalités, est un lieu d’exercice du pouvoir de l’État par l’entremise de la médicalisation93 de la fonction génitrice des femmes. Elles montrent combien la préservation du potentiel procréatif des femmes, enjeu politique ancien, est au principe de l’intérêt public pour la surveillance de la conception, du processus gestationnel, de l’accouche-ment et des soins aux nouveau-nés. Dans une perspective historique, Françoise Thébaud analyse, par exemple, comment la montée du souci démographique et nataliste a conduit, au tournant du XXème siècle, à placer l’enfantement sous la « protection » de l’État 94. Dans un contexte où il im-porte de faire naître, l’État mandate des agent·es pour prévenir les déviances procréatives (contra-ception, avortement, abandon, mortalité infantile) et discipliner les (futures) mères. Des recherches ont renseigné l’avènement des professions (sages-femmes, assistantes sociales, puéricultrices, etc.) participant, dès la grossesse, à l’encadrement des conduites maternelles et d’une activité de « police féminine »95. D’autres, enfin, insistent sur le poids de la rhétorique contemporaine du risque dans l’auto-régulation des conduites attendue des femmes enceintes, au nom de la préservation de leur précieuse cargaison » 96. Ensemble, ces travaux ont montré que la « fonction maternelle » faisait des femmes l’objet d’interventions médicales multiples. Pour assurer la santé des (futurs) enfants, la médicalisation est devenue un instrument du « gouvernement des grossesses » 97, et plus largement du travail procréatif des femmes. Les analyses contemporaines des instruments renouvelés de la biopolitique offrent de précieux outils conceptuels pour en examiner les modalités.
Dans son analyse du passage de la rationalité gouvernementale du répertoire ancien de la souveraineté au répertoire moderne du libéralisme, Michel Foucault accorde une place centrale à la biopolitique. Les technologies de gouvernement qui lui sont associées opèrent au travers d’interven-tions sur la vie et sur les propriétés biologiques des sujets, par l’entremise du contrôle collectif des populations et de la conduite des comportements individuels98. Plusieurs auteur·es ont depuis exa-miné l’évolution de ce régime de pouvoir et ses spécificités contemporaines. Plus qu’une simple discipline qui chercherait à corriger les conduites du corps en imposant de façon autoritaire et inti-midante des manières de faire et d’agir, le contrôle étatique se déploierait dorénavant sous des formes renouvelées, en rupture avec la logique des dispositifs disciplinaires, au travers d’une nor-malisation douce, celle de la vigilance, de la prévention et de l’ « éducation à la santé »99. Sans que ne disparaisse pour autant la sanction, le pouvoir agirait de façon privilégiée en cherchant à susciter l’adhésion et la participation des sujets qu’il soumet. Comme l’écrivent Didier Fassin et Dominique Memmi, « à l’intimidation au nom de la loi tend à se substituer une obligation d’intérioriser la norme. Mieux : c’est souvent la loi elle-même qui pourvoit au transfert de légitimité permettant à l’individu de décider lui-même de la meilleure manière de s’administrer – de protéger sa santé, de contrôler sa reproduction, de construire sa vie, de choisir sa mort. (…) Gouverner c’est faire que chacun se gouverne au mieux lui-même »100 repose sur le pouvoir d’une auto-contrainte soutenue par l’État et examinée par le corps médical. En articulant les perspectives de Michel Foucault et de Norbert Elias, la sociologue identifie le passage d’une « institution disciplinaire » à une « institution civilisatrice », faisant la part belle au souci de soi et à une coopération entre médecins et patient·es s’accordant sur « un état jugé à la fois souhai-table et atteignable de la bonne santé ». La régulation des conduites fonctionne alors à partir d’un certain type d’exercice du pouvoir : un gouvernement « par la parole » convoquant la « bonne vo – lonté discursive » d’individus soumis à des « sollicitations biographiques » répétées 101. « L’accès à chacune des prestations concernant le début et la fin de vie est ainsi suspendu à au moins un entre-tien avec un médecin, auquel s’ajoutent des échanges obligatoires avec des figures annexes à l’uni-vers médical (infirmières, sages-femmes, psychologues, conseillères familiales). Fourniture d’in-formations déterminantes (en cas d’avortement pour raisons médicales ou de procréation assistée), d’avis, de conseils éclairés, mais aussi contrôle des motifs de la décision, qui s’ils ne sont pas adé-quats, permettent sauf exception (avortement dit “volontaire”) au praticien de retarder ou de refuser la prestation demandée : l’échange de paroles, ce moment minuscule, est un moment névralgique de la surveillance des conduites. »102
Une sociologie du travail d’« accompagnement » des mères en périnatalité
Identifié au début des années 2000, ce dispositif n’a depuis cessé d’« étendre son empire » en passant toutefois, comme le souligne Dominique Memmi plus de dix ans plus tard, par « d’autres voies que par le passé »103. Car si les corps restent les supports de puissants investissements sociaux passe dorénavant des aléas de la reproduction pour constituer la subjectivité féminine et leur « tra-vail de transformation de soi »106 – leur « devenir » mère – en objet de régulation. En se situant à l’intersection des travaux portant sur la régulation de la famille, l’encadrement de la parentalité, la médicalisation de l’enfantement et le gouvernement des corps, c’est cette dimension du gouverne-ment contemporain du travail procréatif que cette thèse explore.