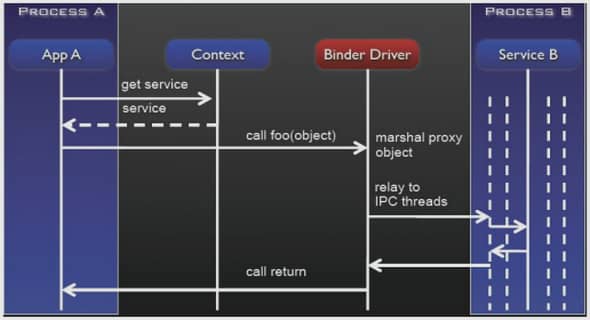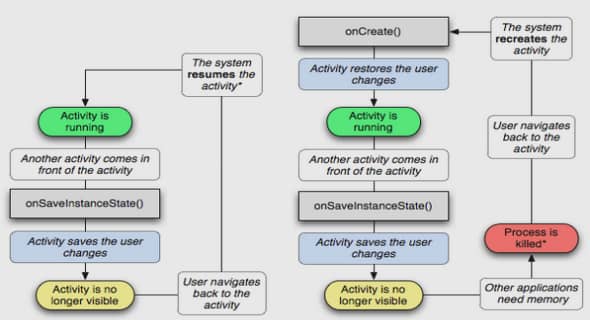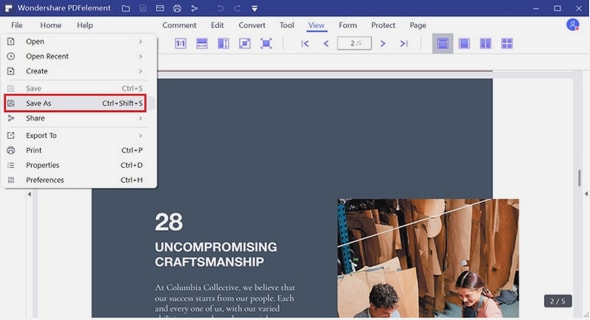Des saints collectifs
Les martyres collectifs sont relativement fréquents dans le christianisme. En effet, les chrétiens de l’Antiquité ont été persécutés en tant que groupe et parfois martyrisés à plusieurs. Les chrétiens de l’Antiquité comme du Moyen Âge ne rechignent donc pas à vénérer un groupe de saints et martyrs, même si souvent le besoin se fait sentir d’individualiser un ou plusieurs personnages par ses (leurs) hauts faits ou sa (leur) capacité d’encourager ses (leurs) coreligionnaires durant les supplices. Les Passions antiques, récits contemporains des martyres antiques, font état des supplices endurés par de petits groupes, souvent de deux à dix personnes2. Plus tard, des récits légendaires, établis après la découverte de reliques afin d’authentifier celles-ci, font état de groupes de martyrs plus importants, au nombre indéterminé ou largement hyperbolique, tels la Légion thébaine, dont le nombre de soldats est, chez Jacques de Voragine par exemple, de 6 666, les Onze mille vierges, les dix mille martyrs du Mont Ararat, ou encore les Innocents, si l’on retient le nombre parfois allégué de 144 0003.
La légende de la Légion thébaine rapporte qu’à la fin du IIIe siècle, du temps de l’empereur Dioclétien, les soldats de la légion thébaine de l’armée romaine, alors qu’ils traversaient les Alpes pour se rendre en Gaule guidés par leurs chefs Maurice, Candide, Exupère et Victor, refusèrent de sacrifier aux dieux avant la bataille et furent pour cela martyrisés. Au Ve siècle, Eucher de Lyon compose leur Passion et des miracles sont réputés se produire dès le VIe siècle. La dépouille de l’un de ces soldats, saint Innocent, fut rejetée par les eaux du Rhône ; ses reliques furent transférées à Magdebourg en 937. Les plus anciennes représentations iconographiques datent de la première moitié du XIIe siècle et semblent relever d’un besoin de mettre en avant le chef de la légion, Maurice1. Le récit qu’en donne Jacques de Voragine au XIIIe siècle recourt au motif de l’armée du Christ pour désigner ces soldats prêts à servir l’empereur, mais pas au prix de la trahison de leur foi. « Les soldats du Christ sont donc encerclés par ceux du diable »2, écrit Jacques, dans une série d’antithèses opposant l’innocence des martyrs à la tyrannie d’un pouvoir coupable. En plein XIIIe siècle, à l’appui d’une légende inventée huit siècles plus tôt pour authentifier des reliques, le motif antique de l’innocence des chrétiens est repris, et cette innocence est ainsi définie : les soldats de la Légion thébaine ne sont coupables d’aucune faute envers l’empereur, « ni trahison, ni peur », disent les soldats3, sinon de ne pas vouloir trahir le Christ en sacrifiant aux dieux romains. À l’un des martyrs de la Légion, la tradition a donné le nom d’Innocent : la Vita d’Anno, archevêque de Cologne, mentionne que celui-ci, vers 1069, entra dans une église à Rome et, soudoyant les gardiens, vola les reliques d’Innocent et de Vital, martyrs de la Légion thébaine, rentra avec elles à Cologne et construisit une église pour les y recevoir4. On invente du reste progressivement à cette légion thébaine, en plus d’un chef, des généraux, puis tous les grades de la hiérachie militaire.
La légende d’une autre armée innocente est inventée sur des bases antiques infimes et amplifiée entre le Xe et le XIIe siècle : celle des Onze mille Vierges. L’innocence des victimes est non seulement l’antithèse du pouvoir tyrannique des persécuteurs, mais également le reflet du statut sexuel des martyres de cette armée virginale. La légende, telle qu’elle est fixée par Jacques de Voragine, raconte qu’une vierge anglaise du nom d’Ursule aurait demandé de différer son mariage afin d’effectuer un pèlerinage à Rome, en compagnie de mille vierges. En chemin, de nombreuses jeunes filles, ainsi que des clercs se joignent au cortège. Le pape lui-même accompagne cette armée virginale, massacrée sur le chemin du retour de Rome à Cologne par les Huns, vraisemblablement prévenus et encouragés par les Romains. Laurence Moulinier montre que la légende et l’invention des reliques sont apparues concomitamment sur la base d’un récit très elliptique : la découverte d’une nécropole romaine dans les années 1100 a fourni les ossements nécessaires au développement du culte, qui se nourrit des visions de la mystique Élisabeth de Schönau (1129-1164). Celle-ci identifie l’occupant(e) de chaque tombe en imaginant des liens de parenté ou d’amitié avec Ursule, inventant ainsi les reliques, au double sens du terme : le récit concernant ces reliques est composé au moment-même de leur découverte1.
Le Moyen Âge vénère donc des saints collectifs présentant une triple dimension guerrière, virginale et innocente face à un pouvoir tyrannique, ce qui rend possible de penser les saints Innocents dans les mêmes termes. Cependant, la question du processus qui conduit à la création de saints à partir du substrat biblique est loin d’être élucidée. De plus, à la différence des groupes de martyrs évoqués ci-dessus, aucune individualité ne se distingue du groupe des Innocents, dans la majorité des textes les concernant2.
Des « martyrs de faits divers » ?
Par certains aspects, les Innocents peuvent être rapprochés de ce qu’Edina Bozóky nomme des « martyrs de faits divers », c’est-à-dire des martyrs « assimilés aux martyrs de la foi, mais qui ont subi une mort violente et injuste pour des raisons non religieuses, telles la cupidité ou encore la convoitise 3 ». De fait, les Innocents correspondent à cette définition : victimes de la cupidité d’un pouvoir tyrannique menacé dans ses fondements, ils ont été massacrés en tout premier lieu pour des raisons politiques, c’est-à-dire du fait de la crainte d’Hérode de voir le « roi des juifs » lui prendre sa place. C’est du moins ainsi qu’une grande partie des exégètes médiévaux le comprennent, même s’il faut se garder de sous-estimer la dimension typologique du récit de l’évangéliste : pour Matthieu, le massacre des Innocents n’est pas tant un phénomène politique qu’un épisode témoignant de la correspondance entre Jésus et Moïse, réchappant tous deux d’un massacre d’enfants, quel que soit le motif de celui-ci. En effet, dans le livre de l’Exode 1, 15-22, la motivation de Pharaon à faire massacrer les premiers-nés hébreux n’est pas tant la crainte de perdre son trône, mais plutôt celle que le peuple hébreu prolifère excessivement : la raison du massacre est ici ethnique et religieuse. Au contraire, le massacre des Innocents est souvent présenté comme étant politiquement motivé.
ce motif non-religieux du massacre s’ajoute le caractère injuste, au sens de contraire au droit », immérité de la mort des enfants. Cet aspect est tardif dans le discours sur le massacre des Innocents. Dans l’Antiquité et au début du Moyen Âge, l’injustice du massacre n’est pas mise en avant : l’opinion dominante est celle d’Augustin († 430) et de Pierre Chrysologue († v. 450), pour lesquels le massacre n’est pas injuste puisqu’il fait partie du plan divin et illustre le fait que le martyre s’acquiert uniquement par la grâce divine. À l’époque carolingienne, on trouve chez Raban Maur l’idée que Rachel, incarnation de l’Ecclesia, se lamente sur le « meurtre injuste de ses membres »1, mais le terme est très peu repris avant la fin du XIIIe siècle et le chapitre sur les Innocents de la Légende dorée. Jacques de Voragine consacre un développement au fait que les Innocents le sont en raison de la « passion injuste » qu’ils ont subie2 : puisqu’ils n’ont nui à personne, il est injuste qu’il leur soit fait du mal. Cette apparition du caractère injuste du massacre à la fin du Moyen Âge est peut-être à mettre en lien avec la nécessité de faire correspondre le discours sur les Innocents avec la sensibilité laïque, et non plus avec des conceptions théologiques portées plutôt en milieu monastique.
L’idée d’injustice dans le martyre a été diversement interprétée dans l’historiographie. Henri Irénée Marrou soulignait déjà la coexistence de la notion théorique du martyre volontaire et de saints canonisés pour l’unique raison qu’ils ont subi une mort imméritée 1 , et imputait l’existence de ces derniers à une « piété populaire » qui aurait été une « survivance d’un aspect de la mentalité chrétienne du Bas-Empire »2. Marrou étudie un exemple de ces victimes innocentes sanctifiées par le caractère injuste de leur mort : il s’agit du sort de trois employés des tribunaux du vicaire d’Italie, exécutés sur ordre de l’empereur Valentinien vers 364-367 et vénérés dans un lieu nommé Ad Innocentis. Ce récit provient des Res Gestae d’Ammien Marcellin (XXVII, 7, 5-6), auteur païen mais non hostile au christianisme, qui selon Marrou a cependant à cœur de prouver la férocité de Valentinien, empereur chrétien. Celui-ci aurait fait exécuter les trois apparitores coupables simplement de lui avoir rappelé ses devoirs de gardien du droit. Les victimes de cette mort injuste – littéralement, « contraire au droit » – auraient immédiatement et spontanément été vénérées comme des saints chrétiens (il n’est pas précisé s’ils étaient chrétiens) : ils ne sont donc pas des martyrs de la foi, mais martyrs en raison de leur mort imméritée. Marrou identifie le lieu de culte Ad Innocentis mentionné par Ammien Marcellin à la pietra degli Innocenti qui se trouve dans l’église S. Stefano Maggiore de Milan. Il rapproche également les saints Innocents de Milan des saints Innocents bibliques, dont il fait le paradigme de la mort injuste, et des « saints souffrants » de la piété russe (sviatie strastoterptsi), dont une réplique fameuse du Boris Godounov (1831) de Pouchkine garde le souvenir3. Dans cette scène, le tsar usurpateur enjoint un simple d’esprit (un « innocent », en français) à prier pour lui ; le fou lui répond : « Non, non, on ne prie pas pour le tsar Hérode, la sainte Vierge le défend ! ». Pour Marrou, ces saints souffrants » incitent à la piété par la simple horreur du sang versé ; il les compare à Sigismond, roi des Burgondes, béatifié non pour ses pieuses actions (il avait fait assassiner son fils Sigeric…) mais du simple fait qu’il fut cruellement jeté dans un puits par le roi franc Clodomir d’Orléans4.
L’effusion injuste de sang comme cause unique du martyre est également le ressort de l’histoire du saint Guinefort étudié par Jean-Claude Schmitt1. De même, André Vauchez explique, dans la lignée de Marrou, la « canonisation populaire » :
Du contraste entre la dureté du châtiment infligé et son caractère inique naissait une émotion, qui, transposée immédiatement sur le registre religieux, s’épanouissait en dévotion. En vertu d’un processus que nous pouvons considérer comme une loi de l’affectivité populaire, la pitié suscite la piété2 ».
Vauchez oppose une conception « populaire » du martyre, qui, « aux yeux des masses, était attesté par la simple effusion de sang innocent » (au point d’ailleurs de vénérer un chien comme saint) et vouée à disparaître, à une conception cléricale plus exigeante qui entendait « réserver ce titre à ceux qui avaient exposé leur vie pour la foi de façon consciente et volontaire »3. L’usage du terme « populaire » par les historiens a fait l’objet de nombreux débats4 et il est difficile aujourd’hui d’adhérer pleinement à cette dichotomie. On se trouve bien en présence de deux conceptions du martyre qui coexistent, sans que l’une soit plus « moderne » que l’autre qui ne serait qu’une survivance du christianisme primitif5. Il semble qu’un certain invariant – l’indignation suscitée par la mort injuste – ait pu être réactivé dans des contextes différents et à l’appui de plusieurs causes : les employés de tribunaux un peu trop zélés sous Valentinien, les « martyrs de faits divers » du haut Moyen Âge, les enfants chrétiens prétendument victimes des juifs. Cette composante est également présente, avec des variations, dans le discours sur les Innocents : quasi-absente dans l’Antiquité et le haut Moyen Âge, activée dans l’exégèse pour la compréhension des pleurs de Rachel, puis investie par l’hagiographie au XIIIe siècle, au moment même où les canonistes incitent, justement, à ne pas glorifier toutes les victimes de mort injuste sous prétexte que les Innocents l’ont été1. Paradoxalement donc ici, l’invariant serait précisément ce qui change, ce qui revient ponctuellement sous forme de rémanences, ce qui est modulable, malléable, en fonction des nécessités sociales et religieuses.
On comprend donc mieux comment le martyre, pourtant présenté comme un absolu, est très malléable. Le motif de la mort injuste, cette « morale de l’innocence souillée », fonctionnerait, pour Miri Rubin2, comme une impulsion collective pour remédier au mal accompli et rétablir la justice, par un acte d’amour posthume envers la victime, tout en prenant part à la vertu et à la grâce qui émanent du sacrifice. La mort injuste, si elle est un leitmotiv du culte spontané des « martyrs de faits divers » ou des enfants prétendument massacrés par les juifs, n’est en rien réservée à un peuple enfant et naïf : il s’agit d’un argument d’un discours.
En outre, on l’a vu, le discours sur les saints Innocents réactive ponctuellement le topos de la mort injuste et imméritée3, mais leur culte n’est en rien « spontané » : ils sont des personnages du texte sacré, et non des personnes faisant leurs preuves dans le siècle et devant témoins. De plus, l’impulsion semble toujours venir d’en haut : dans les récits d’invention de reliques4 , par exemple, la création d’un culte aux Innocents inhérent à la découverte de reliques s’effectue toujours sous l’impulsion de moines réformateurs, de rois, ou encore d’une autorité municipale. L’identité des Innocents, que l’on cherche à comprendre à l’aune des différents types de martyrs existant dans la Chrétienté médiévale, se précise : il s’agirait de figures créées par les clercs, mais dont certaines composantes feraient appel au sentiment d’indignation largement partagé face à la mort injuste.
Des martyrs juifs antérieurs à la Passion
La désignation des Innocents comme saints et martyrs chrétiens et, a fortiori, comme les premiers chrétiens, selon l’homilétique antique1, pose problème. Au moment de leur massacre, Jésus est un bébé et, par définition, la prédication n’a pas commencé. Les Innocents ne meurent donc pas au nom d’une foi qu’ils proclament, comme c’est le cas pour les autres martyrs. Ils sont tués pro Christo, pour le Christ, mais surtout à la place de celui-ci, c’est-à-dire que leur massacre couvre en quelque sorte la fuite en Égypte et permet de signifier l’élection de Jésus, qui en réchappe. Leur simple présence dans le déroulement de la vie du Christ pourrait suffire à justifier leur culte, et l’on pourrait alors rapprocher le statut des Innocents de celui des reliques de contact. On achoppe cependant sur le fait qu’il s’agit d’enfants juifs, ce que très peu de commentateurs médiévaux relèvent : seul un texte, anonyme, mentionne le fait qu’ils ne sont pas chrétiens2. Dans son traité de liturgie, Guillaume Durand, évêque de Mende, affirme que les Innocents étaient circoncis, ce qui était alors – du temps de l’Ancienne Loi – le remède contre le péché originel3. Afin de mieux cerner l’identité des Innocents, il convient donc d’examiner leur statut à la lumière d’autres martyrs juifs vénérés par le christianisme : ceux que la tradition appelle les Maccabées.
Le supplice des sept frères anonymes, tués sur ordre du roi séleucide Antiochos IV Épiphane pour avoir refusé de se conformer aux mœurs grecques et de manger du porc, est relaté dans le Deuxième livre des Maccabées, canonique, ainsi que dans le Quatrième livre des Maccabées qui, lui, a été écarté du canon. Le nom de Maccabées a été donné aux sept frères d’après le titre du livre relatant leur histoire. Ces livres ont probablement été écrits au premier siècle, un peu avant ou un peu après la destruction du Temple. Le récit du martyre des Maccabées commence par l’histoire du vieil Éléazar1 qui refuse de manger du porc, puis d’accepter les subterfuges proposés par ses amis, car s’il échappe au châtiment de l’homme, dit-il, il s’exposera alors au châtiment de Dieu. Eléazar, par sa volonté de mort glorieuse et noble, se rattache à la tradition antique de la belle mort. La suite du récit2 porte sur une famille de sept frères qui refusent d’obtempérer aux ordres du roi. Ils sont alors tour à tour suppliciés sous les yeux de leur mère qui les encourage et finit elle aussi par périr.
Les Pères de l’Église opérèrent une lecture typologique de l’épisode en y reconnaissant la préfiguration des souffrances des chrétiens, ou en y voyant une allégorie de la lutte contre les forces du mal, ce qui permet de comparer les souffrances des Maccabées à celles que s’infligent les ascètes3. Le culte des frères Maccabées est attesté dès le Ve siècle chez les Pères de l’Église qui ont prononcé des homélies pour leur anniversaire : Grégoire de Nazianze, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan et Augustin d’Hippone. Pour ce dernier, les Maccabées sont simplement des chrétiens avant l’heure4. La fête des Maccabées apparaît du reste en première place dans le Martyrologe hiéronymien5, puis en deuxième place dans les martyrologes historiques médiévaux6 (ceux de Bède, de Florus et d’Adon) à la date du 1er août, derrière saint Pierre-aux-Liens. La fête de ce dernier a vraisemblablement été la cause de l’éclipse du culte des Maccabées en Occident.
Le rapprochement entre Innocents et Maccabées, deux « cas limites » de sainteté et de martyre, peut paraître artificiel. En effet, les sept frères persécutés sont adultes et peuvent affirmer les raisons pour lesquelles ils sont martyrisés, ainsi que leur volonté de respecter scrupuleusement les lois de leur religion, à la différence des Innocents, dont le martyre est involontaire. Cependant, le premier supplice subi par les frères Maccabées est l’amputation de la langue : les bourreaux les privent de cette langue qui leur sert à proclamer leur foi ; ils deviennent ainsi in-fantes, privés de la parole, comme les Innocents. De plus, le dernier frère à être supplicié semble très jeune, mais va à la mort sans hésiter, malgré les tentatives d’Antiochos pour le faire reculer. On retrouve l’idée d’une grande sagesse associée à la prime jeunesse, idée présente dans les discours sur les Innocents qui s’incarne dans la figure du puer senex1. Ils ont surtout le point commun d’être des martyrs chrétiens de l’Ancienne Loi. Le rapprochement entre Innocents et Maccabées est du reste explicitement effectué dans quelques sources médiévales. Au tout début du XIIe siècle, dans une note attribuée par François Dolbeau Jean de Gaète, futur pape Gélase II, un écolâtre demande à son maître pourquoi l’Église célèbre le martyre des Maccabées et celui des Innocents, tous deux antérieurs à la Passion2 ; le maître l’explique par le fait que certaines églises de Rome en possèdent des reliques.