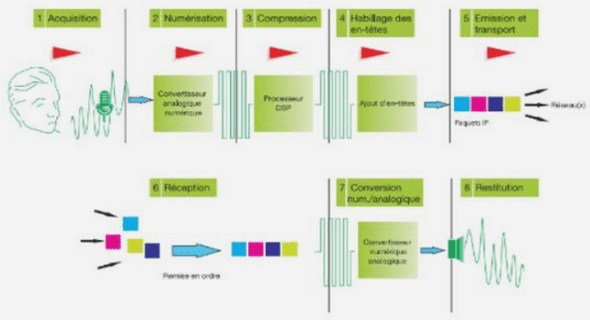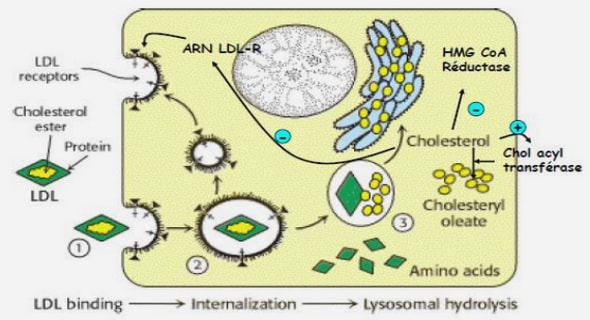L’ANESTHESIE LOCALE
L’anesthésie locale est une abolition transitoire de la sensibilité d’une partie du corps pour une intervention chirurgicale, un examen ou un traitement. Les anesthésiques locaux sont des substances qui bloquent la condition du nerf lorsqu’elles sont placées à son contact de façon spécifique et transitoire. HISTORIQUE : Connues au Pérou avant la conquête espagnole, les propriétés euphorisantes des feuilles d’Erythoxylon coca ont été rapportées à la cocaïne (Graedcke, 1855), isolée en 1860 par Nieman et utilisée à titre personnel et professionnel par FREUD ; l’utilisation de la cocaïne comme anesthésique local avait été préconisée dès cette époque par un chirurgien de l’armée péruvienne (Moréno y Maiz). Il est cependant classique d’attribuer à Köller (1884) la paternité de l’utilisation de la cocaïne comme anesthésique local ; c’est sur les conseils de FREUD que cet ophtalmologiste avait eu l’idée d’en instiller dans le cul de sac conjonctival afin de rendre l’œil insensible avant une intervention. Un an plus tard (1885), Halsted l’utilise pour la première fois en injection pour provoquer une anesthésie loco-régionale.
DIFFERENTES METHODES D’ANESTHESIE LOCALE
Anesthésie de contact : Le crème, le gel, ou l’aérosol sont déposés directement sur la surface du tissu à anesthésier : peau, conjonctive, muqueuse digestive, muqueuse bronchique, muqueuse gingivale, muqueuse génito-urinaire, muqueuse rectale.
Anesthésie par infiltration : On injecte en une ou plusieurs fois le produit en intradermique ou en sous-cutané ou en intramusculaire ou en intra-muqueuse, et qui doit être strictement avasculaire.
Anesthésie par injection intra-vasculaire : Le produit est injecté sans vasoconstriction directement dans une veine d’un membre (généralement supérieur) dont la circulation sanguine est interrompue momentanément par un garrot et la compression doit être suffisante.
Blocs des nerfs périphériques : On interrompt momentanément la conduction au niveau d’un nerf périphérique en injectant l’anesthésique à son contact. En général, la prémédication du sujet (Diazépam 10mg) est nécessaire et surtout l’emploi d’un matériel approprié avec une seringue à piston métallique et aiguilles aux biseaux courts, pas trop effilées. Diverses techniques peuvent être réalisées car le repérage précis du nerf possède une difficulté.
Anesthésie péridurale : On injecte dans l’espace virtuel péridural existant entre la dure mère perimédullaire et le canal rachidien l’anesthésique, la quantité du produit est à adapter selon le niveau de l’injection.
Anesthésie spinale : L’anesthésique est injecté dans l’espace sous arachnoidien, se fait habituellement au niveau L3-L4 ou L4-L5 et la quantité à injecter est faible (1 à 4ml).
EFFETS INDESIRABLES ET TOXICITE DES ANESTHESIQUES LOCAUX
Plusieurs effets néfastes et non négligeables sont engendrés par les anesthésiques locaux. Les réactions allergiques : Les réactions allergiques sont données en 2 grands groupes qui sont: Des manifestations générales à type de réactions anaphylactiques et des accidents allergiques. Des manifestations cutanées à type d’eczéma de contact, rares éruptions érythémateuses ou urticariennes.
La nécrose : Cette nécrose est causée par une erreur de technique d’utilisation. L’infection : L’absence ou la faute d’asepsie rigoureuse entraîne l’infection.
La toxicité aiguë et le surdosage : Ces incidents s’observent lorsque les quantités excessives d’anesthésique
local passent dans la circulation générale.
Les complications de l’anesthésie spinale : La bradycardie est le résultat d’un passage du produit anesthésique au dessus du niveau de C4 ; la chute brutale de la tension artérielle est provoquée par la vasodilatation périphérique dont cette dernière est due à la suppression du tonus vasoconstricteur α adrénergique ; l’arrêt respiratoire est dû à l’imprégnation des structures cérébrales par la haute concentration du produit d’anesthésie.
LES PHALANGES
Les phalanges sont des os longs faisant partie de l’os de la main, qui prolongent les métacarpes et formant le squelette des doigts.
L’os : Les phalanges sont au nombre de 03 pour chaque doigt sauf le pouce qui n’en possède que 02. Elles présentent chacune une extrémité supérieure creusée d’une cavité articulaire, un corps en forme de demi cylindre, avec une face antérieure plane et une forme de poulie, sauf au niveau de la 3ème phalange, où elle est libre, au dessous de l’ongle.
Les phalanges se développent par deux parties d’ossification : l’une par l’extrémité supérieure et l’autre pour le corps et l’extrémité inférieure.
La 1ère phalange: : Son extrémité supérieure est aplatie sagittalement avec une surface articulaire ovalaire, plus étendue en avant ; latéralement : deux petits tubercules; sur le pourtour : un petit sillon. Son corps est semi-cylindrique, concave en haut avec une face palmaire plane (tendon fléchisseur) ; une face dorsale convexe (tendon extenseur), des bords latéraux levés en avant (insertion des gaines fibreuses et des tendons).
Son extrémité inférieure est aplatie sagittalement avec une surface articulaire en forme de poulie, plus étendue du côté palmaire.
La 2ème phalange : Son extrémité supérieure présente une surface articulaire subdivisée par une crête sagittale : Sur le pourtour, 2 tubercules latéraux. En arrière une empreinte linéaire donne attache à la languette de l’extenseur. Son corps présente en avant l’insertion du fléchisseur superficiel (tendon perforé). Son extrémité inférieure possède une surface articulaire en forme de poulie.
La 3ème phalange : Son extrémité supérieure ressemble à celle des deux premiers. Son corps présente en avant l’insertion du fléchisseur profond (tendon perforant) et en arrière celle des languettes latérales de l’extenseur. Son extrémité inférieure, rugueuse sur sa face palmaire (pulpaire), lisse sur sa face dorsale (unguéale) se termine par un bourrelet osseux en forme de croissant.
Table des matières
INTRODUCTION
I- L’ANESTHESIE LOCALE
I.1- DEFINITION
I.2- HISTORIQUE
I.3- STRUCTURE CHIMIQUE ET CLASSIFICATION DES ANESTHESIQUES LOCAUX
I.3.1- Structure chimique
I.3.2- Classification
I.4- DIFFERENTES METHODES D’ANESTHESIE LOCALE
I.4.1- Anesthésie de contact
I.4.2- Anesthésie par infiltration
I.4.3- Anesthésie par injection intra-vasculaire
I.4.4- Blocs des nerfs périphériques
I.4.5- Anesthésie péridurale
I.4.6- Anesthésie spinale
I.5- EFFETS INDESIRABLES ET TOXICITE DES ANESTHESIQUES LOCAUX
I.5.1- Les réactions allergiques
I.5.2- La nécrose
I.5.3- L’infection
I.5.4- La toxicité aiguë et le surdosage
I.5.5- Les complications de l’anesthésie spinale
II- LES PHALANGES
II.1- DEFINITION
II.2- RAPPEL ANATOMIQUE
II.2.1- L’os
II.2.2- L’articulation
II.2.3- La vascularisation
II.2.3.1- Les artères
II.2.3.2- Les veines
II.2.4- L’innervation
II.2.5- Les muscles
II.3- LES FRACTURES DES PHALANGES
II.3.1- La définition
II.3.2- La fréquence
II.3.3- l’âge et le sexe
II.3.4- Les types de fracture
II.3.5- Les étiologies
II.3.6- Le mécanisme
II.3.7- Signes cliniques et signes paracliniques
II.3.7.1- Les fractures fermées
II.3.7.2- Les fractures ouvertes
II.3.8- Traitement
II.3.8.1- Les fractures fermées
II.3.8.2- Les fractures ouvertes
II.3.9- L’évolution
II.4- L’OSTEOSYNTHESE
II.4.1- La définition
II.4.2- L’historique
II.4.3- L’objectif
II.4.4- Les différents types
II.4.5- Les indications
II-5 – KINESITHERAPIE
II-5-1- Définition
II-5-2- Différentes techniques
II-5-3- Indications
II.1- MATERIELS ET METHODES
II.2- OBJECTIFS
II.3- OBSERVATION MEDICALE
II.3.1- IDENTITE, DATE ET MOTIF D’ENTREE
II.3.2- HISTOIRE DE LA MALADIE
II.3.3- ANTECEDENTS
II.3.4- EXAMEN CLINIQUE
II.3.4.1- Les signes généraux
II.3.4.2- Les signes fonctionnels
II.3.4.3- Les signes physiques
II.3.5- EXAMEN PARACLINIQUE
II.3.6- CONCLUSION
II.3.7- TRAITEMENT
II.3.7.1- Traitement médical
II.3.7.2- Traitement orthopédique
II.3.7.3- Traitement chirurgical
II.3.8- EVOLUTION
II.3.8.1- Evolution post opératoire
II.3.8.2- Suites proches
II.3.8.3- Suites lointaines
II.4- ABLATION DE MATERIEL D’OSTEOSYNTHESE
II.4.1- Suites opératoires après AMOS
II.5- KINESITHERAPIE
II.5.1- Bilan pré-kinésithérapique
II.5.2- Type de kinésithérapie
II.5.3- Etapes de séances de Kinésithérapie
II.5.4- Evolution
III- COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS
III.1- EPIDEMIOLOGIE
III.1.1- La fréquence
III.1.2- Le sexe
III.1.3- L’âge
III.1.4- Le mécanisme
III.1.5- Etiologies
III.2- SIGNES CLINIQUES
III.2.1- Fractures fermées
III.2.2- Fractures ouvertes
III.3- TRAITEMENT
III.3.1- La procédure anesthésique
III-3 -2- Ostéosynthèse
III-3 -3 – Kinésithérapie
IV- SUGGESTIONS-CONCLUSION
IV.1- SUGGESTIONS
IV.2- CONCLUSION