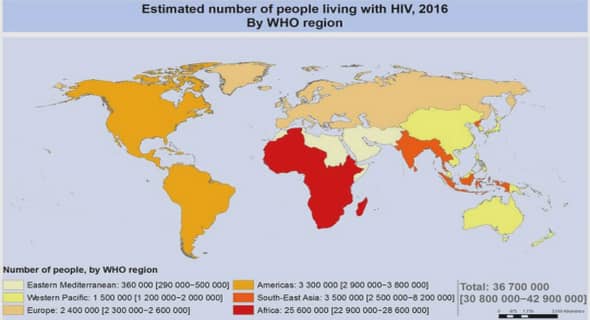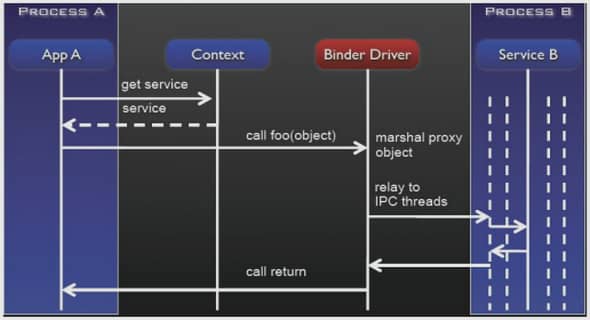Définition d’un programme ou politique publique et la notion de la pauvreté
Un programme ou politique publique : L’Etat, en tant que promoteur et garant du développement s’assure du bien-être de la population. Dans ce sens, il doit mettre en place des projets, des programmes ou des politiques publiques, en vue de lutter contre la pauvreté.
La notion de la pauvreté : Selon le dictionnaire Petit Larousse illustré en 1984, la pauvreté : «c’est l’état de celui qui est pauvre». Plus précisément, ce sont les personnes ou les familles qui vivent dans l’insuffisance c’est-à-dire avec peu de ressources, de biens et de l’argent. Cette situation de pauvreté entraîne des impacts négatifs dans la vie de ces individus ou ces familles à tel point que le milieu de résidence est dégradé, les besoins alimentaires sont limités, et aucun projet de vie ne peut être envisagé. Ici, la pauvreté s’évalue à partir des dimensions économiques
Dans le Rapport Mondial sur le Développement Humain du PNUD, il y a « l’extrême pauvreté, la pauvreté générale, et la pauvreté humaine. Ainsi, une personne vit dans la pauvreté extrême si elle ne dispose pas des revenus nécessaires pour satisfaire ses besoins alimentaires essentiels, habituellement définis sur la base de besoin caloriques minimaux.
Le cercle vicieux de la pauvreté
La pauvreté se traduit par faiblesse revenues, donc une épargne réduite qui ne permet pas l’accumulation du capital et donc la productivité reste très faible, les revenus demeurent faibles… Les revenus faibles se traduisent par la malnutrition, la productivité reste faible et les revenus également…
Les revenus faibles engendrent une demande solvable limitée, ce qui constitue une incitation à investir réduite par manque de déboucher, d’où la faiblesse des investissements qui se traduisant par une productivité réduite et donc des revenus faibles…
La faiblesse du revenu national entraîne la faiblesse des dépenses d’éducation et de formation donc de la productivité et par ricochet du revenu national…
En fait, le cercle vicieux se présente comme un système circulaire de causalité simple entre un nombre limité de facteurs. En effet, chaque facteur apparaît lié au précédent par un rapport de causalité directe: la faiblesse de l’épargne est dictée par le faible niveau de revenu…
Les moyens financiers pour la scolarité des enfants
Le règlement sur les établissements publics à l’éducation primaire et secondaire, nous observons des variations significatives des frais de scolarité selon le cycle d’étude. Dans les EPP, le droit s’élève à 25 000Ariary tandis que c’est 40.000Ariary pour les CEG. Ces variations s’expliquent par le fait que les écoles, pour assurer leur pérennité, doivent tenir compte de la capacité de payer des familles de leur communauté.
L’accès des enfants à l’enseignement : La généralisation de l’accès des enfants à l’enseignement et leur maintien jusqu’à la fin de leur scolarité obligatoire constituent aujourd’hui un enjeu majeur de la réforme du SEF.
Pourtant, force est de constater que, malgré d’importants progrès enregistrés ces dernières années, le nombre d’enfants restent encore exclus du système éducatif est de 143 enfants qui est égale à 25%. Pour l’abandon à mi-parcours, 11% ou 58 enfants par an abandonne l’école au milieu d’année scolaire.
L’abandon scolaire : L’abandon scolaire affecte également durement les élèves : en 2006, les taux d’abandon annuels sont élevés à tous les niveaux du primaire et se situent entre 9% et 31%. Face à ces constats, il devient urgent d’accentuer les efforts, selon un échéancier précis et réaliste, pour rendre effective, conformément aux recommandations du rapport 2008 du CSE, l’obligation de scolarisation des enfants de 6 à 15 ans, de garantir à tous les enfants de plus de 4 ans une place à l’école et de lutter contre l’échec et l’abandon scolaire.
La responsabilité des enseignants
Dans les institutions publiques : EPP (Ecole Primaire Publique), CEG (Collège d’Enseignement Général, public) ou lycées publics, elles manquent d’infrastructure et de personnel. A cause de l’insuffisance du budget, l’Etat n’engage presque pas d’enseignants fonctionnaires qualifiés, sortant de l’ENS (Ecole Normale Supérieure). Pour combler l’insuffisance d’enseignants, chaque établissement public engage des enseignants les payant en partie, et subventionnés par l’Etat. Ce sont les maîtres FRAM (association de Parent d’élèves). Bien sûr, ces enseignants même munis de diplômes (Baccalauréat ou licence) ont peu de formation par rapport à ses collègues sortant de l’ENS. Devant une telle dégradation de la scolarisation malgache, des ONG, des associations, s’engagent à améliorer la situation.
Les niveaux moraux et de l’engagement des enseignant(e)s fatiguent, lassent et usent par leurs tâches, ayant perdu la foi et la conviction qu’ils peuvent « faire la différence », dont l’intérêt pour la jeunesse est réduite, ne peuvent qu’être mal ressentis par les élèves et avoir un impact négatif sur le climat scolaire. Il reste que cette question est complexe car les enseignants peuvent avoir un moral relativement peu élevé et malgré tout démontrer un fort engagement. On observe par ailleurs que dans les autres pays comme la Corée et le Japon, qui ont des hautes performances dans PISA, le moral des enseignants est relativement faible.
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : APPUI FINANCIER POUR LA SCOLARITE
CHAPITRE I : REPERES THEORICO-CONCEPTUELS SUR L’EDUCATION
I.1. Définition des concepts-clés sur le développement
1.1.1. Définition d’un programme ou politique publique et la notion de la pauvreté
1.1.2. Un programme ou politique publique
1.2. Développement
1.3. L’éducation
CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA COMMUNE D’AMBOHIMANAMBOLA
II.1. La commune rurale d’Ambohimanambola
1.1. Situation géographique
1.2. Historique de la commune
1.3. Administration de la commune
II.2. Organisation territoriale de la commune étudiée
2.1. Répartition des fokontany
2.2. Caractéristiques sociodémographique
2.3. Espérance de vie de la population d’Ambohimanambola
II.3. Le Programme Tsinjolavitra de l’ONG MMM pour les élèves des EPP
II.3.2. Résultats attendus
3.3. Stratégies d’action par activité de l’ONG MMM
3.3.1. Activités du Programme TL
3.3.2. Les participants de ce programme
3.3.3. Condition d’adhésion au programme « TSINJOLAVITRA »
II.4. Le programme de l’ONG MMM et le programme de soutien financier des EPP (Programme
TSINJOLAVITRA)
4.1. Conceptualisation de l’ONG MMM
4.1.1. Organisation de l’ONG MMM
4.1.2. But et objectifs de l’ONG MMM
4.1.3. Domaine d’interventions de l’ONG
4.2. Adhésion et exclusion
4.2.1. Droits et devoirs des membres
CHAPITRE III: DEMARCHES METHODOLOGIQUES
III.1. Méthodologies et techniques de recherche
III.2. Techniques quantitatives et qualitatives de collectes des données
2.2. Technique documentaire
DEUXIEME PARTIE: L’ADEQUATION DE PRESTATION DE L’ONG MMM ET LES
BESOINS DE LA POPULATION
CHAPITRE IV : L’ENVIRONNEMENT DU PROGRAMME
IV.1. Niveau d’instruction du chef de ménage
1.1. Les problèmes des parents
1.2. Les problèmes des élèves
1.3. Les revenus provenant des familles
IV.2. Les frais de scolarité
CHAPITRE V: LES PROBLEMES DE SCOLARISATION DES ENFANTS
V.1. Identification des facteurs bloquants
V.2. Analyse des causes à effets
V.3. Blocages au niveau des revenus de parents
TROISIEME PARTIE: DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS
VI.1. Les solutions adaptées
1.1. Les solutions aux établissements, ONG et CISCO
1.1.1. Pour les établissements
1.1.2. Pour l’ONG MMM
1.1.3. Pour la CISCO
VI.2. Les solutions des différents intervenants
2.1. Le rôle de la société civile
2.2. Le ministre
2.3. La Société concernée
2.3.1. L’écolier
2.3.2. Les parents
2.3.3. Les enseignantes et enseignants
CHAPITRE VII. RECOMMANDATIONS DU TRAVAILLEUR SOCIAL
VII.1. Pour les élèves
VII.2. Pour les parents
3.1. Augmenter l’offre d’activités parascolaires, sportives et culturelles
3.2. Plus d’activités parascolaires
VII.4. Les acquisitions personnelles et professionnelles du stage
4.2. Les acquisitions professionnelles
CHAPITRE VIII : LES BIEN FAITS DE L’EDUCATION ET LES RESULTATS ATTENDUS
VIII.1. Importance de l’alphabétisation
1.1. Du point de vue de la perception et du comportement
1.2. Sur le plan socioculturel
VIII.2. Perspectives à long terme du projet éducatif
VIII.3. Redressement du système éducatif à Madagascar
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE
ANNEXES
RESUME