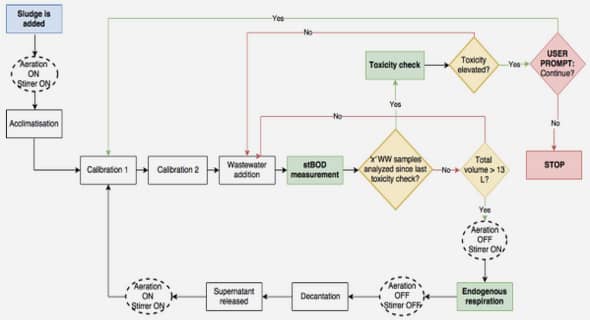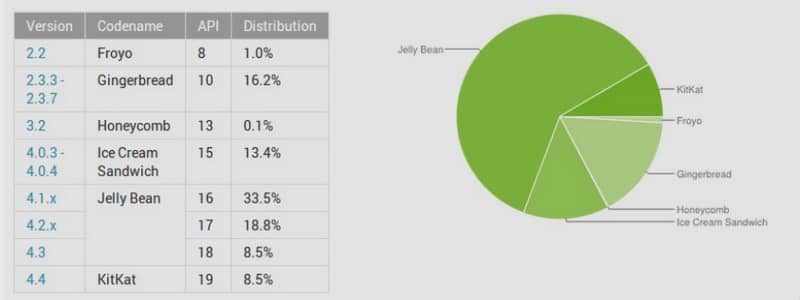MIP
Il arrive que l’identification d’une métaphore soit plus compliquée que ce que nous pourrions penser. C’est pourquoi les membres du groupe de chercheurs « Pragglejaz » (l’anagramme des premières lettres de leurs prénoms) ont mis en place une technique, qu’ils ont baptisée « Metaphor Identification Procedure2 », dans le but de faciliter la tâche d’identification de mots utilisés de façon métaphorique. Il s’agit ici de pouvoir identifier les métaphores linguistiques (dans l’usage) et non les métaphores conceptuelles.
MIP se décompose en 5 étapes de raisonnement (Pragglejaz 2007:3) :
• Lire l’ensemble du discours, du texte afin d’établir un sens global du texte.
• Déterminer les éléments lexicaux dans le texte.
• Pour chaque élément lexical, déterminer son sens contextuel et son sens basique. Il faut noter ici que le sens « basique » ne correspond pas au sens le plus commun mais tend à être le sens le plus concret, le plus précis, ou le sens le plus ancien historiquement.
• Par la suite, on doit décider si le sens contextuel et le sens basique diffèrent l’un de l’autre.
• Si oui, le mot est utilisé de façon métaphorique.
Le premier aspect de l’étude consiste à pouvoir différencier les utilisations métaphoriques et non-métaphoriques d’un mot donné en contexte.
La Procédure d’Identification mise en place par le groupe de chercheurs Pragglejaz va nous faciliter la tâche. Prenons le premier exemple de la base de données Frantext, le 501 : 501 – Des nerfs aboutissant à une moelle épinière et à un cerveau qui remplit la cavité du crâne ; le cœur3 à deux ventricules et le sang chaud. (M474)
◦ Sens contextuel : Ici, « cœur » indique l’organe que possède tout corps animal.
◦ Sens basique : « Partie du corps ou ce qui l’évoque. ORGANE. Organisme central de l’appareil circulatoire. Chez l’homme, viscère musculaire situé entre les poumons et dont la forme est à peu près celle d’une pyramide triangulaire à sommet dirigé vers le bas, en avant et à gauche. » (Le Petit Robert4 2008 « COEUR »)
◦ Sens contextuel vs. Sens basique : Le sens contextuel ne se différencie pas du sens basique.
◦ Usage métaphorique ? Non.
• titre de comparaison, analysons désormais l’exemple 519 du corpus Frantext : 519 – À vingt-cinq ans, il était découragé de la vie ; son esprit jugeait tout d’avance, et sa sensibilité blessée ne goûtait plus les illusions du cœur. (M433)
• Sens contextuel : Ici, « cœur » fait référence au « siège des sentiments » (Robert 2008 « CŒUR »)
• Sens basique : « Partie du corps ou ce qui l’évoque. ORGANE. Organisme central de l’appareil circulatoire. […] » (Robert 2008 « CŒUR »)
• Sens contextuel vs. Sens basique : Le contraste entre le sens basique et le sens contextuel se manifeste par le fait que dans l’un, la définition de cœur est concrète tandis que la seconde décrit le cœur de façon abstraite, comme le siège de l’amour et des passions.
• Usage métaphorique ? Oui.
La théorie de la métaphore conceptuelle
George Lakoff, Mark Johnson et la CMT
La théorie de la métaphore conceptuelle, abrégée CMT5, a été largement diffusée et retravaillée après la publication en 1980 du travail de Lakoff et Johnson. Metaphors we live by a permis à la recherche dans le domaine de la sémantique cognitive de fleurir, ce encore jusqu’à aujourd’hui où des questions sont encore débattues.
La théorie propose, à la différence des idées traditionnelles jusqu’alors acceptées, que les métaphores ne sont pas exclusivement d’ordre décoratif mais qu’au contraire elles jouent un rôle central et indispensable tant dans nos pensées que dans la langue (Deignan 2005:4). Les métaphores sont décrites en termes de domaine source et domaine cible dont les deux éléments constituent une projection conceptuelle (conceptual mapping). Il s’agit donc de projeter des traits d’un domaine conceptuel sur un autre. La description faite par Lakoff et Johnson implique une direction unilatérale, du domaine source (concret) vers le domaine cible (abstrait).
Lakoff et Johnson déclarent que nous vivons avec les métaphores en permanence et que celles-ci dirigent notre façon de penser et de voir le monde6. Ils postulent que le processus même de pensée est en grande partie métaphorique et résument que l’essence même de la métaphore est de comprendre et de faire l’expérience d’une chose avec les termes de quelque chose d’autre »7 (Lakoff & Johnson 2003:5).
L’aspect novateur des « Métaphores dans la vie quotidienne » est de considérer que les métaphores influencent notre façon de penser et notre façon d’agir d’un point de vue cognitif et qu’elles ne se limitent pas seulement à un contexte linguistique. Les métaphores structurent les concepts que nous utilisons chaque jour. C’est l’idée de base développée par Lakoff au cours de ses recherches et qu’il appellera la « cognition incarnée » (embodied mind). Ce concept est à rapprocher de l’hypothèse de Sapir-Whorf qui explique qu’une langue donnée affecte et reflète les actions et les pensées de ses locuteurs. Bien que cette théorie ait été très largement débattue tant en anthropologie qu’en sociologie, elle a vu son intérêt grandir avec les recherches de Lakoff et Johnson.
Lakoff et Johnson expliquent donc que ces concepts sont ceux qui nous font vivre et prennent comme exemple « LA DISCUSSION C’EST LA GUERRE »8 en montrant que la discussion est comprise et pratiquée en termes de guerre. Quelques exemples parents en français seraient : « vos revendications sont indéfendables », « j’ai détruit ses arguments », « Il a attaqué tous les points faibles de mon argumentation ».
Les auteurs argumentent et affirment que ces métaphores conceptuelles sont systématiques et engendrent une sous-catégorisation de concepts. Lakoff et Johnson prennent l’exemple de « LE TEMPS C’EST DE L’ARGENT »9 avec l’équivalent anglais de « tu me fais perdre mon temps », « j’ai investi beaucoup de temps pour elle », « je n’ai pas de temps à vous donner ». Ces exemples peuvent être sous-catégorisés dans cette métaphore conceptuelle en tant que « LE TEMPS EST UNE RESSOURCE LIMITEE » ou encore « LE TEMPS EST UN PRODUIT DE VALEUR ».
Lakoff et Johnson expliquent le principe des métaphores d’orientation qu’ils analysent comme « un système entier de concepts les uns par rapport aux autres »10 (Lakoff & Johnson 2003:14) à la différence des métaphores conceptuelles qui structurent un domaine par rapport à un autre. Ils prennent l’exemple de « HAPPY IS UP » avec les exemples suivants : « He’s really low these days », ou « I fell into depression » ou encore I’m feeling up ».
Les auteurs développent également le cas des métonymies qu’ils définissent comme le fait de conceptualiser une entité au moyen d’une autre entité qui lui est reliée. Ils prennent l’exemple de « Il aime lire le Marquis de Sade » qui en réalité signifie « Il aime lire les écrits du Marquis de Sade »11 (Lakoff & Johnson 2003:35).
Il est ajouté que contrairement aux métaphores qui ont une fonction de compréhension (un domaine dans les termes d’un autre), les métonymies ont d’abord une fonction référentielle, c’est-à-dire qu’elles permettent d’utiliser une entité pour en représenter une autre. Les métonymies permettent de mettre l’accent sur certains aspects spécifiques de ce qui est représenté. Tout comme les métaphores, les métonymies ne sont pas qu’un instrument linguistique avec une fonction décorative mais bien un outil utilisé dans la vie de tous les jours et font part de l’ordinaire quotidien (Lakoff & Johnson 2003:37).
Il est intéressant de noter qu’ici les auteurs affirment que les métonymies (entre autres) forment notre façon de penser et de réagir face à ce qui nous entoure. L’exemple présenté pour illustrer cet argument est « Nixon a bombardé Hanoi » (Lakoff & Johnson 2003:39) qui place celui qui contrôle l’action à la place de l’objet de l’action (ici les bombes) ce qui nous force à penser que c’est Nixon qui a effectué l’action.
Enfin les auteurs arguent que le symbolisme religieux et culturel représente des cas de métonymies. Au sein du christianisme, on peut trouver par exemple « LA COLOMBE POUR LE SAINT-ESPRIT » car dans l’imaginaire occidental, la colombe est considérée comme pure, belle et pacifique. En tant qu’oiseau, son habitat naturel est le ciel, là où réside le Saint-Esprit. Le système de concepts culturels et religieux est par nature métaphorique et les métonymies sont des liens entre les expériences quotidiennes et ce système métaphorique que constituent les concepts religieux et culturels.
Recherches postérieures
Comme précédemment annoncé, la recherche en linguistique cognitive sur les métaphores et les métonymies a fleurie grâce au travail de Lakoff et Johnson. Étant l’une des premières théories développées en linguistique cognitive, c’est celle qui est encore la plus discutée.
Kövecses (2010) donne une lecture claire et instructive sur les métaphores ainsi que des explications sur des principes fondamentaux de la CMT tels que « domaine source » et « domaine cible ». Il développe également son propos avec une série d’exercices ainsi qu’un éclaircissement sur la question des métonymies. Dans la même lignée, Evans et Green (2006:286-327) expliquent de façon succincte ce que sont les métaphores et les métonymies et développent la théorie de la CMT.
Deignan (2005) apporte quant à elle un regard pertinent pour cette étude. En effet, en plus d’apporter une définition claire et concise de la CMT ainsi que des métonymies, elle soulève des questions essentielles quant à l’application des théories en linguistique cognitive aux études basées sur des corpus de textes.
Il est également intéressant pour cette étude de se concentrer sur les limites de la CMT. Haser (2005) argumente au sujet des fondements philosophiques de la CMT qu’il trouve branlants et que la théorie elle-même, dans certains domaines, n’est pas convaincante. Stern (2000), quant à lui, se concentre sur le manque d’attention apportée par la théorie sur la nature contextuelle de la métaphore. Enfin Kövceses (2008) apporte des propositions alternatives pour améliorer la CMT. Dirven et Pörings (2003) ainsi que Barcelona (2003) sont également pertinents pour l’étude de par leurs comparaisons entre métaphores et les métonymies. Leurs travaux développent des questionnements sur la frontière entre métaphores et métonymies et sur les interactions qui peuvent exister entre elles.
En ce qui concerne la recherche francophone, mentionnons le travail doctoral de Gréa (2001:61-72) où il développe une explication concise de la théorie de la métaphore conceptuelle. Dilks (2009) consacre également un chapitre à la description succincte des différentes approches théoriques. Keromnes (2013) apporte un regard pertinent pour cette étude quant aux traductions françaises et allemandes des métaphores conceptuelles présentes dans l’œuvre de Lakoff et Johnson.