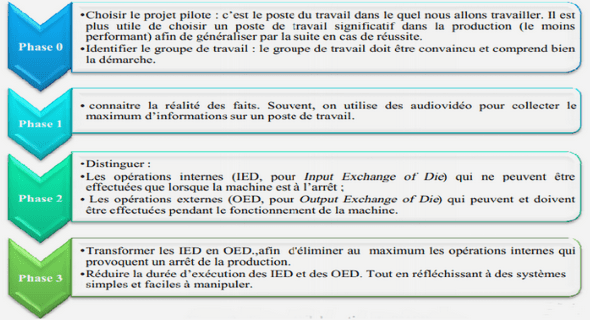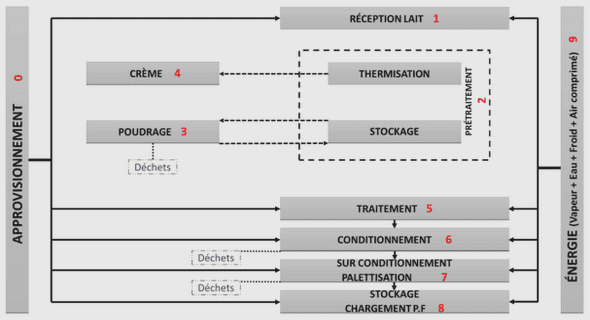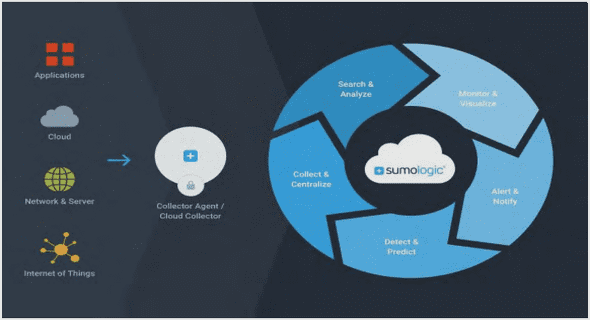Recherches précédentes
Cette rétrospective s’avérera brève dû au fait que les didacticiens suédois qui ont montré de l’intérêt pour les langues modernes jusqu’ici, incluant le français, semblent être préoccupés par de tout autres sujets que la phonétique, à en juger par un aperçu de la recherche contemporaine en matière de la didactique des langues3. De ce fait, les travaux de recherches sur le rôle, les effets et les fonctions de la phonétique dans l’enseignement du français en Suède se font très rares, mise à part la thèse pour le doctorat de Monika Stridfeldt, portant sur la perception du français oral spontané par des étudiants suédois. Faudrait-il alors en conclure qu’il n’existe pas là une problématique digne d’intérêt en ce qui concerne l’emploi plus ou moins systématique de la phonétique comme outil de travail dans l’enseignement de langues modernes au lycée suédois ?
But
Le but de la présente étude est de problématiser le rôle de la phonétique comme outil de travail dans l’enseignement de langues modernes au lycée suédois. Dans une première section, une thèse pour le doctorat portant sur la perception du français oral spontané par des étudiants suédois sera confrontée aux recommandations de Skolverket aux professeurs de langues quant à la mise en application des programmes scolaires actuels pour les langues modernes. Dans une seconde section, l’étude portera sur l’éventuel contenu proprement phonétique d’un nombre choisi de manuels scolaires de français destinés aux lycéens suédois. Les questions sur lesquelles cette analyse se fonde sont les suivantes:
• Y a-t-il des extraits explicites de phonétique dans le manuel scolaire et si oui, lesquels?
• À quelle fréquence se présentent-ils?
• Quel est l’aspect de leur présentation?
• Les segments présentés s’avèrent-ils importants ou limités (grands ou petits)?
• Les segments sont-ils reliés aux exercices de production orale et de compréhension du chapitre ou de la section du manuel en question?
Méthode
En ce qui concerne la première section de l’étude, la méthode de travail consiste à rendre compte du contenu essentiel d’un certain nombre d’ouvrages choisis et de les analyser à l’égard de la phonétique comme outil de travail pour l’enseignement de langues.
La méthode choisie pour réaliser la seconde section, est une analyse qualitative de sept manuels scolaires et qui est basée sur des critères établis au préalable.
Les résultats seront rassemblés de façon structurée pour donner une vue d’ensemble comme base pour une discussion ultérieure.
Choix du matériel d’étude
La thèse pour le doctorat de Stridfeldt4 est la seule étude universitaire récente à examiner la perception du français parlé par des étudiants suédois. Alors qu’elle n’adopte pas une perspective didactique, elle a été sélectionnée parce qu’elle touche directement au sujet du présent mémoire. Du fait que Språkboken 5 est une anthologie de didactique incitée par Skolverket et désormais distribuée par elle, il y a de bonnes raisons pour considérer cet ouvrage comme l’expression de la conception officielle suédoise de l’enseignement de langues modernes, d’autant plus que l’intention derrière cet ouvrage était d’aider les enseignants à comprendre et à effectuer les cursus de l’an 2000. Språkdidaktik de Tornberg6, comporte une présentation détaillée des principes didactiques qui se reflètent dans l’anthologie en question.
En matière de phonétique, l’auteure fera par ailleurs appel entre autres à Trubetzkoy7. Vu le cadre restreint de ce mémoire, la seconde section se limitera quantitativement aux manuels scolaires destinés au Niveau 1 de l’apprentissage de la langue française au lycée, c’est-à-dire le premier manuel dans le cas d’une série, utilisés au moment où l’étude s’est réalisée. Seront analysés les extraits qui, de façon explicite, ont trait aux éléments de phonétique, par exemple sous forme de transcriptions phonétiques et des descriptions de l’intonation. D’autre part, toujours afin de limiter l’étendue de l’étude mais de façon qualitative cette fois, il a été décidé de ne pas tenir compte des livrets d’exercices à part, du matériel audio ou des manuels de l’enseignant.
Les manuels choisis sont les suivants : l’auteure se réfèrera à la définition traditionnelle citée par Elisabeth Tegelberg8 dans Franskt uttal i teori och praktik c’est-à-dire « la science du son de laquelle on peut tirer des règles de prononciation ». Le phonème pour sa part se définit comme étant « la plus petite unité du langage parlé dont la fonction est de constituer les signifiants et de les distinguer entre eux9 ». Le graphème par ailleurs est « la plus petite unité distinctive et significative de l’écriture10 ». La définition linguistique de la prosodie se lit comme suit : « Étude de l’accent et de la durée des phonèmes11 ».
La liaison se produit lorsqu’une consonne muette finale se réalise au contact d’un mot commençant par un phonème vocalique, dans un groupe de mots. L’enchaînement (consonantique) de son côté se produit lorsque la consonne finale ou groupe de consonnes finales d’un mot, toujours prononcée(s), s’enchaîne avec le mot suivant si celui-ci commence par une voyelle ou un ‘h’ vocalique de sorte à ouvrir la syllabe qu’elle fermait dans le mot isolé12. L’assimilation quant à elle se réalise quand un phonème est modifié sous l’influence d’un autre phonème situé à proximité qui réduit les différences entre les deux13. Un autre phénomène, l’élision, se définit comme étant l’effacement d’une voyelle finale devant une voyelle ou élément vocalique initial14.
Par apprentissage intuitif on entend l’apprentissage qui « ne recourt pas au raisonnement 15 ». Les voyelles nasales et les voyelles orales sont deux types de phonèmes et la nasalisation est une caractéristique qui différencie les voyelles orales des voyelles nasales16. Finalement, on peut définir les termes phénomènes suprasegmentaux par des phénomènes qui dépassent la longueur d’un segment17.
Problématisation
L’étude de Stridfeldt
Dans sa thèse intitulée La perception du français oral par des apprenants suédois, Monika Stridfeldt, rend compte dans un premier temps de la phonologie du suédois standard et de celle du français de France standard ainsi que des difficultés particulières pour les apprenants svécophones. Ce faisant, elle confirme les résultats d’un prédécesseur, Stöök dans les années 1960. Depuis, dit-elle, il n’y a pas eu d’autres travaux en Suède sur le même sujet jusqu’à la sienne18.
Quoique pas explicitement d’orientation didactique, cette thèse offre dans un deuxième temps une description plutôt alarmante du niveau des jeunes apprenants en démontrant les difficultés qu’ils éprouvent à percevoir du français parlé de façon spontanée. En outre, Stridfeldt émet un certain nombre de caractéristiques de la phonologie française dont ses informateurs semblaient ignorer l’existence. On peut mentionner notamment l’assimilation sonore, l’enchaînement consonantique ainsi que la non-reconnaissance de petits mots grammaticaux avec lesquels ils sont en fait très familiers, puisqu’ils connaissent très bien leur forme canonique, c’est-à-dire leur forme écrite depuis le tout-début de leur apprentissage de la langue19.
Dans un troisième temps, Stridfeldt indique dans son étude que le manque de connaissances en ce qui concerne la relation graphème-phonème de ses sujets a été une source d’erreurs importante dans son analyse. en juger par l’étude en question, il existe donc une problématique qui concerne la perception par des étudiants du français parlé et, en corollaire, leur propre prononciation de la langue d’apprentissage, étant donné que celle-ci dépend de celle-là.
Monika Stridfeldt20 discute en fait de cette problématique. La difficulté, selon elle, réside entre autres dans « un autre système de jointures, de marquage des frontières que celui auquel on est habitué dans la langue écrite, ce qui peut compliquer la compréhension orale. Un très faible pourcentage de limites de mots ou morphèmes sont en effet signalés dans un texte.»21 Conséquemment, ne pas sensibiliser les apprenants à ces « jointures » rend très difficile leur compréhension et leur production orale.
On sait la peine qu’a un nouvel élève à comprendre les mots qu’il a appris isolément dès qu’ils sont réunis dans une phrase22 ». Les concepts particulièrement intéressants à cet égard sont l’élision, la liaison et l’enchaînement, des phénomènes qui n’existent pas en suédois. De ce fait, on est en droit de penser qu’il faudrait les intégrer sciemment dans l’enseignement du français, pour que les apprenants les aperçoivent. Par ailleurs, il est normal que les phonèmes individuels soient influencés par leur environnement. Par conséquent, une question cruciale de méthode pour l’enseignant devrait être celle de savoir comment introduire dans l’enseignement des segments auditifs qui dépassent un phonème et un mot isolé.
Il ne faut pas oublier non plus que la prosodie et l’intonation peuvent être, tout aussi pertinentes pour la compréhension qu’elles ne le sont pour la production orale23. Ce fait souligne l’importance qu’il y a à considérer des segments assez longs lors des exercices de perception orale.
Ce qui a été évoqué fournit des exemples d’aspects phonologiques dont on peut penser que l’enseignant devrait tenir compte. Stridfeldt suggère justement dans sa conclusion que certains éléments de phonétique précis devraient être introduits à l’école.
La conception didactique derrière les cursus des langues modernes
Au cours de la dernière décennie, l’expression orale a pris de l’importance et s’est vue attribuée une place dominante dans les programmes de langues modernes dans les écoles suédoises. Dans le programme d’enseignement des langues modernes au lycée, édition 2000, on réaffirme explicitement l’importance d’une bonne prononciation, d’une bonne compréhension orale ainsi que d’une connaissance de la phonologie de la langue en question24. On y recommande de conscientiser les élèves à la façon dont leur propre apprentissage se produit et de leur apprendre à utiliser les outils disponibles de façon autonome.
On se serait donc attendu à ce que la voix officielle de l’enseignement scolaire en Suède, Skolverket , fasse mention de ce sujet dans la publication incitée et publiée par eux, Språkboken. Cette publication qui avait pour but d’indiquer aux enseignants comment rendre concrètes les intentions sur lesquelles était basé le cursus. Paradoxalement, aucun des chapitres ne traite cependant ni de production orale ni de phonétique en tant que sources de développement de méthodes pour améliorer la perception de la langue parlée et la production orale des élèves. On commente brièvement l’importance de la relation entre les règles de graphie et la phonologie dans l’apprentissage de la langue anglaise, mais ne fait pas mention de l’importance de procéder à des exercices de production orale et de prosodie dans l’enseignement des langues.
Dans la mesure où la phonétique est sujette à discussion, c’est uniquement en tant qu’outil de compréhension interculturelle dans les salles de classes et non en tant qu’outil de support dans l’apprentissage de la prononciation et de la prosodie de la langue en question. Cela ne revient pas à dire que l’ouvrage en question est contre la phonétique ; il passe seulement sous silence les éventuelles raisons qui pourraient justifier son emploi systématique dans l’enseignement des langues. Et pourtant, les deux co-auteurs qui représentent des langues romanes, Ulla Håkansson (l’espagnol) et Ingvor Sundell (le français) expriment leurs soucis justement pour la perception et la production orales de leurs élèves.
Du fait qu’il évite toute discussion du genre de questions que traite Stridfeldt, Språkboken donne l’impression que la seule méthode stratégique d’apprentissage nécessaire est la méthode directe, c’est-à-dire l’apprentissage intuitif de la phonologie et de la prosodie de la langue en question. Ceci est corroboré par le fait que l’auteur représentant la langue française (Ingvor Sundell)25 recommande avant tout l’écoute en classe et à la maison du français authentique et que l’enseignant utilise le français en classe.
Théories d’acquisition d’une langue et intuition
En confrontant la thèse de Stridfeldt au contenu de Språkboken, force est de constater que l’enseignement du français dans les lycées suédois se heurte à une problématique en tant que le paysage sonore de la langue française est clairement difficile à maîtriser et que l’autorité responsable du système scolaire ne semble avoir rien d’autre à recommander aux enseignants que la méthode directe, c’est-à-dire des contacts nombreux avec du français parlé. Cependant, très peu d’évidence scientifique soutient une telle conception de l’apprentissage des langues étrangères après la première enfance.
Par contre, bien des études semblent aller dans le même sens que l’hypothèse de la soi-disante période critique. Introduite par Lenneberg en 196726, celle-ci stipule qu’il existe une période spécifique d’une durée limitée et qui serait critique pour l’acquisition d’une langue. Cette hypothèse a été par la suite maintes fois adaptée à des études de l’apprentissage d’une langue seconde, entre autre par David Singleton27 qui affirme que younger = better in the long run » (plus jeune = meilleur à la longue) dans l’apprentissage d’une langue seconde.
Dans une autre ligne de pensée, d’autres chercheurs affirment que certains aspects de l’apprentissage sont affectés moins que d’autres par la période critique, tel que le vocabulaire par exemple28. Qui plus est, une catégorie de chercheurs va jusqu’à mettre en cause toute la notion de période critique29. En effet, comme Robertson l’a observé, d’autres facteurs que l’âge pourraient avoir une signification plus importante dans l’apprentissage d’une langue seconde. Il mentionne entre autres la motivation personnelle, l’anxiété, le temps investi et les conditions d’apprentissage30.
Finalement, on pourrait peut-être conclure comme Bialystok et Hakuta31 que l’apprentissage n’est pas nécessairement directement lié à une période précise mais que l’habilité d’apprendre diminue avec l’âge32»et que c’est «la correspondance entre les structures du langage de la première et de la seconde langue qui constitue le facteur le plus important dans l’acquisition de cette langue33». C’est justement sur cette dernière ligne de pensée que déjà dans les années 1930 Trubetzkoy propose le L1 comme filtre ou champ magnétique affectant la perception de L2, une idée qui s’est vue adoptée par bien des phonéticiens par la suite. Selon la métaphore en question, les catégories phonétiques d’une langue maternelle forment un filtre » à travers lequel les unités phonétiques de L2 doivent passer34. De cela découlerait par exemple un phénomène bien connu des apprenants d’une langue seconde, c’est à dire le fait d’avoir de la difficulté à distinguer certaines paires de phonèmes parce qu’ils sont associés à une catégorie de phonèmes de la langue maternelle.
Cela dit, on trouve, sans doute aussi, ceux qui croient que l’intuition serait l’outil le plus efficace d’acquisition d’une langue et qu’elle suffirait pour apprendre une langue étrangère. Cependant, en général, les phonéticiens tels que Markham semblent penser que seule une petite minorité des adolescents et adultes préservent leur capacité d’assimiler tout naturellement la structure phonologique du petit enfant (certains chercheurs ont proposé un chiffre entre 5 et 7.6%)35.