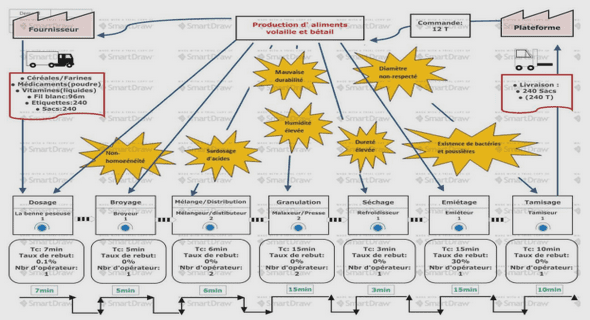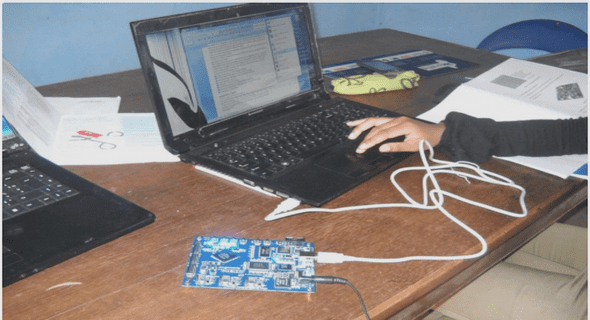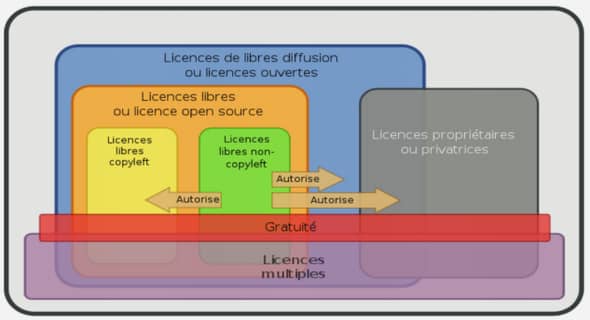Approche des circulations révolutionnaires anarchistes
REVOLUTION ET ETAT-NATION
La question révolutionnaire est largement abordée dans le champ disciplinaire de la sociologie, et malgré des désaccords de modèles, l’Etat reste le cadre des études révolutionnaires par excellence, les autres n’étant pas jugés pertinents. Prenons l’exemple de Theda Skocpol et son ouvrage Etats et Révolution sociale, la Révolution en France, en Russie et en Chine paru en 1985, dans lequel l’exclusivité du terme révolution et des changements structurels sont accordés aux transformations étatiques.
L’auteur indique en effet que les révolutions sociales « transforment rapidement et fondamentalement les structures étatiques et de classes d’une société, elles s’accompagnent et elles s’accomplissent en partie par le bas par des révoltes de classes. […] en revanche, même réussies, les rébellions – qui peuvent se traduire par une révolte des classes de dominés – n’aboutissent pas à un changement structurel ».
Pourtant, la simple redistribution des terres effectuée par les mouvements paysans et les anarchistes est un changement structurel, mais Skocpol fait comme si les anarchistes n’existaient pas. La suite est révélatrice, puisque l’auteure démontre que les libéraux et les marxistes considèrent l’Etat comme l’arène politique au centre de la question révolutionnaire. D’un côté, les libéraux admettent que les révolutions sociales commencent par une crise ouvertement politique, institutionnelle, et aboutissent à la consolidation de nouveaux organes d’Etat. Quant aux marxistes, ils considèrent l’Etat comme le lieu coercitif garant de la domination des groupes politiques ou des classes dominantes. Dans ces deux écoles d’analyse, le fait révolutionnaire est inhérent à l’Etat. Les modèles créés sont extrêmement centralisateurs et excluent par principe tout ce qui est hors de l’Etat.
Malgré tout, Skocpol consacre un chapitre entier aux insurrections paysannes, leur attribuant même tout le mérite révolutionnaire nécessaire et fournissant une explication du pourquoi les radicaux urbains obtiennent tout le mérite. Elle affirme en effet que les « travailleurs urbains insurrectionnels se présentent comme de véritables révolutionnaires alors que les paysans se « rebellent » dans les campagnes, loin des centres de décision et de la conscience nationale et politique ».
Jeff Goodwin fait de même et présente quatre types d’analyses étatico-centrées des révolutions. Pourtant, il a lui-même conscience des lacunes de ces analyses lorsqu’il indique que « Pour les analystes des mouvements révolutionnaires (ou de l’action collective sous toutes ses formes), le problème fondamental de l’analyse étatiste est qu’elle ne théorise pas les sources non étatiques ou non politiques de trois facteurs généraux : les réseaux associatifs, les ressources matérielles et les croyances et discours collectifs ».
Cette approche structuraliste, qui se focalise sur l’Etat et passe sous silence ce qui est considéré comme hors de l’Etat, ne peut convenir à l’étude des mouvements anarchistes et autonomistes de l’époque. Si nous abordons ces points, c’est que nous cherchons à proposer une nécessaire déconstruction de l’hégémonie de l’Etat, dans le but de faciliter l’utilisation de l’individualisme méthodologique17 que nous utilisons dans notre thèse. Cette méthodologie est centrée sur l’individu qui vit sa radicalité et la révolution au quotidien, qui la rend réelle par ses actes, ses paroles, ses mobilités. Et qui permet aussi de prendre en compte le quotidien des personnes qui rencontrent la révolution, temporairement ou définitivement sans être pour autant militant, et c’est aussi leur quotidien qui fait révolution.
Un certain nombre d’ouvrages aborde les radicaux qui ont œuvré au Mexique et aux EUA dans les années 1900s-1910s, et leurs différentes organisations sont étudiées qu’il s’agisse du Partido Liberal Mexicano (PLM), des Industrial Workers of the World (IWW), des anarchistes, etc. Souvent aussi sont évoquées leurs origines (Catalogne, Europe, etc.) mais cette description des circulations est limitée à une date d’arrivée dans un port ou à une petite liste d’auteurs marquants. De la même manière les contacts internationalistes sont traités en aval de ces différentes organisations, ce qui nous permet d’apprendre que le PLM est en contact avec l’IWW et vice-versa, qu’ils sont actifs dans les mêmes zones géographiques, mais leurs collaborations ne sont là aussi qu’évoquées.
Il existe toutefois quelques exceptions notables, comme La Revolucion sin Frontera18 de Javier Torres Parés qui comporte trois chapitres complets à propos des relations entre le Partido Liberal Mexicano et les différentes organisations étasuniennes, comme le courant anarchiste étasunien, le Socialist Party of America, le groupe autour d’Emma Goldman ou encore les Industrial Workers of the World. Mais le contenu de ces chapitres est traité en surface et laisse rapidement la place à la mise en évidence des différences et d’une forme de leadership de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano (JOPLM), mettant quelque peu la collaboration de côté.
De plus, cet ouvrage contient une certaine héroïsation des membres de la JOPLM, principalement des frères Flores Magon qui restent les acteurs principaux de ce travail. Il rejoint sur ce point un autre travail intéressant sur les activités des anarchistes mexicains aux Etats-Unis d’Amérique, à savoir The Return of Comrade Ricardo Flores Magon19 de Claudio Lomnitz qui lui aussi fait une très grande part aux principales figures du mouvement.
Mais nous devons bien admettre que nous aussi leur donnons une place trop importante, ce qui est dû à de nombreux paramètres, le premier étant les sources disponibles.
DU COMPARATIF AUX INDIVIDUS
Lors de notre master recherche, nous avons questionné les révolutions russes et mexicaines avec une approche comparatiste, ce qui nous a permis de mettre au jour des similitudes significatives entre certaines factions ayant des objectifs similaires tout en participants à des révolutions différentes. Nous avions ainsi pu émettre l’hypothèse de circulations révolutionnaires transnationales entre ces deux pays et en amont de ces révolutions, même si nous avions constaté les limites de cette démarche, qui sont par ailleurs expliquées par l’historien Pierre-Yves Saulnier lorsqu’il indique que « La démarche comparative elle-même se love dans le cadre des Etats-Nations et se développe souvent à partir de l’un d’entre eux vers d’autres. Ainsi elle aboutit au renforcement de la cellule d’observation de base – les Etats-nations ».
Un autre point important que nous voulons prendre en compte et que pose Michel Dobry dans son ouvrage Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, est que si nous adoptons la démarche des théoriciens de la révolution, qu’il appelle « l’illusion de l’Histoire Naturelle » et qui consiste à appliquer une méthodologie à rebours, nous courons le risque de ne pas pouvoir capter les situations semblables à celles étudiées mais qui auraient eu une fin différente.
Et c’est ce que nous avons fait dans notre travail de mémoire, probablement par « naïveté » comme le dit M. Dobry, en nous limitant à dégager des similitudes en partant d’un cadre limité à deux révolutions, la mexicaine et la russe, mises sur un pied d’égalité. Et c’est en effectuant ce travail de synthèse et en observant les points communs qui s’en dégageaient que nous avions pu remonter la chronologie des révolutions ainsi que la vie des acteurs et émettre l’hypothèse de l’existence d’une connexion transcontinentale anarchiste et autonomiste entre ces deux pays. La volonté de les mettre sur un pied d’égalité est un point essentiel qui nous a permis d’éviter l’écueil d’une relation asymétrique et de prendre de la distance avec nos idées initiales.
C’est dans ce sens que nous avons décidé d’approfondir notre hypothèse et de désenclaver notre sujet en changeant de perspective et en adoptant une approche plus large des circulations révolutionnaires anarchistes. Mais cette nouvelle approche ne peut pas se limiter un simple passage d’une histoire comparative vers une histoire transnationale. Nous avons voulu aller au bout de la remise en question des grilles de lecture traditionnelles des révolutions en partant cette fois du point de vue des acteurs avec pour nouvelle hypothèse que nous n’étudions qu’un front d’une révolution autonomiste mondiale.
Mais qu’entendons-nous par « autonomiste » ? Comme les courants politiques favorables à l’Etat-nation, ceux qui s’y opposent sont très divers et ce serait une erreur de les limiter aux militants anarchistes les plus radicaux. Prenons l’exemple d’Emiliano Zapata. Est-il anarchiste ? Ce que nous savons c’est qu’il est entouré d’anarchistes, mais pas que ; c’est qu’il a des idées compatibles avec l’anarchisme, plus qu’avec l’Etat-nation et que sa pratique est anarchiste tant il répartit les terres. Pourtant, nous ne pensons pas qu’il soit anarchiste de la même manière que Ricardo Flores Magón par exemple, bien qu’ils soient tous deux dans le même camp, celui de l’autonomie. La révolution autonomiste comprend ainsi différents courants, comme les anarchistes, les peuples indigènes dépossédés, les travailleurs qui veulent le contrôle de leurs moyens de production. Tous ces courants ne se revendiquent pas forcément de l’anarchisme, mais ils relèvent de l’anarchisme en œuvrant pour leur liberté économique et leur liberté politique..
Nous le voyons bien dans les révolutions mexicaine et russe, la revendication principale des populations majoritairement rurales était la répartition des terres, que ce soit pour la possession individuelle ou collective directe. C’est ce que proposaient les anarchistes, mais c’est aussi ce que n’ont résolu aucune des deux révolutions victorieuses. Mais nous l’observons aussi dans des régions d’intensité révolutionnaire plus mesurée, comme aux Etats-Unis d’Amérique par exemple..
C’est pourquoi nous nous efforcerons dans un premier temps de remettre en question le cadre de l’Etat-nation et ce qui en découle, comme les questions de vocabulaire, mais surtout de géographie et de chronologie. En d’autres termes, nommer, situer et dater sont des actes confisqués par les Etats-nations et l’historiographie officielle afin de rythmer l’intégration de la révolution à leurs romans nationaux. Ils ont accompagné leur démarche par la personnification des mouvements politiques et révolutionnaires, ce qui a donné naissance à des personnages mythiques, héroïques, qu’ils ont inséré dans leur histoire après les avoir vaincus. Citons-en trois : Emiliano Zapata et Francisco Villa, tous deux assassinés par le gouvernement mexicain ; Ricardo Flores Magón retrouvé pendu dans une cellule aux Etats-Unis d’Amérique alors qu’il était très malade.
Cette personnification convient parfois aussi aux anarchistes qui même s’ils prétendent ne pas avoir d’idoles, utilisent leurs réputations individuelles et se servent de la répression pour faire de la propagande sur leurs martyrs. Même si la mise en avant des martyrs est critiquée par Lucy Parsons24, dont le compagnon Albert Parsons est l’un des orateurs anarchistes exécutés par la justice étasunienne après les événements de Haymarket à Chicago en 1886, le mouvement laisse une grande place à l’idée de martyr dans ses rangs comme nous pouvons le constater dans la profusion d’hommages posthumes aux héros tombés ou tout simplement à travers l’exemple d’Emma Goldman qui a en grande partie rejoint la lutte, parce qu’ébranlée par ces exécutions25. Ce que documente très bien par ailleurs R. Melgar Bao dans son article « El martirologio en el imaginario anarquista mexicano: el PLM y la revista Regeneración »..
La tradition historiographique anarchiste a dès le début abordé l’histoire par en bas, à travers des théoriciens et historiens comme Rudolf Rocker27 qui rejettent le nationalisme, produit de l’Etat-nation, qui nuirait à l’humanité, à sa liberté et à sa créativité28. Ce qui a perduré à travers une production de romans historiques, comme par exemple dans l’ouvrage romanesque de l’anarchiste chrétien russe Tolstoï, Guerre et Paix29. Dans un registre similaire, nous pouvons noter que cette tradition perdure avec par exemple La Mémoire des Vaincus de Michel Ragon30 qui met en scène des personnages de fiction pour illustrer des événements échappant à la méthodologie de l’historiographie traditionnelle. Ainsi, il peut dépeindre la complexité des militants politiques, loin du romantisme révolutionnaire.
Cette histoire par le bas est aussi une histoire du quotidien de la militance et du quotidien de celles et ceux qui les entourent. En effet, c’est à travers les pratiques, les formes de sociabilités, les formes de politisation qu’un mouvement politique prend forme et devient une réalité. Selon Pierre Clastres, « on ne peut pas faire l’économie de la question du bas, c’est-à-dire pourquoi les gens acceptent-ils d’obéir. Si l’on veut réfléchir sérieusement à la question de l’origine de la relation, de pouvoir, à la question de l’origine de l’Etat »31. Cette question nous amène aussi à nous questionner sur « pourquoi les gens refusent-ils d’obéir ? » et c’est exactement le postulat de l’anarchisme, poser la question de la légitimité de l’autorité..
Par ailleurs, afin de mieux comprendre nos acteurs, nous avons aussi fait le choix de ne pas traduire les citations. En effet, même si nous comprenons plusieurs langues, nous n’avons pas la capacité nécessaire pour conserver les textes dans leur sens propre, avec leurs erreurs et leurs expressions particulières. Nous rejoignons ici ce que dit l’historienne argentine Hilda Sabato lorsqu’elle parle de la valeur historique de l’écriture originale et observe que « ces particularités de l’écriture présentent une indéniable valeur historique et permettent dans le même temps de lire la diversité sociale et culturelle des acteurs concernés et l’urgence qui caractérisaient généralement les échanges au cours de la période analysée »..