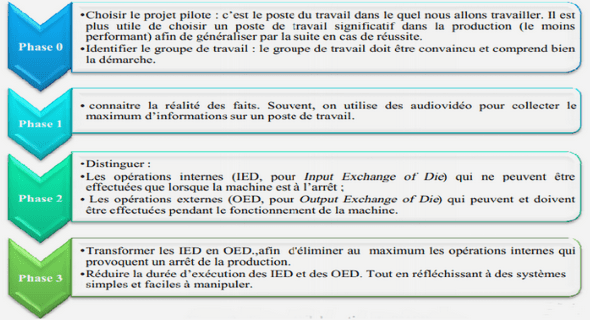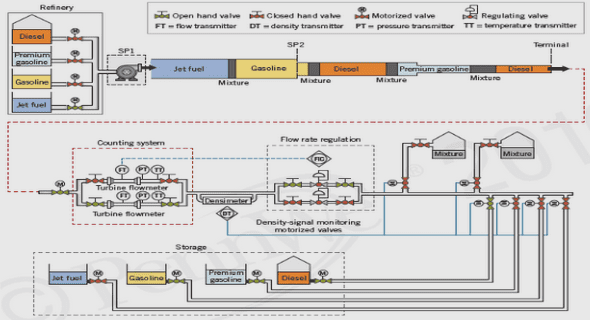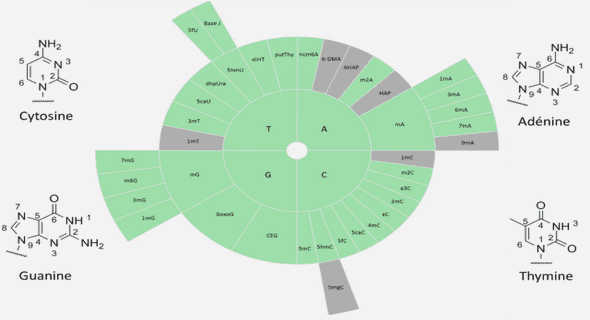Idéal et autorité en question dans quelques communes urbaines
Il est difficile de trouver la trace des communes urbaines. Une commune agricole est une entreprise et à ce titre elle entretient des rapports avec l’État. Par contre si quelques particuliers décident de vivre ensemble dans une maison ou un appartement, l’affaire reste étroitement privée et ne donne lieu à aucune production d’archives. De ce point de vue la consultation des matériaux des services communaux et des coopératives de logement a été invariablement décevante. En l’absence de projets lourds visant à créer des logements collectivistes, ces institutions gèrent le parc locatif comme n’importe quelle municipalité ou bailleur. Certes, régime soviétique oblige, les responsables parlent dans les réunions de l’action sociale autonome mobilisée (…) sous la forme du mouvement coopératif <mobilizovannaâ obŝestvennaâ samodeâtelnost’ (…) v forme žiliŝnoj kooperacii> », et de « la lutte de la classe ouvrière pour son logement [comme étant] la base du nouveau mode de vie »1.
Le quotidien est beaucoup plus prosaïque. Il faut déjà mettre fin aux chamailleries (skloki) et réduire au silence ceux dont elles sont le violon d’Ingres <skločniki-lûbiteli>. Ostap Vychnia, l’humoriste vedette de l’époque, n’avait-il pas donné le sous-titre de Tragédie à une saynète décrivant la mésentente au sein d’une coopérative de logement1 ? La crise du logement structurelle depuis les guerres explique largement la difficulté à vivre ensemble. Au milieu des années vingt en Ukraine, il manque officiellement des habitations pour un million de personnes. À Kharkov, la capitale, la population a augmenté de 30 % entre 1914 et 1923 alors que la surface habitable a diminué de 30 % : le ratio par personne a été divisé par deux. Dans ces conditions, un responsable municipal pense qu’il ne faut pas gaspiller de la surface pour créer dans les immeubles un coin rouge destiné aux expositions d’instruction politique. Louable intention, même si quelqu’un remarque que cela revient à priver les femmes au foyer de leur seule ouverture sur la vie sociale… L’activité culturelle se réduit alors à l’incantation, rituelle, sur « la collectivisation du mode de vie des travailleurs de la coopérative »2.
Ces lourdes contraintes matérielles expliquent sans doute la totale absence d’indices concernant des communes spécifiquement ouvrières. Étudiant les changements du mode de vie des ouvriers sibériens au moment de l’industrialisation », un historien demande en titre : « Commune ou appartement communautaire ? » (Kommouna ili kommounalka ?)3. La question vaut en Ukraine, dès les années vingt. Les foyers de travailleurs migrants, appelés sans honte casernes [kazarmy] en russe, connaissent un collectivisme de fait. Sans parler des problèmes de promiscuité et d’hygiène, il semble que les regroupements s’y fassent entre « pays », de façon archaïque et rurale. Appeler cela commune, comme le fait un agitateur de la côté des taudis il existe également des cités ouvrières inspirées des modèles hygiénistes et/ou socialistes occidentaux de cités-jardins. Or, qu’elles datent d’avant la révolution ou qu’elles soient de construction soviétique, ces cités ouvrières semblent plus être le royaume de la discorde que la république de l’utopie. Interviewé en 1926 dans Kommounarka Oukraïny, le responsable d’un lotissement d’immeubles récents près de l’usine VEK1 de Kharkov est assez pessimiste. Il montre l’entassement persistant (jusqu’à trois familles par appartement), les brouilles à cause de la cuisine, des arbres fruitiers et du bétail domestique. Il pointe l’alcoolisme et la violence conjugale de certains maris, alors qu’un autre résidant accuse au contraire les femmes d’être à l’origine des zizanies. En tout cas, la conclusion est claire : « les lois sont nouvelles mais le sang est resté mauvais »… Les documents internes de la Colonie de l’Usine de locomotives (KhPZ ; voir sur les plans c6 et c7, en annexe) confirment l’article de presse. Par manque de moyen, aucun entretien n’a été effectué entre 1910 et 1925. L’usine chipote sur la fourniture en eau et électricité ainsi que sur les réparations de la voirie. Les relations entre résidants s’enveniment à cause des cochons apportés par les uns ou des pigeons et chèvres des autres. Des chiens errants complètent le zoo2.
D’après ces sources, les ouvriers en tant que groupe social semblent subir la transition entre deux modes de vie. Marqués par des attaches rurales que la guerre civile et la gêne ont réactivées, ils sont physiquement à l’étroit en ville, toujours entassés, en foyers-casernes, en taudis ou en cités. Cette insatisfaction avait nourri la contestation révolutionnaire. Il n’est par contre pas sûr qu’elle a favorisé ultérieurement l’expérimentation collectiviste. En effet, le partage de l’espace n’est pas choisi et il cumule les pires inconvénients. L’ouvrier vit sous le regard des autres comme au village mais il n’a plus de liens familiaux larges et protecteurs. Il évolue dans un environnement mobilier et immobilier modelé pour la famille « bourgeoise » nucléaire1 alors qu’il n’a pas les moyens de s’y retrancher. Pas de lieu collectif non plus : le club ouvrier peut être à l’origine d’une « sociabilité prolétarienne », mais il est séparé de l’atelier comme du foyer. Il attire surtout les jeunes et guère les familles ; il est peu accessible aux épouses qui ne travaillent pas2. Les ouvrier(e)s n’ont pas l’équivalent du domaine confisqué, pas de lieu unique de vie, de travail et de loisir où faire sécession. En résumé, la kommounalka empêche la kommouna3.
Parmi les quatre types de communes urbaines, pas de phalanstère uniquement prolétarien donc. L’absence des ouvriers paraît évidente dans les communes d’artistes. Par contre, les classes pauvres réapparaissent dans les autres types de collectifs. Nous verrons une commune pédagogique qui vise un public défavorisé. Et, en passant en revue les collectifs de jeunes militants et d’étudiants, n’oublions pas qu’il s’agit souvent de travailleurs s’étant mis à la distance nécessaire de leur milieu d’origine grâce à une nouvelle raison sociale : activiste de la JC, auditeur inscrit en faculté.
Les indices de l’existence de ces quelques communes ont été le plus souvent trouvés dans la presse4 ou grâce à un témoignage. Des tentatives de recoupement dans des sources administratives ont parfois été couronnées de succès. Les informations sont malgré tout peu nombreuses : le phénomène n’est lui-même pas massif. Cependant, conformément à la méthode choisie, il me semble que ces micro-expériences porteront un éclairage singulier sur la société soviétique en construction.
DES COMMUNES DE MILITANTS : UNE JEUNE ARISTOCRATIE, DÉMORALISÉE
En mai 1922, Zori griadouchtchego (L’Aurore de l’avenir), la revue de la Culture prolétarienne (ProletKul’t) Ukrainienne, consacre ses 30 premières pages à une nouvelle. Sous la signature de V. Strelnikova, elle s’intitule La deuxième maison des soviets. « Je dédie ceci – mi-rêve, mi-réalité – l’organisation des Jeunes communistes de Kharkov. 1.
Evidemment… cela viendra… Viendra le temps du front de la culture quand s’éloigneront les jours d’efforts pour édifier notre économie ; ainsi se sont déjà éloignés les temps de guerre civile. Nous avons langui dans l’attente d’un mode de vie communiste, de relations de camaraderie, de sentiments collectifs… Mais viendront un nouvel art, une nouvelle littérature — les nôtres ; et nous construirons une sensation communiste du monde <kommunističeskoe mirooŝuŝenie>. Cela n’existe chez personne ; ce qui existe c’est la lutte pour renforcer le pouvoir prolétarien ; ce qui existe c’est ce pouvoir lui-même, avec ses qualités comme n’importe quel autre pouvoir ».
C’est une jeune fille [qui parle,] près de la fenêtre, au deuxième étage, dans la chambre numéro 5, et sa voix est discrète et mesurée.
– Nous n’avons pas de communistes, dit d’un air sombre un jeune communiste, maigre et nerveux, assis sur un tabouret. Nous avons de bons ou mauvais combattants pour le communisme, mais nous n’avons pas de communistes.
– Tu es encore un petit garçon, Oska, — dit la jeune fille. Et elle pense à ce petit garçon nu-pieds et bronzé qui traînait sur le port d’Odessa, où la mer est verte et où les ponts des navires sentent le goudron.
– J’ai 19 ans, je ne suis pas un petit garçon. Et quand bien même je serais un petit garçon, ce serait tant mieux. Tu crois que les vieux membres du Parti ont quelque chose de plus communiste que nous ? Je t’assure : c’est seulement parmi nous, à la Jeunesse Communiste, que pousse le vrai germe du communisme, dans chaque sentiment, dans chaque désir…
Par contre, les vieux membres du Parti sont des petits-bourgeois <meŝane> qui ont leurs racines et leur âme dans le passé. Tu crois que je ne sais pas que notre maison des Soviets est une des rares, peut-être l’unique ? Et comment les communistes vivent-ils dans les autres maisons des soviets ? Tu crois que si une maison est bondée de communistes il y règne un mode de vie communiste ? Pas de danger !.. Chaque communiste est avec sa femme et son enfant, dans son appartement, comme un escargot. Avec des samovars, des cuisines, des nurses. Il rentre du travail pour se plonger dans les plaisirs familiaux. Et chacune des épouses est une Dame, archi-bourgeoise, bête comme une oie, qui occupe ses journées à cancaner. Et quand elles se brouillent entre elles, on voit leurs maris-communistes marcher dans le couloir pour aller se crier à travers les portes : Pour qui tu te prends ? Et ça fait combien de temps que tu y es, toi, au Parti ? D’où tu sors ? Fils de koulak ou fils d’intello <iz kulakov, ili iz intelâgušek ?> ? Ensuite ils brandissent des mandats et font convoquer leur ennemi à la commission de contrôle du Comité de province. La voilà, la vie !..
La jeune fille a ri très longtemps et très fort. Elle sait que le mode de vie se crée par suite de centaines de tâtonnements, car l’âme est vieille, l’âme a toutes ses racines dans le passé.
Et chez vous, comment vivent-ils, les jeunes communistes ?
Les jeunes communistes sont toujours en commune, à cinq, à six par chambre. Tout est commun : les vêtements, l’argent, la nourriture, les livres, les idées. Tu sais, si tu as faim, si tu n’as nulle part où dormir, tu rentres dans n’importe quel appartement : on te recevra, on te nourrira. Mais essaye seulement, toi, communiste anonyme, de débarquer dans l’appartement [privé] d’un communiste : comme on te regarde de travers !.. »1
Entre privilèges et égalitarisme
Pour mieux suivre la vie de ces quelques jeunes communistes de Kharkov au tournant de la NEP, il faut d’abord tenter de faire la part du rêve et de la réalité dans la prose de Strelnikova. L’existence de maisons des Soviets est largement attestée dans la soviétique (années vingt-trente), explique que l’élite bolchevique créa le ‘‘socialisme dans un seul immeuble’’ selon l’expression judicieuse de l’historien américain R. Stites (…). Des maisons des Soviets fonctionnaient à Petrograd dans les plus grands et les meilleurs hôtels ».
Elle cite une lettre de l’organisme qui les gère :
Les maisons des soviets ont la structure d’un foyer <obŝežitie> avec des chambres séparées, un réfectoire commun et des cuisines communes ; elles sont destinées exclusivement à l’hébergement permanent des employés soviétiques selon les décisions de la Section de gestion des Maisons et Hôtels <Otdel Upravleniâ Domami i Otelâmi>. »1
Ces décisions dépendent du rang de la personne dans l’appareil soviéto- communiste. Ainsi, Natalia Lebina a retrouvé la liste des ayants droit de la 2e maison des Soviets, à l’hôtel Europe de Petrograd. Partant des membres du Comité exécutif central pan-russe et du CC du PC, elle « descend » jusqu’aux participants des collèges de direction des sections des Comités exécutifs provinciaux. S’il reste encore des chambres libres, elles seront pour des « militants responsables dont l’adhésion date au plus tard de 1918 ».
Les archives du Comité de Province du PC mentionnent au moins trois immeubles de ce type à Kharkov. Il existe une maison du Comité exécutif de Province et des maisons soviétiques. La Maison des soviets n°2 est clairement avérée en avril 1921 sur la rue Soumskaïa, l’artère centrale de la ville. Il doit s’agir de l’immeuble situé au n°68, cité ailleurs sans plus de précision2. C’est une maison de quatre étages3 ¾dans la nouvelle on en compte cinq ¾, avec dix-sept fenêtres par niveaux (voir plan c6 et photographie i16, en annexe). Le bâtiment a deux ailes assez petites qui délimitent partiellement une cour invisible de la rue. On peut évaluer, par-delà les détails, la population maximum d’un tel immeuble à deux cents personnes. Les différentes maisons soviétiques ne doivent donc pas compter plus de 500 ou 1000 résidants pour une capitale de 230 000 habitants1.
Ce faible nombre est inversement proportionnel au niveau de responsabilité des occupants. Les principaux dirigeants de la RSS d’Ukraine devaient se retrouver à la première Maison des soviets. Dans la deuxième Maison, les personnages de Strelnikova ont des fonctions moindres, mais ils exercent pour la plupart un commandement. On voit apparaître le président du Comité exécutif de Province (Pronski, p. 26), un commandant rouge en exercice (Minski, p. 22), un ancien chef de division (Iouz, devenu « commandant » de la Maison ; p. 11), un instructeur de comité de district (Lenka, p. 16), une tchékiste (Elsa, p. 19), plusieurs responsables de cellules d’usine (Guenka, Ivanitski, p. 3). Même pour les civils (dont un écrivain de la Culture prolétarienne), « l’instruction militaire régulière » (p. 9) et la prise d’armes en cas d’alerte (p. 28-29) rappellent que le pouvoir ne tient qu’à l’exercice de la force.
Le train de vie des résidants est simple. On boit du thé. Le chou est assez exceptionnel pour être une fête (p. 24). Quand personne ne peut verser de quoi l’améliorer, l’ordinaire est fait de bouillie de blé (p. 9). Comme le remarquait Pierre Pascal au sujet de la Première maison des soviets à Petrograd, le « confort n[’y] avait rien de sardanapalesque, mais (…) c’était pour ceux qui en profitèrent une béatitude et pour toute la ville qui en était privée un scandale »2. Or l’Ukraine connaît justement une famine au sortir de la guerre civile. La nouvelle, qui s’inscrit entre avril et novembre 1921, l’évoque presque sans détour :
En général c’était la misère dans les villages, il n’avait pas plu, on sentait la mauvaise récolte. Les prés étaient secs et poussaient ras, le bétail dépérissait, on abattait des vaches faute de pouvoir les nourrir ; les paysans erraient dans les champs nus, ils désespéraient : ils accusaient les communistes de tous leurs maux.
Lenka marchait en sifflant et pensait qu’il fallait changer de politique, sinon les gens mourraient par centaines et l’économie s’effondrerait » (p. 16).
Dans l’attente des effets de la NEP, la haine contre les communistes s’explique par la concentration dans les mêmes mains de quelques privilèges et de beaucoup de pouvoir. Leur vie entre eux, à part de la population, finit d’en faire une aristocratie.
Sur le fond d’une couche dirigeante en formation, la question de la nature de ces Maisons des soviets se pose. Sont-elles de simples hôtels ou peuvent-elles être assimilées à des communes par une ambition de réforme du mode de vie ? On peut remarquer que bien des traits des mœurs anciennes subsistent dans la nouvelle élite. Au deuxième étage, il y a les « appartements familiaux » où « les femmes de communistes (…) se préparent à manger sur des réchauds, élèvent leurs propres enfants, s’habillent avec élégance, et, dit-on, étudient la science d’aimer très tendrement leurs maris » (p. 10). Ce mode de vie est clairement critiqué dès la première page de la nouvelle, au nom de l’idéal de commune (voir plus haut la fin de la citation p. ). Par contre la répartition des fonctions selon le genre est décrite sans réserves. « En bas, dans la cuisine du sous-sol, les deux cuisinières font claquer les couteaux ; elles sont grosses et gentilles comme des mamans ». À la nursery « travaillent trois femmes gentilles et tendres (…) si bien que les mères au travail ne craignent rien pour leurs enfants » (p. 10).