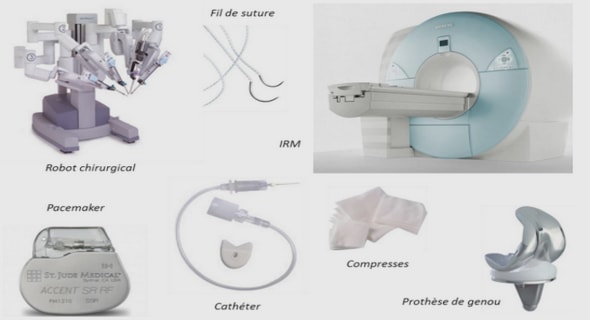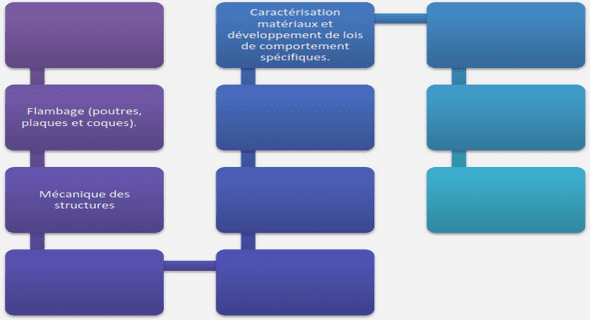De l’orature ancestrale à la littératurecontemporaine
des Dakotapi et des Paiwan
« Autochtones », « aborigènes » ou « indigènes » ?
Le terme « aborigène », bien que n’étant plus utilisé exclusivement pour les aborigènes d’Australie, n’a pas été retenu en raison de sa dimension bureaucratique, qui a conservé au travers de l’histoire, en tant que catégorie, « une même fonction : les « Aborigènes » représentent la nature sauvage voire la barbarie contre laquelle s’établit la civilisation » 6. Quant au terme « indigène », utilisé en anglais (“indigenous”) pour s’en référer aux peuples premiers, il reste marqué en langue française par l’époque coloniale de la France durant laquelle il servait, à l’instar du terme australien « aborigène », de catégorie bureaucratique. Par contre, le terme « autochtone » ne revêt pas cette dimension bureaucratique. Il rend l’idée du terme anglais native, ou originaire du pays, et il est un équivalant français du terme chinois choisi par les peuples premiers de Taïwan : yuánzhùmín 原住民 (littéralement « peuples résidant à l’origine »). Les autochtones de Taïwan et des États-Unis se sont battus, et se battent encore, pour obtenir cette reconnaissance en tant que peuples premiers, afin d’affirmer leur souveraineté tribale et culturelle. Aussi, dans cette étude, le terme « autochtone » a été préféré à ceux d’indigène et d’aborigène.
Origines historiques de la “literacy”autochtone
Avant la colonisation, les autochtones dakotapi et paiwan vivaient dans des sociétés orales où l’histoire du peuple et les récits ancestraux étaient transmis au moyen de l’orature. Il faut entendre par orature, comme le veut le linguiste, ethnologue et écrivain français Rémy Dor, l’ensemble d’un patrimoine transmis à l’oral, conservé dans la mémoire des auditeurs, et distinct de la littérature (par essence écrite)8 . Cet amalgame lexical d’oral et de littérature, apparu dans les années 1970, est également attribué au linguiste et théoricien littéraire Ougandais Pio Zirimu. Il sert d’alternative au terme que Zirimu estimait trop oxymorique de littérature orale. Bien que désignant tout d’abord la tradition orale africaine, le terme d’orature s’applique parfaitement aux récits dakotapi et paiwan, qui rejoignent la définition donnée par le poète et professeur de l’Université d’État de l’Ohio, Lupenga Mphande, spécialiste des langues et littératures d’Afrique du Sud, dans son article sur la littérature et la performance orale : Orature means something passed on through the spoken word, and because it is based on the spoken language it comes to life only in a living community. Where community life fades away, orality loses it function and dies. It needs people in a living social setting; it needs life itself. Thus orature grows out of tradition, and keeps tradition alive.9 L’orature signifie quelque chose de transmis au travers de la parole orale, et parce que cela se fonde sur la parole orale, elle ne prend vie qu’au sein d’une communauté vivante. Là où la vie communautaire disparait, l’oralité perd sa fonction et meurt. Elle a besoin de gens dans un contexte social vivant ; elle a besoin de la vie elle-même. Ainsi, l’orature provient de la tradition, et garde la tradition en vie. (Tdl.) Les Paiwan et les Dakotapi ont en commun une orature transmise de génération en génération, avec des récits visant à expliquer le monde qui les entoure. Dans Le Mythe et la Plume : La littérature indienne contemporaine en Amérique du Nord, Bernadette Rigal-Cellard, professeur de littérature et civilisation nord-américaines, qualifie ces récits oraux des peuples autochtones d’orature, dont les fonctions variées se retrouvent dans de nombreuses sociétés premières. Elle définit ensuite leurs multiples fonctions dans ces « cultures tribales » : Comme dans toutes les cultures, ces histoires avaient et ont toujours diverses fonctions: souder la communauté en lui faisant partager le même système symbolique; éclairer le mystère de la création du monde et des êtres animés et inanimés en fournissant une explication crédible de leur formation et de leur évolution; donner des repères en expliquant comment le groupe est apparu et s’est installé à tel endroit ; divertir par le récit des aventures comiques, humains, esprits ou animaux, tels que les tricksters, et démontrer par là l’interaction entre tous les êtres ; faire la morale en fournissant une explication pour le mal, les maladies, la mort et en même temps offrir des conseils pour éviter les accidents en restant sans cesse vigilant face aux esprits maléfiques qui peuplent les eaux, les canyons…10 Sans écriture alphabétique, les Dakotapi transcrivaient leur histoire au moyen de pictogrammes à la configuration circulaire, et peints sur des peaux de bisons, appelés waniyetu wowapi en lakota et en dakota, ou “winter counts” (littéralement « comptes d’hiver »). Chaque année était représentée par un pictogramme qui servait à activer le processus mémoriel de l’historien du peuple. Ce pictogramme correspondait toujours à l’évènement le plus marquant de l’année. Dans son étude sur la vie précoloniale des Dakotapi, “The Dakota Way of Life”, l’auteure, linguiste et ethnologue dakotapi Ella Cara Deloria (1889-1971), a décrit le winter count comme un « calendrier des années » (“calendar of years”), dans lequel les années n’étaient pas comptées au moyen de chiffres, mais selon l’évènement le plus important pour la tribu, et les années portaient un nom y faisant référence. Chaque tribu avait son winter count et son historien tribal, et il existait donc de nombreux winter counts aux noms d’années variables selon les tribus12. Dans la première moitié du seizième siècle, des missionnaires envoyés en Amérique du Sud construisirent une première ethnographie des autochtones, dans le but de les convertir. Par la suite, et très rapidement, des lettrés autochtones mirent eux aussi par écrit leurs récits et leurs histoires. En Amérique du Nord, le premier auteur autochtone publié fut le Mohegan Samson Occom (1723-1792), qui publia en 1772 un sermon en anglais, tandis que la première autobiographie publiée d’un autochtone, celle de William Apes (1798-1839), un Pequot, datait de 1829. Apes était en outre un des « écrivains les plus énergiques de la protestation du début du dix-neuvième siècle »13. Depuis l’ethnologie moderne, on retrouve sur tous les continents ce processus de mise par écrit des traditions orales (incluant non seulement des mythes et des récits ancestraux, mais également des rites et des coutumes, constituant « un héritage oral intégré »14), en particulier à partir de la seconde moitié du dix-neuvième siècle dans les pays européens, où le folklore autochtone écrit par des allochtones devient une mode. Les autochtones des Plaines d’Amérique du Nord, qui, en reprenant les termes de l’auteur, historien, théologien et activiste dakotapi Vine Deloria Jr. (1933-2005), se battaient « férocement » contre les Blancs, « devinrent les Indiens Archétypes dans l’esprit des Blancs ». Cette image contribuait à la représentation de « l’Indien d’Amérique », diffusée partout dans le monde, notamment à travers le genre cinématographique du western. En parallèle, aux États-Unis, se développa une forme de littérature s’intéressant à la vie et aux croyances des Dakotapi. Elle était d’abord écrite par des médecins, des hommes d’église, des anthropologues et des aventuriers blancs, qui anticipaient sans doute la disparition de ces peuples et recueillaient toutes sortes de données et de témoignages, de fragments de culture. Ces données étaient compilées par des cercles universitaires dans la mouvance des sociétés savantes occidentales des dix-huitième et dix-neuvième siècles, ou pour établir des collections privées16. Ces membres de la société dominante n’avaient cependant pas les mêmes préoccupations concernant la préservation de l’orature des autochtones, qui de leur côté continuaient à la transmettre et la faire vivre oralement de génération en génération. À l’opposé de ces tentatives de conservation des traditions dakotapi, à la fin des guerres indiennes, le gouvernement lança une campagne d’assimilation fondée sur l’éducation des enfants qui étaient enlevés à leur famille et placés dans des pensionnats, de manière à éradiquer leur culture d’origine. Ce processus de décimation des populations autochtones, d’ethnocide, puis d’assimilation à une culture dominante, conduisit par réaction à un mouvement de revendication identitaire, dans lequel les Dakotapi se posèrent une fois encore la question de la préservation et de la transmission de leur orature. Ce mouvement se retrouva ultérieurement chez les autochtones de Taïwan.
Résumé |