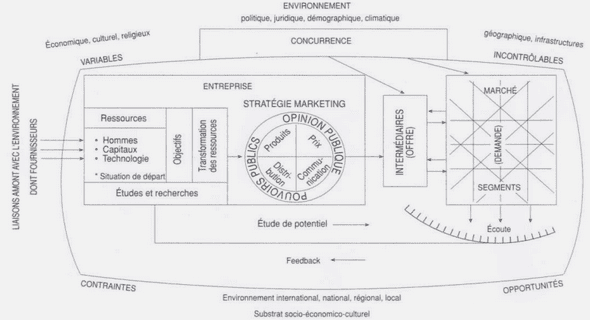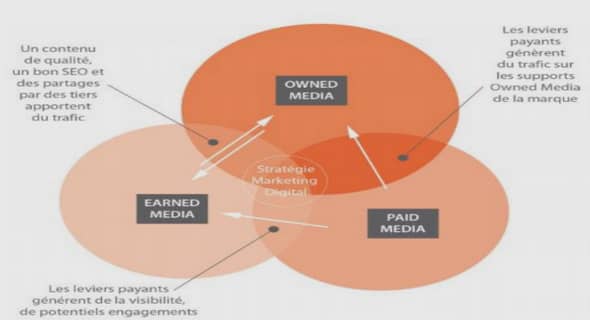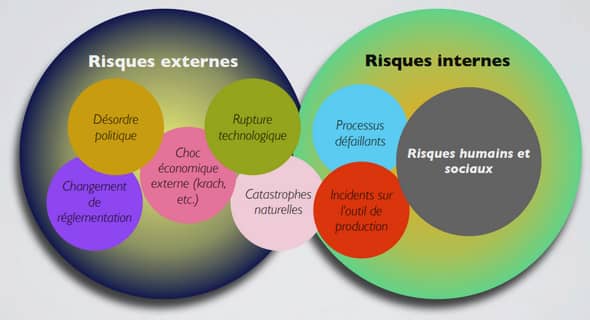Enjeux, politiques et réglementations
La France est le premier pays producteur agricole de l’Union Européenne, avec une superficie agricole qui domine également celle les autres pays de l’Union. Cette superficie représente plus de 60% des terres dans les régions du Nord et de l’Ouest (Eurostat). L’augmentation de la production agricole a été considérable depuis la fin de la seconde guerre mondiale et l’évolution vers l’agriculture intensive a entrainé une dépendance aux usages à grande échelle de produits phytopharmaceutiques. Depuis deux décennies, la question de la viabilité des systèmes agricoles se pose et les enjeux en termes d’impacts sur l’environnement et la santé sont entrés au cœur des préoccupations contemporaines (Aubertot et al., 2005; Inserm, 2013).
Des données de contamination généralisée des eaux par différents polluants chimiques dont les produits phytosanitaires sont disponibles depuis les années 1990 à travers l’Europe et c’est en 2000 avec la Directive Cadre Eau (2000/60/CE) que les états membres sont d’abord incités à réduire cette contamination, issue notamment des dérives directes lors de l’épandage agricole des pesticides. En France, les programmes de recherche interdisciplinaires visant à mieux évaluer et réduire les risques liés à l’utilisation des pesticides sont mis en place dès 1999 (programme incitatif de recherches « Évaluation et réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides » du Ministère en charge de l’Ecologie), et parallèlement à l’augmentation des connaissances scientifiques, la réglementation autour des usages des produits phytosanitaires s’est renforcée au cours du temps. Le principe de précaution quant aux facteurs possiblement néfastes est inscrit dans la Chartre de l’environnement française en 2004, qui mentionne que « la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et (…) l’adoption de mesures provisoires et proportionnées », et ce, même en cas d’incertitudes en l’état des connaissances scientifiques. La volonté des autorités de garantir un environnement de bonne qualité, pour prévenir les impacts sur la santé est affichée à travers le Plan National Santé Environnement (PNSE, Ministère de la transition écologique et solidaire) initié en 2004, et l’organisation du Grenelle de l’environnement en 2007. La problématique du développement des alternatives à l’utilisation des pesticides s’impose, et le plan interministériel Ecophyto (Ministère de l’agriculture et de l’Alimentation) dans sa première version pose comme objectif ambitieux de réduire de moitié l’utilisation des produits phytosanitaire en France en dix ans. Des recherches sont alors mises en œuvre pour développer des outils permettant d’atteindre ces objectifs de réduction des usages tout en garantissant le rendement des cultures et la pérennité des exploitations agricoles (Aubertot et al., 2005; Charbonnier et al., 2015). Le dispositif DEPHY (réseau de Démonstration, Expérimentation et Production de références sur les systèmes économes en phytopharmaceutiques) rassemble 3000 exploitations agricoles pilotes engagées volontairement dans toute la France avec pour finalité d’éprouver, valoriser et déployer ces techniques. Les solutions proposées peuvent consister à augmenter l’efficience des produits phytosanitaires et ainsi réduire les doses nécessaires, cela correspond aux systèmes d’agriculture « raisonnée », et d’autres solutions plus durables demandent davantage d’investissement des acteurs du secteur agricole : des solutions de substitution aux produits phytosanitaires jusqu’à la reconception complète des systèmes agricoles. Aux limites techniques s’ajoutent le rôle des représentations liées aux pesticides, aux pratiques respectueuses de l’environnement, à la place de l’agriculteur dans la société, et l’importance de l’influence des pairs sur les pratiques individuelles, qui rendent nécessaire des travaux interdisciplinaires associant les sciences humaines et sociales, la prise en compte des pratiques culturales dépassant cadre des pratiques phytosanitaires.
Il s’agit bien en France et dans l’Europe de l’émergence politique de la thématique santé environnement et de sa prise en compte par l’ensemble de la société, et malgré un effet d’entrainement certain, des limites s’affichent rapidement avec en particulier des difficultés à évaluer le niveau de réalisation des actions mises en place par manque d’indicateur précis de l’évolution des pratiques liées aux pesticides. Les questions en santé environnement sont par nature multiples et difficiles à hiérarchiser, la priorité est alors accordée à la réduction des expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé. C’est pourquoi les efforts s’attachent dans un premier temps à identifier les contaminations environnementales les plus préoccupantes et les sources responsables des expositions de la population.
C’est à cette époque qu’une série d’actions françaises sont mises en place, dans le cadre notamment de la Directive européenne « utilisation durable des pesticides » (2009/128/CE). On notera alors l’adoption de la loi limitant les applications de pesticides sur les cultures selon les conditions météorologiques avec pour objectif de réduire les pertes directes dans l’environnement (Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime), qui prévoit également un délai à respecter avant de rentrer à nouveau sur une parcelle traitée. Les usages de produits phytosanitaires sont restreints à proximité des lieux fréquentés par le grand public ou les groupes de personnes vulnérables avec l’interdiction des substances les plus dangereuses (Arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de certains produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables), et la formation des utilisateurs de produits phytosanitaire est renforcée avec l’obligation de posséder un certificat phytosanitaire (Certif’phyto – Certificats individuels professionnels produits phytopharmaceutiques, Décret n° 2011-1325).
Dans le cadre du règlement européen REACH (règlement UE N°1907/2006) entré en vigueur en 2007 et qui prévoit l’évaluation progressive de toutes les molécules chimiques mises sur le marché européen, les produits biocides sont considérés. L’objectif est de restreindre les usages des substances classées à risque (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, persistants, bioaccumulables, toxiques, perturbateurs endocriniens, neurotoxiques ou immunotoxiques). Au 31 mai 2018, déjà plus de 20 000 substances chimiques sont connues et leurs risques potentiels établis.
Les critères permettant la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché pour les produits phytosanitaires sont mis à jour et renforcés en 2011 (règlement UE N°545/2011), avec la prise en compte plus large des connaissances scientifiques au sujet de la persistance dans l’environnement et de la capacité de bioaccumulation des substances, ainsi que des études sur les propriétés toxicologiques des substances et sur la dispiersion des produits pesticides appliqués concernant notamment les résidents, les personnes vivant à proximité des champs où sont appliqués des pesticides. En effet, après les premières mesures visant principalement à limiter les contaminations de l’environnement et des denrées alimentaires et protéger les professionnels ainsi que les groupes les plus vulnérables lors des usages de pesticides, la question spécifique de l’exposition des riverains des zones traitées prend de l’importance progressivement. Les travaux de l’Anses pour s’assurer de la sécurité des riverains des zones traitées sont conduits en 2014 et complétés en 2019. Les experts recommandent l’utilisation de distances de sécurité par rapport aux bâtiments occupés au moins égales aux distances utilisées pour l’évaluation des risques1 pour les résidents et insistent sur l’importance du respect des conditions d’utilisation associées à l’autorisation de mise sur le marché de chaque substance (Avis Anses, Saisine n°2013-SA-0206/n°2019-SA-0020/n°2019-SA-0173). Afin de limiter l’exposition de la population générale aux pesticides, des mesures récentes concernent les usages non-agricoles de produits phytosanitaires, avec une interdiction pour les collectivités à partir de 2017 élargie à une interdiction pour les particuliers en 2019 (LOI n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national).
Avec l’ensemble de ces mesures de contrôle des substances et la volonté de réduction des usages, on peut considérer que les risques liés aux pesticides contemporains tendent à diminuer : en agriculture, « en 60 ans, la toxicité moyenne des substances actives a été divisée par 8,5 (…) les doses moyennes homologuées pour traiter un hectare ont été divisées par plus de 34 » d’après le syndicat des entreprises de la protection des plantes (Union pour la protection des plantes, UIPP). Les différentes révisions du plan Ecophyto soulignent pourtant que les résultats ne sont pas à la hauteur des objectifs pour la France. Malgré les résultats encourageants des fermes expérimentale et la reconnaissance de la qualité du dispositif français par les instances européennes (Rapport 2019 sur la mise en œuvre de la directive 2009/128/CE sur l’utilisation durable des pesticides ; Guteland, 2019), l’agriculture française n’est pas parvenue réduire de moitié les usages de produits phytosanitaires. Les mesures mises en place récemment dans ce sens ne concernent pas seulement les utilisateurs de pesticides mais aussi les autres acteurs de la filière avec une loi ordonnant la séparation du conseil et de la vente de produits phytopharmaceutiques (Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques). Le rapport récent signé de l’Inspection générale des affaires sociales, du Conseil général de l’environnement et du développement durable et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (IGAS N°2017-124R / CGEDD N°011624-01 / CGAAER N°17096 ; Delaunay et al., 2017) met en lumière un frein économique important mais variable selon les filières et dépendant de problématiques de marché qui dépassent largement le cadre du plan Ecophyto, et pointe également la politique agricole commune qui reste peu incitative en matière de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Les experts insistent sur la nécessité de prendre des mesures structurantes pour lever ces freins, concernant la coordination des instances et la mobilisation des financements publiques. D’après ce rapport, les efforts doivent également continuer en termes de recherche, sur les pratiques agricoles économes en produits phytosanitaires d’une part et d’autre part sur les mécanismes d’action des pesticides et le lien entre les expositions et la santé afin d’évaluer la causalité dans un souci de prévention.
Les enjeux politiques et sanitaires actuels concernant les pesticides rejoignent les préoccupations quant à la gestion des risques à fortes incertitudes, qui doivent encore faire l’objet d’une réglementation adaptée et de lignes directrices harmonisées au niveau européen, comme cela a par exemple été mis en place récemment pour les perturbateurs endocriniens (Comission Européenne COM(2018)734). En particulier concernant les risques pour la santé, les tests toxicologiques permettent de déterminer pour les substances chimiques une dose critique au deçà de laquelle l’exposition n’entraine pas d’effet néfaste, en prenant en compte les différentes voies d’exposition possibles : absorption orale, respiratoire, cutanée. Ces études sont réalisées chez l’animal. Un facteur d’incertitude, qui prend en compte les limites de la transposition des données chez l’animal vers l’homme et la notion de précaution, est ensuite appliqué pour calculer une valeur limite d’exposition chez l’homme, et les conditions d’usages conformes sont établies de manière à s’assurer que les populations ne soient pas exposées au-dessus de ces valeurs limites. Cependant, des limites persistent et on ne peut donc pas considérer un instant donné qu’une substance non classée équivaut à une substance sans danger. Le cadre juridique européen permet à terme d’exclure les substances actives reconnues comme les plus toxiques mais laisse persister des substances reconnues dangereuses dans l’attente du renouvellement de leur approbation. La nature des données toxicologiques exigées par la réglementation REACH dépend du tonnage en circulation sur le marché, ce qui implique que les substances ne sont pas toutes testées pour les mêmes risques. Certains effets néfastes subtils ne peuvent pas encore totalement être pris en compte d’après les lignes directrices très cadrée, d’autres effets sont encore peu identifiables compte tenu des lacunes en terme de connaissances scientifiques (effets transgénérationnels, mécanismes épigénétique, effets à faibles doses et relations non monotones). L’utilisation de modèles animaux est la méthode considérée la plus fiable pour tester les propriétés des substances, mais de nombreuses limites existent dans l’extrapolation des résultats pour l’homme en particulier pour certains effets. Les modèles de rongeurs sont ne sont par exemple pas les plus pertinents pour étudier la reprotoxicité en raison des différences biologiques importantes avec l’espèce humaine (le développement de l’appareil reproducteur a lieu pendant la période pré-natale chez l’homme mais après la naissance chez les rongeurs). De plus, chaque substance est évaluée de manière individuelle, or la question des usages multiples et des mélanges de substances, en particulier pour les pesticides, vient complexifier davantage les études d’expologie.
Le levier principal pour réduire les incertitudes concernant les risques liés aux pesticides réside dans la production de données qui sont insuffisantes en France, tant concernant les usages des produits pesticides que la contamination des milieux et l’exposition de la population. L’observatoire des résidus de pesticides a émis en 2011 un rapport qui inventorie ces données et pointe des lacunes importantes (ANSES, 2010), qui ne sont pas encore compensées à l’heure actuelle.
Les usages de pesticides
Les quantités de pesticides utilisées en France sont élevées mais les usages correspondan sont mal connus. Les données annuelles de ventes et d’achats de produits phytosanitaires sont répertoriées dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D), ces données sont spatialisées depuis 2013. Entre 2016 et 2017, ces ventes s’élèvent à plus de 70 000 tonnes par ans de substances actives en France, ce qui la place dans le top 3 européen. Ces quantités sont supérieures a celles vendues lors des années 2008 à 2011 (Eurostat). Les herbicides et les fongicides représentent toujours la grande majorité des quantités vendues, avec environ 40% des ventes chacun. Ramenée à la surface agricole du pays, la consommation de produits phytosanitaires en France se situe dans la moyenne européenne avec 3,6 kg/ha en 2017 selon la FAO.
Avant les interdictions récentes de la plupart des produits pour les collectivités et les particuliers, la proportion des produits phytosanitaires dédiés aux usages non-agricoles n’était pas établie de manière consensuelle (estimés à 5% à 10% des quantités de produits phytosanitaires vendus ; ANSES, 2010). Ces usages représentaient une centaine de substances actives différentes en 2011, d’après les données transmises par l’Union pour la Protection des Jardins (UPJ) qui regroupe la majeure partie des fabricants de produits destinés aux jardiniers amateurs et/ou aux professionnels des espaces verts. Comme le soulignait déjà le rapport de l’observatoire des résidus de pesticides de 2011, les incertitudes persistent quant à l’importance relative des ventes transfrontalières de produits phytosanitaires, qui ne sont pas répertoriées. D’autre part, concernant les autres types de produits pesticides tels les biocides, il n’existe pas de déclaration réglementaire des données de ventes facilement accessibles permettant de quantifier les usages et leurs évolutions. Plus généralement, les données précises quant aux utilisations réelles des produits pesticides sont limitées.
Pour évaluer plus spécifiquement les utilisations des produits phytosanitaires en agriculture selon leur cible, l’évolution du nombre moyen de traitement et des indicateurs de fréquence de traitements (IFT) est connue pour différents types de culture à partir des données récoltées lors des enquêtes des pratiques culturales menées régulièrement par la Statistique agricole (Agreste). L’IFT mesure le nombre moyen de doses de référence appliquées à une culture pendant une campagne. En grandes cultures, on peut noter des utilisations importantes de produits phytosanitaires pour les cultures de betteraves sucrières avec en particulier des traitements herbicides (13.7 traitements en moyenne en 2017 avec un IFT de 2.6), et pour les cultures de pommes de terre davantage concernés par des traitements en fongicides qui augmentent entre 2014 et 2017 (12.6 traitements en moyenne en 2017 avec un IFT de 11.7). Parmi les grandes cultures, les traitements phytosanitaires rapportés pour les cultures de céréales (blé tendre, blé dur, orge, triticale, colza, maïs grain) sont globalement moins fréquents pour les différents types de pesticides, cependant on note des utilisations d’herbicides et surtout d’insecticides élevées pour les cultures de colza (3.0 traitements herbicides en moyenne en 2017 avec un IFT de 1.9 et 2.4 traitements insecticides en moyenne avec un IFT de 2.1). Concernant les cultures de légumes, les usages de pesticides sont moins importants et moins contrastés en termes de type de produits, mais avec une variabilité importante entre les types de légumes. En viticulture, ce sont également des traitements fongicides qui sont prédominants (IFT de 12.9 en 2016) avec des augmentations globales non négligeables des traitements entre 2010 et 2016 (tant en termes de nombre de traitements : environ +30% pour les fongicides et pour les insecticides dont les usages sont moins importants, qu’en termes d’IFT : +30% à +40% pour les IFT insecticides et herbicides). Les enquêtes en arboricultures mettent en évidence des traitements importants en fongicides et en insecticides notamment pour les pommes (22.8 traitements fongicides en moyenne en 2015 avec un IFT de 21.8 et 9.0 traitements insecticides en moyenne en 2015 avec un IFT de 8.8) pour lesquelles les tendances reportées sont stables entre 2012 et 2015, alors que pour d’autres fruits ces chiffres sont en augmentation sur cette période, c’est le cas également des traitements herbicides moins nombreux que les insecticides mais avec une tendance à la hausse entre 2012 et 2015. Pour tous les types de cultures, ces indicateurs sont très variables entre les régions françaises. On note en particulier des usages importants de produits phytosanitaires dans certaines régions qui sont également caractérisées par des surfaces agricoles importantes, notamment en grandes cultures (Normandie, Picardie, Champagne-Ardenne, Bretagne).
Publiés en 2019, les résultats de l’étude Pesti’home quantifient et décrivent pour la première fois avec une portée nationale les usages domestiques de produits pesticides (Anses, 2019), répondant à un défaut de connaissances important en France souligné notamment dans le rapport de l’ORP. L’enquête repose sur un échantillonnage stratifié parmi les ménages de France métropolitaine. Ainsi ce sont 1507 ménages représentatifs de la population française qui ont été interrogés en 2014 pour renseigner les caractéristiques de l’habitat et les utilisations de pesticides au cours des 12 derniers mois. Un inventaire des produits pesticides présents au domicile a fourni des informations très précises sur les produits sur les substances actives qui entrent dans leur composition. Ces travaux mettent en lumière des expositions fréquentes à des pesticides au domicile dans la population françaie avec 75% des ménages interrogés qui reportent des usages domestiques de pesticides dans les 12 derniers mois, pour majorité des traitements à l’intérieur des logements. Les utilisations sont différentes selon les régions ainsi que les caractéristiques des logements et d’autres caractéristiques individuelles des ménages. Le profil des utilisateurs est analysé et le rapport conclut que les ménages qui utilisent le plus fréquemment des produits pesticides sont aussi souvent ceux qui en utilisent un nombre plus important, notamment en traitement des jardins. En particulier les couples avec enfants sont souvent décrits comme de forts utilisateurs. L’étude montre que 10 familles chimiques sont retrouvées dans plus de 10% des produits stockés, avec en majorité les insecticides en particulier pyréthrinoïdes. Les conditions de stockage et d’élimination sont aussi étudiés dans ce rapport qui préconise une meilleure information du grand public à ce sujet. Aussi, l’étude met en évidence une proportion non négligeable de ménage stockant des produits interdits au moment de l’enquête (plus d’un quart des ménages).
Contamination de l’environnement par les pesticides
La contamination de l’environnement par les pesticides et leurs produits dégradés en France est aujourd’hui évidente et démontrée par de nombreuses enquêtes. Les connaissances de cette contamination sont cependant inégales selon les différents compartiments de l’environnement, et ne permettent pas toujours d’estimer les niveaux de contamination, ni leurs évolutions dans le temps et la variabilité à l’échelle du territoire français.
La contamination de l’eau est la mieux documentée depuis plus de vingt ans car la réglementation impose des contrôles sanitaires réguliers pour l’eau de consommation, ainsi des mesures sont effectuées sur les points de captages qui peuvent se situer au niveau d’eaux superficielles ou souterraines. Avec pour objectif de réduire la présence de pesticides au niveau le plus bas possible, la limite de qualité pour chaque substance de pesticide est fixée par l’arrêté du 11 janvier 2007 à 0,1 μg/L et à 0,5 μg/L pour le total des pesticides quantifiés. Le dépassement de ces valeurs mesurées dans les points de captage entraîne la non-conformité de l’eau de consommation associée et des contrôles plus fréquents, mais n’est pas considéré par l’Anses comme un risque sanitaire donc n’entraine pas de restriction d’usage pour les populations tant que les concentrations en pesticides n’atteignent pas la valeur sanitaire maximale (Vmax) pour ces substances. En 2018, c’est 90,6% de la population qui a été alimentée par une eau conforme en permanence et les dépassements des limites de qualités ont concerné tous les départements français. Des dépassements entrainant des mesures de restriction d’usages de l’eau pour la boisson ou la préparation d’aliments ont concerné 0,01% de la population (19 unités de distribution parmi les 19302 contrôlées).