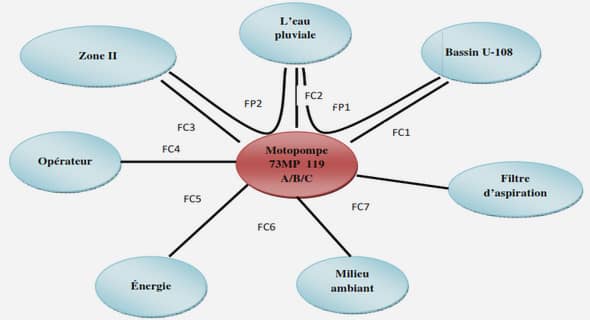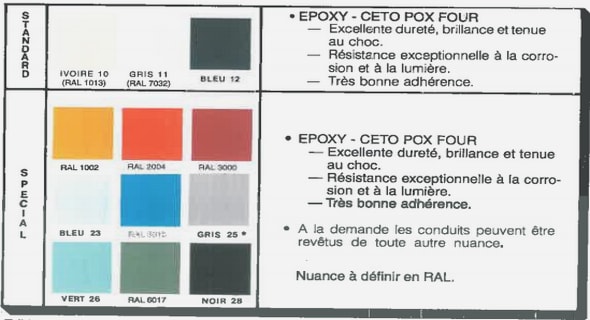QUAND SCIENCES HUMAINES ET RELIGION ENTRENT EN DIALOGUE
Avec quels moyens et quels outils, interroger aujourd’hui le catholicisme contemporain ? Les deux premiers chapitres de notre étude vont s’attacher à en préciser la posture épistémologique ainsi que le cadre historique. Nous nous attarderons sur son histoire récente par le biais de l’histoire sociale de l’Eglise, afin de situer dans le temps le point de départ de notre réflexion. Nous reviendrons par conséquent sur les situations de crises et de changements traversées par l’Eglise durant sa première modernité que les historiens des religions situent autour des dernières années du XIXème siècle, jusqu’au sortir du Concile Vatican II, (1962) à partir duquel l’institution romaine s’est engagée dans un processus d’adaptation à la société en particulier au plan liturgique et social. Nous interrogerons les notions complexes, et parfois galvaudées du terme de modernité en situation religieuse et de religiosité contemporaine, grâce aux concepts qui leur sont affiliés. Nous comparerons les enjeux de l’époque avec ceux auxquels l’Eglise catholique est aujourd’hui confrontée, tant au plan institutionnel qu’au plan humain. Nous nous appuierons pour cela sur les travaux nombreux des anthropologues et sociologues des religions mais aussi sur les penseurs chrétiens, en privilégiant le double apport de ces regards interprétatifs qui sont à l’origine de notre positionnement.
Cette pluralité de points de vue nous permettra de dessiner les contours de cette religion en mouvement » qui a détrôné la « civilisation paroissiale » décrite par Yves Lambert. Nous les mettrons en parallèle avec les textes produits lors du concile Vatican II puis sur ceux qui portent sur la Nouvelle Evangélisation, car ils sont fondateurs d’une évolution profonde de l’Eglise. Nous pourrons ainsi confronter ces observations à la réflexion d’acteurs et de témoins locaux soucieux de faire coïncider leur engagement religieux avec leur temps.
Deux paroisses, deux terrains d’enquête:
Un premier contact avec notre futur terrain d’enquête toulousain a lieu en juillet 2005. Nous découvrons d’abord en nous installant à Toulouse, l’abondance des clochers de la ville puis l’importance de communautés religieuses à l’histoire souvent très ancienne à commencer par celle de la fondation de l’Ordre des Dominicains en 1215 qui instituèrent une université. Cette empreinte religieuse identitaire, nous intrigue d’autant plus, que plusieurs de ces communautés continuent d’accueillir une population jeune en cursus de formation philosophique et théologique et multiplient
destination du plus grand nombre, des propositions spirituelles et culturelles d’une grande variété. Interrogée de longue date par la place du religieux dans les consciences individuelles, notre appréhension de la cité, nouvelle à nos yeux, va d’emblée passer par l’intérêt pour le religieux dans la ville et plus précisément le religieux construit en paroisse. L’église Saint-Exupère, nous ne le savions pas encore, en raison des qualités morales de son curé et du soin apporté par la communauté paroissiale à cultiver la fraternité, sera notre premier point d’ancrage. Ce fut un nouveau « lieu-ressource » déclencheur, avant de devenir rapidement un objet de terrain.
Rien dans ces lieux « baroques » pourtant ne nous était familier, ni les proportions, ni l’odeur, ni les bruits, ni les silhouettes, et cependant, dans cette nouveauté résonnait déjà une invitation. L’année 2006 annonçait celle d’un anniversaire : le bicentenaire de la paroisse. Dans cette volonté de se saisir d’un événement, il y avait bien plus qu’une manifestation historique, le désir avant tout de fédérer les paroissiens autour d’une manifestation de partage communautaire. Cette première initiative éveilla notre curiosité et suscita l’idée d’un thème de recherche en cohérence avec nos terrains antérieurs. C’est donc assez logiquement que ce nouveau terrain allait prendre petit à petit la forme d’un travail de thèse, motivé par le souci de porter un regard authentique et scientifique sur l’Eglise contemporaine.
Avant de décrire les aspects de cette paroisse qui ont retenu notre attention, il convient d’en faire le tour et de la situer grâce aux documents d’archives. L’étude historique et analytique de l’édifice et de son décor a d’ailleurs fait l’objet d’un travail de maîtrise en histoire de l’art à l’université de Toulouse en septembre 2011.
Le bâtiment se situe sur les allées d’une artère bourgeoise de la ville, non loin du centre historique de Toulouse et dans le périmètre des substructures du château Narbonnais, par conséquent des fortifications médiévales de la ville. Le tracé topographique de Toulouse au XVII ème siècle mentionne bien, quelque peu à l’écart des fortifications toujours existantes à cette période-là, la présence des Carmes déchaussés à partir de 1622. L’actuelle voirie, qui date du percement des grandes allées au XIX ème siècle a permis à l’édifice de se trouver quelque peu en retrait. On y accède par un porche d’entrée qui ouvre sur une grande cour rectangulaire bâtie. Cette cour, qui isole le bâtiment de la rue est très appréciée des paroissiens car elle favorise les échanges et la convivialité de l’après-messe.
L’édifice fut construit en 1620-1623 par les Carmes déchaussés. Toulouse et l’ordre des Carmes ont une longue histoire commune puisque ces religieux s’établirent dans la ville dès le XIIIème siècle du fait de leur statut de religieux mendiants qui les obligeait à s’implanter dans les villes pour y faire de l’apostolat2. Le 25 juin 1622 arrivèrent à Toulouse deux envoyés du couvent réformés d’Avignon, chargés de fonder une nouvelle communauté. Le 23 décembre de la même année, les Carmes achetaient des terrains et la multiplication des donations leur permit de commencer la construction du couvent en 1634, un édifice dont l’ampleur correspond à celle du Jardin des Plantes et du Muséum d’histoire naturelle. Une première chapelle jugée trop exiguë fut remplacée par un sanctuaire plus vaste. Et c’est ainsi que débutèrent, l’automne 1642, les travaux de l’église que nous connaissons sous le nom de Saint-Exupère. Elle fut consacrée le 25 mai 1665. Le 2 janvier 1807, elle devint chapelle annexe de la paroisse Saint-Etienne et fut placée sous le vocable de Saint-Exupère, premier évêque de la ville après Saint-Sernin. Ce n’est qu’en 1845 qu’elle devient église paroissiale. Les Carmes ont fait un très large usage des ornements plastiques pour embellir le cadre de leurs célébrations. En dépit des agressions de la période révolutionnaire, leur église a conservé une bonne partie du décor du XVIIème siècle. Il faut noter en particulier l’importance des gypseries du chœur et de la nef destinées recevoir les tableaux, l’entourage des fenêtres, les cartouches entourés d’angelots. Si l’église a connu quelques transformations au cours du temps, (allongement de la nef, nouveau mobilier), elle reste un excellent témoin de l’activité artistique des couvents toulousains de l’Ancien Régime. En mai 2007, une mise en scène poétique de l’intérieur de l’Eglise à laquelle il nous fut suggéré de participer, était proposée aux paroissiens. Ecrite par un prêtre du diocèse, attentif aux richesses architecturales du patrimoine de la ville, cette mise en scène voulait attirer l’attention des paroissiens sur la qualité de l’ensemble artistique qu’ils fréquentent le dimanche. Ce regard poétique composé pour l’occasion, attirait en effet l’attention sur les trésors d’une architecture par bien des côtés exubérante mais aussi sur la vocation spirituelle des lieux immergés dans la modernité. Une prise de conscience qui commençait par ces
mots : Venez donc en ce lieu !
Il est pour vous, il n’a pas d’ancienneté cistercienne ni de haute verticalité ogivale. Il n’est pas préposé à la déambulation interne comme Saint-Sernin ou Saint-Etienne, il est préposé à la mobilité intérieure, celle du cœur et des pensées. Il y a deux cents ans que les gens s’y rassemblent ! Venez, approchez de vous-même, approchez-vous les uns des autres !
Venez pour l’intériorité et pour l’écoute, pour la contemplation au-dedans ! Venez pour le Sacrifice de gloire, cet Acte de Parole qui donne ses véritables dimensions à la nef toute entière.
L’extérieur ou les portables font leur déclaration et leurs prophéties dérisoires sur les trottoirs, dans les allées, au milieu du stationnement des allées.
Rares, mais précieuses sont les paroles et les déclarations qui couvrent l’Amour […] »
Cette incursion poétique en préambule de la messe dominicale, n’est pas anodine. Elle montre la sensibilité du prêtre de la paroisse, le père Guy Clerc, pour tout ce qui fait lien entre la beauté et la connaissance. C’est également pour cette raison qu’une conférence historique fut proposée toujours dans le cadre du bicentenaire, sur les conséquences de la période révolutionnaire pour le clergé et l’Eglise catholique à Toulouse. Ces efforts culturels n’ont pas toujours été récompensés par une grande participation mais au moins ont-ils eu le mérite de créer des occasions de rencontres. Les plus fréquentes sont cependant de l’ordre du festif, après la messe, sous forme d’apéritifs « de parvis ». Elles se poursuivent toujours en 2011 et rencontrent un égal succès intergénérationnel.
Porter un regard attentif au monde est certainement une des qualités du père Guy. Le côtoyer au cours de ces années de terrain, nous a permis de mesurer aussi son regard critique lors des temps de relecture mensuels en conseil de pastorale. C’est là, dans sa capacité de regarder et de se regarder que la paroisse conduite par son guide spirituel, dévoile une de ses spécificités. C’est ce qui lui a permis de ne pas se dérober au regard de l’anthropologue que nous étions et d’accepter de devenir non sans concertation préalable, objet d’étude.
Comme nous courions le risque d’une empathie excessive avec notre terrain, le choix d’une seconde paroisse s’est avéré nécessaire. Cette décision encouragée par notre directeur de thèse, avait pour but de nous décentrer de notre premier lieu d’étude et permettait l’apport d’éléments de comparaison plus à même de répondre à notre problématique. C’est la paroisse Saint-Pierre-des-Chartreux, dont le choix nous a été suggéré, du fait de son actualité récente, par l’archevêque de Toulouse, qui a été retenue. En 2007 effectivement, fruit d’une demande de la part des étudiants et d’une volonté de fondation nouvelle, la paroisse renaissait non pas comme lieu ordinaire du culte mais comme lieu spécifique à l’attention des étudiants chrétiens de la Ville. Cette inscription dans un paysage qui entendait réfléchir à la transmission de la foi dans le monde de la jeunesse fit très rapidement de ce lieu jusque là occupé par des services de l’Eglise et un foyer étudiant, un lieu phare d’où allaient émerger des propositions et des questionnements nouveaux. Son curé, un jeune trentenaire issu de la génération Jean-Paul II, le père Simon, son emplacement, au cœur de la vie étudiante toulousaine, ont contribué assez naturellement à son rayonnement. La paroisse se situe à proximité de la faculté de Droit de la ville et d’une place éponyme, la place Saint-Pierre, cœur d’une activité étudiante importante le jour, foisonnante la nuit. Cette localisation, de fait consubstantielle à la disponibilité d’une église et de locaux attenants, joua certainement en faveur du succès de la paroisse, lui donna une visibilité immédiate ainsi qu’une identité particulière : être au cœur de la ville et de la vie. Les étudiants jusque là un peu éparpillés s’installèrent donc dans cet ancien couvent désaffecté des Chartreux, lieu de patrimoine chargé d’histoire, sur lequel nous nous proposons de revenir un instant.
La paroisse Saint-Pierre-des-Chartreux doit son nom à son emplacement, le quartier Saint-Pierre où les moines chartreux avaient acheté plusieurs terrains et immeubles. Ils décident d’y construire en 1606 leur église. Le mode de vie des moines chartreux se caractérise par une existence solitaire dans un « désert », tout en vivant en communauté afin d’associer les avantages de la vie des premiers ermites d’Egypte avec ceux de la vie communautaire des moines bénédictins. A la fin du moyen Age, les chartreux s’installent de préférence en ville ou à leur proximité, au contact des centres de création. Ce qui les incite à admettre l’art dans leurs églises au contraire de leur lieu de vie qui restent tout comme leurs habitudes, d’un austère dépouillement. L’histoire des chartreux dans la ville de Toulouse remonte au XVI ème siècle lorsque la chartreuse de Saïx, prés de Castres dans le Tarn, ruinée par les guerres de religion, envoie ses occupants se réfugier à Toulouse, place forte catholique, sous la protection de son archevêque le cardinal d’Armagnac