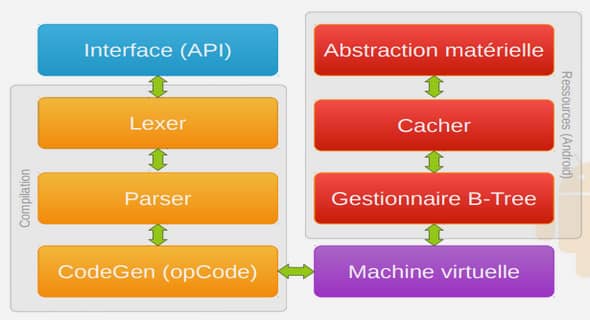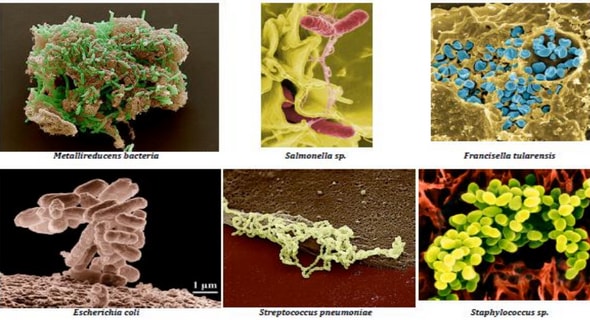Différentiel d’exposition aux risques environnementaux
Le questionnement sur l’existence de disparités d’exposition à des nuisances environnementales a fait l’objet d’une importante recherche conduite pr incipalement en Amérique du Nord et en Europe. Ces études dites « de justice environnementale » ou « d’équité environnementale » se sont intéressées à évaluer si les populations socio-économiquement défavorisées bear« a disproportionate burden of environmental hazards » (66). La suite de ce paragraphe présente l’état de l’art des principales études de justice nvironnementale pour les nuisances les plus étudiées dans la littérature.
Le concept de justice environnementale est né aux Etats-Unis à la fin des années 70 du constat que les minorités ethniques et raciales (principalement les populations afro-américaines) étaient soumises à des discriminations environnementales, n otamment quant aux décisions d’aménagement et d’implantation d’équipements polluants (67,68). Ce mouvement s’est aujourd’hui étendu à l’Europe et aux autres pays industrialisés où l’on parle plutôt d’équité environnementale. Toutefois, au-delà de la terminol ogie utilisée, le constat reste le même : des inégalités socio-économiques dans la distribution esd risques environnementaux sont observées quasiment partout, quels que soient les nuisances environnementales considérées (bruit, pollution industrielle, trafic, qualité de l’air, etc.) et les indicateurs utilisés pour caractériser le niveausocio-économique (revenu, race, ethnie, niveau de défaveur, valeur du logement, etc.).
Exposition à des sources de pollution ponctuelles
Les premières études de justice environnementale sesont intéressées à la proximité de certains groupes de population par rapport à des sources de pollution ponctuelles telles que les industries polluantes, les usines chimiques, les usines de traitement et de destruction des déchets, les incinérateurs, les décharges, etc. (69-76). Ces études conduites essentiellement aux Etats-Unis ont conclu pour la majorité d’entre elles que les minorités ethniques (population afro-américaine et hispanique), en particulier celles à faible revenu, habitaient généralement à une distance plus restreinte des installations polluantes que les populations de race blanche à fort revenu. Par exemple, Perlin et al ont examiné en 1999 les associations entre les caractéristiques socio-économiques (la race et le niveau de pauvreté) despopulations et leur proximité résidentielle par rapport à des sources de pollution industrielle dan s trois zones géographiques des Etats-Unis (74). Les auteurs ont conclu que les populations afro-américaines et celles vivant sous le seuil de pauvreté habitaient en moyenne plus près d’une et/ou de plusieurs industries polluantes que les populations de race blanche et celles vivant au-dessus du seuil de pauvreté. En 2001, ces auteurs ont confirmé leurs résultats en élargissant leur pulation d’étude à des sous-groupes connus pour être particulièrement vulnérables aux effets des expositions environnementales : les enfants (âgés de moins de 5 ans) et les personnes âgées (de plus de 65 ans) (75). Une évaluation similaire conduite en Oregon a montré que les industries chimiques étaient localisées de manière disproportionnée dans les quartiers caractérisés par des pourcentages de minorités ethniques plus élevés et des revenus moyens plus faibles que dansle comté environnant. Cependant, aucune relation n’était observée entre la toxicité des produits émis par les industries et les caractéristiques socio-économiques des quartiers dans lesquels elles étaient implantées (72). Plus récemment, Norton et al (2007) ont conforté les résultats desétudes antérieures en démontrant que les décharges en Caroline du Nord étaient disproportionellement localisées dans les quartiers de résidence caractérisés par un pourcentage élevé personnesde de couleur et par une faible valeur des biens immobiliers (73).
Si la majorité de ces études a abondé dans le sensd’une distribution inégale des industries et installations polluantes selon le niveau socio-économique des zones de résidence, certaines, comme celle d’Anderton et al (1994) (69), n’ont cep endant observé aucune discrimination raciale ou ethnique dans la localisation des installations polluantes tandis que d’autres, au contraire, ont mis en évidence des associations inverses (76). C’est le cas de Perlin et al (1995) qui ont trouvé une association positive entre le revenu et les émissions polluantes d’origine industrielle sur l’ensemble des Etats-Unis (76). Selon les auteurs, le niveau géographique d’agrégation (comté), vraisemblablement trop grossier, pourrait constituer un élément d’explication de ce résultat.
En Europe, ce type de nuisance environnementale a fait l’objet de peu d’investigations et les études menées l’ont été principalement au RoyaumeniU(77-79). Devant les résultats apportés par les études américaines, ce type d’exposition mériterait cependant d’être davantage exploré.
Exposition au trafic routier
Les études de justice environnementale ayant utilisé comme indicateur d’exposition la densité de trafic ou la proximité d’un axe routier sont comparativement beaucoup moins nombreuses que celles menées sur des sources de pollution ponctueles (80-82). A ce titre, peuvent néanmoins être citées les études américaines de Gunier et al (2003) (81) et de Green et al (2004) (80) qui se sont toutes les deux intéressées à des populations d’enfants. Dans la première étude, les auteurs ont montré que les enfants de couleur (d’origine hispanique, afro-américaine ou asiatique) avec un faible revenu familial avaient en moyenne cinq fois plus de risques de vivre dans un quartier à forte densité de trafic que les enfants de race blanche avec un fort revenu (81). Dans la deuxième étude, les auteurs ont cherché s’il existait des disparités socio-économiques dans la proximité des écoles élémentaires par rapport à des routes à forttrafic. Ils ont conclu en ce sens et démontré que les écoles localisées à proximité des axes routiersà forte densité de trafic étaient généralement situées dans des quartiers socio-économiquement défavorisés et accueillaient un nombre disproportionné d’enfants d’origine hispanique et afro-américaine (80).
Exposition au bruit
La gêne occasionnée par le bruit lié au trafic routier, ferroviaire ou aérien est de plus en plus ressentie dans la population comme une nuisance environnementale majeure troublant la qualité de vie. Pourtant, à ce jour, les études s’étant intéressées à l’existence d’inégalités socio-économiques face à l’exposition aux nuisances sonores demeurent relativement peu nombreuses et ont été, contrairement aux autres nuisances environnementales, principalement initiées en Europe (83-86). Ces études mettent en évidence desdisparités d’exposition au bruit d’amplitudes variables selon les caractéristiques socio-économiques considérées : l’appartenance ethnique (83), le niveau de défaveur des quartiers de résidence (83), le niveau de revenu (84-86) ou encore les conditions de logement (type de logement, nombre moyen de personnes par pièce) (85). Dans la ville de Birmingham au Royaume-Uni, Brainard et al (2004) ont par exemple observé de fortes disparités dans l’exposition au bruit occasionné par le transport (routier, ferroviaire et aérien) selon le niveau de défaveur des quartiers de résidence (estimé par l’indice de Carstairs). En revanche, seule une faible association avec l’appartenance ethnique était mise en évidence ; les populations noires étaient sujettes à vivre dans des quartiers avec des niveaux de bruit légèrement plus élevés que la moyenne (83). Une autre étude, onduitec aux Pays-Bas, a rapporté une association entre un environnement « mauvais » et le niveau de revenu du foyer pour le bruit occasionné par le trafic routier (86). Un environnement était considéré comme « mauvais » quand les niveaux de bruit estimés dans les zones de résidence étaient supérieurs aux normes réglementaires. Finalement, une étude allemande a montré que le revenu du foyer et certaines caractéristiques du logement (type du quartier [résidentiel ou industriel], type du logement [maison individuelle ou appartement], qualité du logement [rénové ou à rénover]) influençaient fortement la perception de l’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique. De manière globale, les personnes ayant un faible revenu et celles vivant dans des conditions de logement difficiles avaient tendance à ressentir une plus fo rte exposition au bruit et à la pollution atmosphérique que le reste de la population (85).
Exposition à la pollution atmosphérique
Les études de justice environnementale ayant exploré les indicateurs de qualité de l’air, mesurés ou modélisés, sont relativement récentes et ont étéconduites aussi bien en Amérique du Nord (Etats-Unis (87-92) et Canada (93-95)) qu’en Europe (96-102). La majorité d’entre elles a conclu que les niveaux de contamination rencontrés dans l’environnement des populations socio-économiquement défavorisées étaient plus élevésenqu’milieu favorisé. Ces résultats demeurent consistants quel que soit le polluant considéré, àl’exception notable de l’ozone (O 3) pour lequel les résultats rapportés sont plus controversés (8790)-.
Aux Etats-Unis, les études des disparités liées à esd niveaux de pollution atmosphérique se sont intéressées particulièrement à l’ozone et aux particules (PM) (87-90). Ainsi, Brajer et Hall (2005) ont mis en évidence que les niveaux d’O observés dans le bassin de Los Angeles étaient relativement plus élevés pour les personnes à plus faible revenu et à plus faible niveau d’éducation (88). Ces résultats confirmaient ceux précédemment rapportés dans deux études conduites sur la même zone (87,89). Des association inverses ont été, en revanche, observées dans une étude menée à New York et à Philadelphie où l’exposition à l’O 3 était plus élevée parmi les populations de race blanche et à revenu élevé 90)(. Dans une population de femmes enceintes, Woodruff et al (2003) ont montré, quant à eux, que le risque de vivre dans les comtés les plus pollués était deux fois plus élevé pour les femmesappartenant à une minorité ethnique (hispanique, afro-américaine ou asiatique) que pourcelles de race blanche. En revanche, le niveau d’éducation n’apparaissait pas comme associé avec esl niveaux de pollution (estimés au moyen d’un indice de pollution combinant les principaux polluants atmosphériques : particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm [PM ], dioxyde d’azote [NO ], dioxyde de soufre [SO2], monoxyde de carbone [CO] et O3) (91).
Au Canada, la recherche sur les inégalités environnementales liées à l’exposition à la pollution atmosphérique est l’œuvre d’un petit groupe de cher cheurs qui travaillent essentiellement sur la ville industrielle d’Hamilton, dans l’Ontario. En 2 001, Jerrett et al ont ainsi évalué si les concentrations de particules totales en suspension (TSP, Total Suspended Particulates) estimées dans chaque quartier de résidence étaient associéesaux différentes caractéristiques socio-économiques de ces derniers (taux de chômage, valeur du logement, revenu médian du foyer, pourcentage d’immigrants, etc.) (95). Ces concentrations se sont révélées associées positivement au taux de chômage et à un faible revenu et négativ ement à la valeur du logement. Des résultats similaires ont été confirmés sur une période plusécenter (93).
En Europe, la totalité des études publiées à ce jour a été conduite à notre connaissance au Royaume-Uni (96,98-100,102) ou en Suède (97,101) et a principalement analysé les associations avec des polluants issus du trafic (NO2, PM10 et CO). Brainard et al (2002) ont rapporté une forte association positive entre, d’une part, les émissions modélisées de NO et de CO et, d’autre part, l’origine ethnique et le niveau de défaveur (estiméau moyen de l’indice de Carstairs) des quartiers de résidence dans la ville de Birmingham(96). Mitchell et al (2003) ont élevé ce constat l’échelle nationale en conduisant la première étude de justice environnementale sur l’ensemble du Royaume-Uni (99). Cette étude a mis en exergue une preuve manifeste d’inéquité environnementale en montrant que si les populations défavorisées étaient exposées à de plus forts niveaux de pollution (NO2) sur leur lieu de résidence, elles y contribuaient proportionnellement moins que les populations favorisées, puisque la majorité d’entre elles ne possédait pas de voiture contrairement aux populations favorisées. Plus récemment, ce même auteur a confirmé ces résultats sur la ville de Leeds en démontrant queal proportion de personnes possédant une voiture diminuait avec l’augmentation des concentrations de NO2 et celle du niveau de défaveur (100). Finalement, en 2006, Chaix et al ont investigué les différences socio-économiques dans l’exposition d’enfants âgés de 7 à 15 ans aux conce ntrations de NO2 modélisées sur leur lieu de résidence ou à leur école dans la ville de Malmö, en Suède (97). Les auteurs ont mis en évidence une augmentation régulière de l’exposition au NO sur le lieu de résidence et à l’école des enfants, depuis les quartiers de résidence dans lesquels le revenu médian était le plus élevé jusqu’à ceux dans lesquels le revenu médian était le plus faible.
Comparaison des études et problèmes méthodologiques
Malgré le consensus quasi unanime pour reconnaître l’existence d’inégalités sociales d’exposition aux nuisances environnementales, la comparaison des études et la généralisation de leurs résultats d’autres territoires sont encore rendues difficil es par le manque d’homogénéité méthodologique encadrant cette problématique (66,76,103,104). Dès1995, Perlin et al évoquaient que les résultats des études de justice environnementale étaient fortement dépendants de plusieurs paramètres. Dans une récente revue de la littérature sur la justice environnementale, Bowen (2002) a repris l’ensemble de ces facteurs et conclu que la non prise en compte de leur influence dans les études publiées rendaient non comparables et non généralisables la plupart des résultats trouvés (66). Parmi les facteurs susceptibles de modifier les résultats étaient évoqués :
◦ L’unité géographique d’observation ;
◦ La méthode statistique ;
◦ L’estimation de l’exposition et le type de nuisance environnementale ;
◦ L’indicateur du niveau socio-économique.
En effet, il a été précédemment démontré que le ixchode l’unité géographique d’observation pouvait fortement influer sur les résultats (70,101). Par exemple, Bowen et al (1995) ont rapporté une association positive entre les minorités ethniques (population noire et/ou hispanique) et les émissions toxiques à l’échelle ducounty alors qu’ils ne rapportaient aucune association à l’échelle du census tract (70). De même, il a été démontré que, selon l’indicateur socio-économique utilisé (76) ou le type de nuisance considéré (98), les résultats d’une même étude pouvaient être différents. Par exemple, Perlin et al (1995) ont trouvé que les minorités ethniques étaient plus sujettes en moyenne à vivre dans des comtés avec de plus fortes émissions toxiques et qu’en même temps le revenu annuel du foyer apparaissait plus élevé dans ces comtés (76). De nouveau, la taille de l’unité géographique d’observation était mise en cause pour expliquer ces résultats.
Les limites énoncées par Bowen, quant à la généralisation des résultats des études de justice environnementale, suggèrent que seule une démarcheordonnée évaluant par une même approche méthodologique l’influence de différentes nuisancesenvironnementales, différents indicateurs socio-économiques et différentes unités géographiques permettrait d’avancer dans la réflexion et la compréhension des inégalités environnementalesCette. logique est exactement celle suivie par une équipe anglaise dans un très récent article paru dans Social Science and Medicine (105). Dans cette étude, les auteurs ont suivi le même plan d’analyse statistique (analyse bivariée et multivariée) pour explorer l’influence d’une multitude de paramètres parmi lesquels de nombreux risques environnementaux (pollution atmosphérique, trafic, sources électromagnétiques, trihalométhanes dans l’eau de boisson, radon domestique, sources de pollution industrielle, etc.) mesurés selon trois types métriques (proximité, émissions, concentrations), plusieurs indicateurs socio-économiques (indice composite, revenu, emploi, éducation, etc.) et différentes échelles géographiques. Les résultats rapportés ont montréueq les associations entre les nuisances environnementales et le niveau socio-économique variaient selon le choix du type de nuisance, la métrique utilisée et l’indicateur du niveau socio-conomiqueé retenu. De manière globale, les associations étaient plus fortes pour des mesures liées à la pollution atmosphérique (émissions et concentrations) et tendaient à être plus faibles pour les mesures liées à la proximité. Par ailleurs les associations devenaient également plus fortes avec l’augmentation de la taille du niveau géographique.