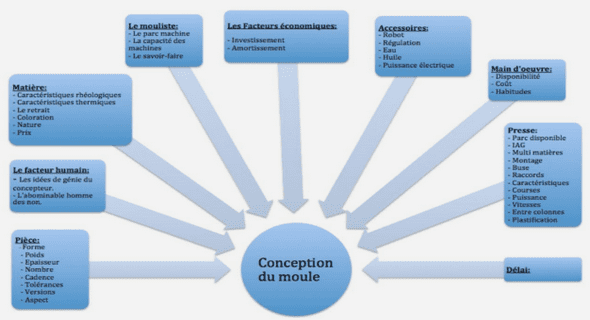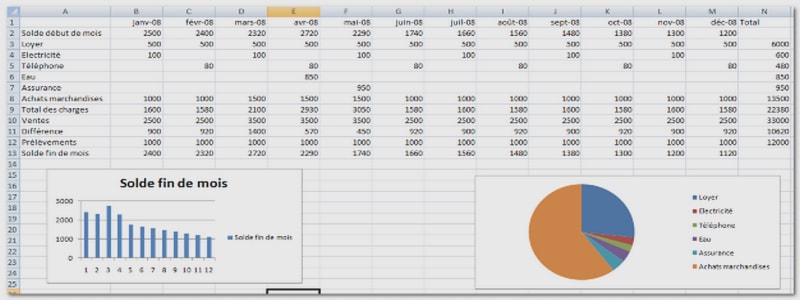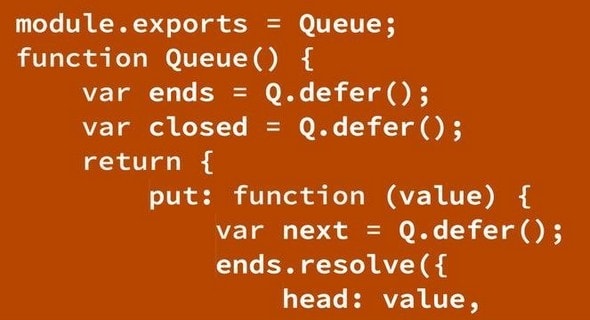Phénotypes et activité de la SEP
Les formes de SEP
Deux évènements peuvent être distingués en SEP : la poussée et la progression1. La poussée est définie comme l’apparition de nouveaux symptômes, la réapparition ou l’aggravation de symptômes déjà existants (Thompson et al., 2018). Les poussées durent au minimum 24 heures. Après une poussée, le patient peut récupérer entièrement ou seulement partiellement. Pour être distinctes, deux poussées doivent débuter à plus de 30 jours d’intervalle.
La progression est définie comme l’apparition continue des symptômes au long cours.
A partir de ces deux évènements, deux formes de SEP peuvent être distinguées (Lublin et al., 2014) : la forme avec poussées ou rémittente et la forme progressive, soit d’emblée ou secondaire à un début rémittent appelée forme secondairement progressive (Figure 4).
La forme avec poussées ou rémittente est caractérisée par l’apparition de poussées successives, pouvant laisser des séquelles ou non, sans progression de handicap entre les poussées (Lublin et al., 2014). Cette forme est la forme la plus répandue puisqu’elle représente 85% à 90% des SEP. Elle débute chez le jeune adulte et prédomine chez la femme avec un sex-ratio de 3 femmes pour 1 homme1.
La forme d’emblée progressive est marquée par des symptômes insidieux, s’aggravant et conduisant ainsi à l’apparition progressive d’un handicap sans poussée surajoutée (Lublin et al., 2014). Elle représente 10 à 15 % des SEP. Cette forme de SEP débute plus tard que la forme avec poussées et touche, dans une même mesure, les hommes et les femmes.
La forme secondairement progressive est caractérisée par une phase initiale de poussées.
Lors d’une seconde phase de la maladie, on observe une progression du handicap, parfois marquée par des poussées surajoutées suivies de rémissions minimes, puis une phase de plateau (Lublin et al., 2014).
Pour évaluer l’activité de la SEP, l’imagerie à résonnance magnétique (IRM) est utilisée pour décrire les lésions et le handicap est mesuré. Dans la SEP évoluant par poussée, la description des poussées, que ce soit en termes de fréquence, de sévérité ou de phénotype est également utilisée.
Activité IRM
L’IRM permet de localiser les lésions responsables des symptômes. Grâce à l’IRM, on mesure l’ampleur de la maladie par l’évaluation de la charge ou du volume lésionnel (Granziera et al., 2017). Les lésions sont caractérisées par leur localisation, leur taille et par l’intensité de leur signal.
Elles peuvent parfois être mises en évidence par l’utilisation d’un produit de contraste, comme le gadolinium, qui permettra d’identifier les lésions récentes (Figure 5). L’IRM fournit également des éléments concernant la perte ou la réparation tissulaire.
Des IRM cérébrales ou encéphaliques et médullaires peuvent être pratiquées. Elles fournissent des informations nécessaires, voire primordiales, à la prise en charge d’un patient que ce soit au moment du diagnostic ou au cours de son suivi notamment pour évaluer l’évolution de l’activité de la maladie et la réponse aux traitements (Tintore et al., 2015; Papeix, 2017) (Papeix, 2017).
Activité clinique : le handicap
Les évolutions cliniques spécifiques de la SEP ont imposé un langage particulier pour décrire le handicap. L’échelle de Kurtzke (Kurtzke, 1983) est communément utilisée par les neurologues pour coter le handicap. Avec cette échelle, appelée EDSS pour « Expanded Disability Status Scale », le niveau de handicap est ainsi résumé par un score global synthétisant l’évaluation individuelle de divers systèmes fonctionnels. Ce score global évalue l’importance du handicap de 0 (examen neurologique normal) à 10 (décès lié à la SEP).
Les paramètres fonctionnels évalués sont les fonctions pyramidales (i.e. la motricité), cérébelleuses (i.e. équilibre et coordination des mouvements), sensorielles ou sensitives, cérébrales ou mentales, sphinctériennes et visuelles. Le détail de leur évaluation est disponible en annexe A. L’échelle de cotation globale y est également présentée. Selon le niveau du handicap, on notera que son évaluation est dominée par certains paramètres fonctionnels (Edan, 2017). Elle est d’ailleurs très influencée par le périmètre de marche à partir du score 5. Parmi les scores marquants et fréquemment utilisés dans les études, on peut citer le niveau d’EDSS 3 qui correspond à une atteinte minime de 3 paramètres fonctionnels (3 fonctions à 2 points, les autres à 0 ou 1 ou bien une fonction à 3 points les autres à 0 ou 1). Ce niveau est décrit comme le début d’un handicap sans conséquence sur la vie quotidienne (Leray et al., 2010). A ce niveau de handicap, le patient n’est pas limité dans son périmètre de marche mais ne peut en revanche plus courir. Toujours à titre d’exemple, le score EDSS 6 correspond à la nécessité d’utiliser une aide unilatérale, de façon quasiment constante, pour parcourir 100 m sans s’arrêter ou le besoin d’une aide bilatérale pour parcourir plus de 100 m.
Le handicap est ainsi mesuré de manière longitudinale au cours du suivi du patient. Il peut être évalué de manière ponctuelle en notant, le cas échéant, la proximité d’une poussée qui peut accentuer les troubles et donc surévaluer le handicap réel du patient.
Des scores de handicap confirmés (i.e. mesurés à distance les uns des autres) et maintenus (i.e. persistants jusqu’aux dernières nouvelles) fourniront une évaluation de l’accumulation du handicap ou du handicap résiduel. Notamment, un score de handicap confirmé à 6 mois et maintenu jusqu’aux dernières nouvelles est appelé irréversible (Confavreux et al., 2003).
Cette échelle présente l’avantage de fournir une évaluation chiffrée du handicap permettant d’étudier la progression du handicap d’un patient mais également de comparer les patients entre eux.
Etiologie de la SEP
Epidémiologie de la SEP
Depuis les années 90, le nombre de cas de SEP en France n’a cessé d’évoluer. La première étude, menée à partir d’un questionnaire que les personnes étaient invitées à remplir suite à un appel donné à la télévision, a conduit à établir une première estimation de prévalence entre 30 et 40 pour 100 000 (Lhermitte et al., 1988). Finalement, l’étude la plus récente, à partir des données de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, a utilisé un algorithme multicritère basé sur le statut d’affection longue durée et les remboursements d’un traitement ou d’un acte lié à la SEP, comprenant les hospitalisations. Cette étude a conduit à une estimation de 151.2 pour 100 000 correspondant à 99 123 cas de SEP en France (Foulon et al., 2017). L’évolution de la prévalence au cours du temps peut certainement être le résultat d’un meilleur comptage mais également d’une mortalité moins importante. On ne peut pour autant exclure une effective augmentation de l’incidence de la SEP (Browne et al., 2014). La dernière étude d’incidence en France, datant de 2012, a permis d’estimer l’incidence nationale entre 2001 et 2007 à 7.6 pour 100 000 (Fromont et al., 2012).
Au niveau européen, la prévalence s’élève à 700 000 cas de SEP. A l’échelle du monde, elle est estimée à 2.5 millions (Browne et al., 2014). Sa répartition est marquée par un gradient augmentant avec l’éloignement de l’équateur1.
L’étude de la mortalité a conduit à montrer que les patients atteints de SEP avaient un risque similaire de décès pendant 20 ans suivant le début de la maladie en comparaison à la population générale. Cette même étude a montré que l’espérance de vie serait réduite de 7 ans chez les patients atteints de SEP, toujours en comparaison à la population générale (Leray et al., 2015). Dans 50% des cas, le décès était lié à une complication de la maladie. Les autres causes sont principalement des maladies cardiovasculaires, des cancers et des suicides.
Génétique et environnement, quels sont les facteurs associés à la SEP ?
La SEP est une maladie multifactorielle. Sa survenue est inexpliquée mais la génétique et l’environnement sont souvent évoqués comme des causes potentielles (McKay et al., 2017).
Sur le plan génétique, certains gènes semblent être liés à la SEP en particulier présents dans la région HLA (antigène des leucocytes humains), en charge de la gestion de l’immunité (Brassat, 2017). De plus, des études ont montré un risque plus marqué d’avoir une SEP dans les familles dont un des membres est atteint. On note tout de même que le risque d’avoir une SEP chez les jumeaux monozygotes, lorsque l’un est atteint, est de 30%. Cet argument a tendance à contester l’argument de l’hérédité de la SEP.
Outre la prédisposition génétique qu’on ne peut exclure, les disparités géographiques de prévalence et de risque laissent penser que des facteurs environnementaux peuvent également être associés (Pantazou et al., 2017). Les habitudes de vie, l’ensoleillement, et certaines maladies sont évoqués comme potentiels facteurs de risque d’avoir une SEP. En particulier, on retrouve la consommation de tabac active ou passive, la vitamine D, l’obésité pendant l’enfance et l’adolescence. On notera également que 100% des patients atteints de SEP présentent une séropositivité au virus Epstein Barr.
Prise en charge de la SEP
Les multiples expressions de la SEP conduisent à une prise en charge pluridisciplinaire des patients. Bien que plusieurs professionnels interviennent dans la prise en charge du patient, l’un des principaux acteurs est le neurologue, expert de cette pathologie neuro- dégénérative (Papeix, 2017). Son travail est aussi complété par celui du médecin généraliste. Ils interviennent dès le début de la maladie. Le médecin généraliste observe souvent les premiers symptômes, le neurologue formule le diagnostic. Au cours du suivi, le médecin généraliste aura en charge le suivi régulier et rapproché du patient, notamment vis-à-vis des symptômes liés à la SEP. Le neurologue, quant à lui, sera consulté moins souvent, une fois par an étant recommandé (Lublin et al., 2014). Il est le seul à pouvoir prescrire les traitements de fond de la SEP que nous présenterons dans la section suivante.
Le neurologue peut exercer en cabinet libéral ou dans le secteur hospitalier. Il existe des centres experts, aussi appelés CRC SEP pour Centre de Ressources et de Compétences SEP, dans les Centres Hospitalo-Universitaires. Les centres experts proposent une prise en charge d’abord médicale, mais également médico-sociale. Ils sont aussi reconnus pour leurs travaux de recherche et d’innovation scientifiques (Derache et al., 2018).
Certains patients sont suivis exclusivement ou régulièrement dans ces centres. En revanche, les patients peuvent aussi venir consulter le centre expert ponctuellement. En effet, de par l’expertise du personnel de centre, les patients ou les neurologues non experts de la SEP sont amenés à consulter le centre pour un avis ponctuel, pour une confirmation de diagnostic ou un avis sur l’instauration d’un traitement de fond par exemple. Dans ce cas, les neurologues des centres experts recevront le patient et la suite de la prise en charge pourra être poursuivie à l’extérieur du centre. Le niveau d’expertise aux centres et leur rattachement à des centres hospitaliers universitaires, peuvent marquer la patientèle de ces services. De fait, la consultation d’un expert peut parfois témoigner d’une forte activité ou d’un avancement de maladie. Pour autant, ce n’est pas le seul profil de SEP dont sont atteintes les personnes consultant le centre expert.
Comme nous l’évoquions précédemment, d’autres professionnels de santé peuvent être impliqués dans la prise en charge des patients. Ils interviennent dans le cadre des traitements des symptômes liés à la SEP et pour accompagner les patients à vivre avec leur pathologie.
On citera notamment les médecins de spécialité physique et réadaptation (MPR), les kinésithérapeutes, les ophtalmologistes, les orthophonistes, les urologues, les psychiatres, psychologues ou neuropsychologues.
Enfin, les infirmiers, acteurs principaux de l’éducation thérapeutique, jouent un rôle majeur dans la prise en charge des patients. L’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Ils peuvent, par conséquent, intervenir à différent moments. Lors du diagnostic, ils pourront apporter des explications complémentaires à celles déjà fournies lors de la consultation avec le neurologue. Ils aideront aussi en informant les patients sur la reconnaissance des poussées et la gestion de la maladie au quotidien (Higue-van Steenbrugghe, 2016). Egalement, ils accompagneront les patients dans la prise du traitement que ce soit dans l’explication des différents traitements ou pour l’administration.
Dans cette première partie, nous avons évoqué, parfois simplement, les données qui nous apparaissaient importantes pour la suite de ce travail. La SEP est une maladie complexe dont la connaissance est en constante évolution. Qu’il s’agisse de connaissances fondamentales, cliniques ou techniques, elles modifient la prise en charge de la maladie, impactant la pratique des professionnels associés et marquant la vie des patients. Parmi ces évolutions, l’une des plus marquantes de la prise en charge concerne le développement de traitements spécifiques à la SEP. Au moment de ce travail, les traitements disponibles dans la SEP étaient adaptés seulement aux formes de SEP à début rémittent (une poussée ou plus). Dans la suite, nous nous y réfèrerons comme SEP rémittente. Pour rappel, cette forme est la plus répandue.
Les traitements de fond de la SEP rémittente
Le premier traitement de fond spécifique à la SEP rémittente est disponible depuis le milieu des années 90 en France et dans de nombreux pays du monde. Depuis, l’arsenal thérapeutique a évolué largement avec désormais une quinzaine de traitements de fond disponibles. La connaissance de la balance bénéfice/risque se clarifie et l’intérêt de traiter un patient atteint de SEP apparait essentiel. Ces avancements ont conduit à faire évoluer les stratégies de prise en charge des patients.
Généralités sur les traitements de la SEP rémittente
Il n’existe pas de traitement curatif de la SEP. Pendant plusieurs années, seuls les symptômes ont pu être traités. Ces traitements symptomatiques sont nombreux et variés du fait de l’expression multiple de la maladie. On peut par exemple citer la rééducation pour les troubles de la marche, mais également certains traitements médicamenteux comme l’amantadine ou le modafinil contre la fatigue (Clavelou et al., 2017). Parmi les traitements proposés à un patient atteint de SEP, on retrouve également les corticoïdes proposés en cas de poussée1. Ils ne sont pas prescrits systématiquement mais ils permettent d’accélérer la récupération de la poussée. Ces traitements ne présentent pas d’effet sur la prévention du risque de survenue de poussée.
Après plusieurs années d’utilisation de divers traitements n’ayant pas démontré leur efficacité, l’histoire des thérapeutiques dans la SEP est marquée par le développement, au milieu des années 90, du premier traitement de fond spécifique, l’interféron-β (The IFNB Multiple Sclerosis Study Group, 1993). Les traitements de fond agissent sur la composante inflammatoire de la maladie. En interférant avec le système immunitaire, ils ont pour but de réduire la fréquence des poussées et de ralentir la progression du handicap. Il peut en être distingué deux familles : les immunomodulateurs et les immunosuppresseurs. Cette distinction n’est pas toujours évidente. Dans la thèse, nous évoquerons plutôt les traitements selon leur ligne d’intention thérapeutique, les regroupant en deux familles : traitements de première ligne et les traitements de deux et troisième lignes. Dans le groupe des deux à troisième lignes, certains traitements ont des positionnements discutés. Notons que la SEP peut également être traitée en ayant recours à la transplantation de cellules souches hématopoïétiques autologues (AHSCT). Ce type de recours apparait dans des cas particuliers où les traitements médicamenteux ne fournissent pas satisfaction au regard de l’activité de la SEP. Dans cette thèse, nous n’aborderons pas cette option et nous nous concentrerons uniquement sur les traitements médicamenteux.
Dans chacune des familles, plusieurs substances actives sont disponibles. On compte en 2019, 13 traitements disponibles. La représentation de l’historique de la disponibilité de ces traitements de fond témoigne de la diversification de l’arsenal thérapeutique au cours du temps (Figure 6). Les données de prescriptions issues de données médico-administratives (SNDS) portant sur 112 000 patients présentées en Figure 7 indiquent la place non négligeable qu’empruntent les nouvelles thérapeutiques dès leur disponibilité (Roux, 2018).
Zoom sur les traitements de première ligne
Le premier traitement spécifique SEP est l’interféron béta-1b (Betaferon® et Extavia®)), suivi du bêta-1a (Avonex® et Rebif®). Ce n’est que depuis peu qu’une forme pégylé est disponible (Plegridy®). Les traitements interférons bêta-1a et 1b sont des immunomodulateurs. Ils agissent sur la diminution du nombre de lymphocytes et de leur activité (Vermersch and Schluep, 2017). Ils sont présentés sous forme injectable et s’administrent en sous-cutanée ou intramusculaire à l’aide de seringue ou stylo pré-remplis. Selon la spécialité, le médicament doit être pris une à trois fois par semaine ou tous les deux jours. La forme pégylé est un interféron-β modifié présentant une action prolongée. Sa fréquence d’injections est bimensuelle après une phase de mise en place avec des injections rapprochées. Les interférons bêta -1b ont démontré leur efficacité sur le plan clinique et IRM (The IFNB Multiple Sclerosis Study Group, 1993). Une réduction de 32% de la fréquence des poussées a été observée en comparaison au placebo. L’activité IRM était aussi diminuée dans le groupe traité par interféron bêta-1b. En revanche, le risque de progression du handicap n’était pas significativement modifié par le traitement. Les essais thérapeutiques conduits sur les interférons bêta-1a ont corroboré ces résultats en ajoutant une réduction du risque de handicap (Jacobs et al., 1996; PRISMS, 1998). En ce qui concerne la tolérance, les interférons-β présentent un profil plutôt satisfaisant avec des effets secondaires jugés légers ou d’intensité modérée (Vermersch and Schluep, 2017). Les effets secondaires parfois observés peuvent être des syndromes pseudo-grippaux, des ecchymoses au niveau des zones d’injections et des dépressions.
Suite à l’interféron-β et présentant le même mode d’action, l’acétate de glatiramère (Copaxone®) est arrivé sur le marché avec une première spécialité disponible en janvier 20021.
A l’instar de l’interféron-β, l’acétate de glatiramère est un traitement immunomodulateur qui agit sur l’orientation des cellules immunitaires (Vermersch and Schluep, 2017). Ce traitement est présenté sous forme injectable également. Il s’administre quotidiennement en sous-cutanée à l’aide d’une seringue pré-remplie. L’acétate de glatiramère a démontré son efficacité au travers d’essais thérapeutiques randomisés, notamment sur la réduction de la fréquence des poussées diminuée de 29% par rapport au groupe placebo (Johnson et al., 1995; Comi et al., 2001b). La différence sur le risque de progression du handicap n’était pas significative. Plus tard, une démonstration de son bénéfice sur l‘activité IRM a aussi été faite (Comi et al., 2001b). Ce traitement présente un bon profil de tolérance avec peu de toxicité et des effets indésirables rares, décrits comme peu sévères (Vermersch and Schluep, 2017).
Ce n’est que plusieurs années plus tard, en 2014, que l’offre de traitements de première ligne s’est complétée avec l’arrivée de deux traitements : le tériflunomide (Aubagio®) et le diméthylfumarate (Tecfidera®). Leur particularité est leur voie d’administration puisqu’ils s’administrent par voie orale. Le tériflunomide a démontré son efficacité dans les essais cliniques (O’Connor et al., 2011; Confavreux et al., 2014). Cette substance présente un profil de tolérance généralement bon mais est rigoureusement contre-indiquée pendant la grossesse. (Vermersch and Schluep, 2017). Le diméthylfumarate a démontré son efficacité sur la réduction des poussées, ainsi que sur le risque de progression et l’activité IRM (Fox et al., 2012; Gold et al., 2012). Il présente également un profil de tolérance satisfaisant marqué tout de même par des troubles digestifs et des bouffées de chaleur (Vermersch and Schluep, 2017).