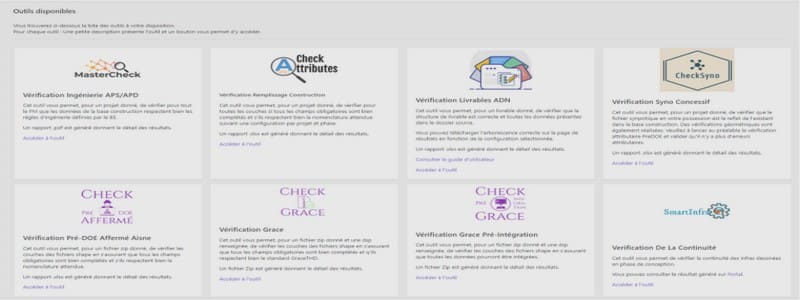Les sociétés savantes : incontournables acteurs institutionnels
Pour mieux comprendre le rôle des sociétés savantes dans la mécanique institutionnelle propre au Midi de la France – sous-entendu ici le « grand sud-ouest » et dont nous avons pris Toulouse comme point central – il convient de proposer une présentation de ce que peut être un tel groupement au XIXe siècle. Son histoire, sa structure, son fonctionnement sont en effet autant d’aspects qui permettent d’appréhender ses apports et sa place au sein du tissu institutionnel régional et national, et notamment pour la période durant laquelle la préhistoire se trouve quelque peu en marge de la cité scientifique.
Pour le premier membre de cette partie, qui concerne surtout les aspects relevant d’une présentation, du fonctionnement et des activités des sociétés savantes, il nous faut d’emblée signaler ici que nous nous sommes largement appuyé sur l’étude récemment publiée par le phénomène à échelle nationale. Le premier de ces travaux, et quoique ne couvrant que très partiellement la période observée par notre propre étude puisqu’il concerne principalement la première moitié du XIXe siècle, nous a en effet semblé particulièrement bien documenté sur de nombreux aspects que nous souhaitions observer afin d’apporter des éléments de réponse à des problématiques soulevées par notre propre étude. Ce décalage chronologique n’a d’ailleurs que peu d’impact sur ce que nous allons présenter plus loin puisqu’il s’agit essentiellement de données concernant des registres d’observations relativement stables ou n’ayant que peu varié (histoire, fonctionnement général etc.). Seules les données chiffrées ont bien sûr évolué. C’est aussi pourquoi, sans aucune prétention de réécrire cette sociologie des groupements savants toulousains, nous emprunterons fréquemment, en conjugaison bien sûr à d’autres sources, des informations extraites de cet ouvrage, publication d’une thèse de doctorat de troisième cycle soutenue en 2000 à Toulouse.
A l’issue de cet examen, nous pourrons proposer un regard plus précis sur le dynamisme intellectuel régnant au sein de ces compagnies, leur production, leur place dans le développement plus général des sciences, et de la science qui nous intéresse ici. Nous pourrons également évaluer dans quelle mesure elles accompagnent la progressive reconnaissance des sciences anthropologiques et celle de la communauté préhistorienne, en particulier au travers de l’exemple singulier de l’Association française pour l’avancement des sciences.
« L’orage révolutionnaire »4 ; quelques éléments d’histoire et de géographie des sociétés savantes françaises au XIXe siècle
Durant la tourmente révolutionnaire, nombre de sociétés savantes et académies sont mises à bas. En effet, le décret de la Convention nationale du 8 août 1793, « portant suppression de toutes les académies ou sociétés littéraires patentées ou dotées par la Nation », prévoit leur dissolution complète ainsi que la confiscation de tous leurs biens jusqu’à nouvel ordre. Jardins, bibliothèques et cabinets sont ainsi confiés au nouveau pouvoir « jusqu’à ce qu’il en ait été disposé par les décrets sur l’organisation de l’instruction publique »5. En mettant fin à ces activités, c’est un rude coup qui est porté à la vie culturelle parisienne comme provinciale où certains de ces groupements sont implantés depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Souvent désigné dans les traditionnels historiques des sociétés en question, ce décret incarne, pour une majorité, l’arrêt de mort d’une certaine sociabilité et d’un bouillonnement intellectuel vivace en interdisant réunions, séances publiques et autres concours.
Qu’en est-il en réalité ? Ce décret, certes très nuisible, fatal même à la poursuite de leurs activités, est-il seul en cause dans ce dépérissement, dans cet anéantissement de la vie intellectuelle organisée au sein de ces compagnies ?
Un naufrage annoncé
En fait, et comme le souligne Jean-Pierre Chaline, ce que ce décret supprime, la Révolution et son climat d’instabilité, de bouleversement politique et intellectuel s’en étaient déjà chargés. C’est en effet à la fin des années 1780 que débute réellement la perte de vitesse d’abord, puis le rapide déclin de ces sociétés d’érudition, alors qu’un vent nouveau souffle sur les esprits et que les préoccupations de ceux qui donnaient jusqu’alors vie à ces groupements ont déjà, et ce depuis plusieurs années, bien changé. Ensuite, et c’est là encore un facteur déterminant pourtant systématiquement tu par les hagiographes des académies, davantage préoccupés dans leurs mémoires par la restauration d’un faste passé ou la glorification d’une époque révolue, la plupart des adhérents ou des participants, sinon la totalité, sont alors des nobles, des notables locaux ou de riches propriétaires que la Révolution a, pour beaucoup, mis en fuite, voire pire. Enfin, il ne faut pas négliger le relatif confort financier que pouvait leur assurer le pouvoir sous l’Ancien Régime, pouvoir qui délivrait également les lettres patentes de ces organes et qui, en leur apportant ce soutien financier, trouvait là une occasion de faire rejaillir sur lui le prestige véhiculé par ces associations de lettrés. Ces soutiens furent évidemment dissous en même temps que la royauté. Sans ces subsides, sans la reconnaissance d’une autorité tutélaire, il devenait donc difficile de maintenir toute activité en leur sein6.
A Toulouse, à la veille des évènements révolutionnaires, et bien que subissant le même sort que toute société savante française à ce moment, les trois seules académies d’Ancien Régime tentent tant bien que mal de maintenir une activité normale. Il s’agit de la vénérable Académie des Jeux Floraux, fondée en 1323, de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-lettres, qui reçoit ses lettres patentes en 1746 et de l’Académie des Arts, reconnue à partir de 1750. Comme l’indique Caroline Barrera dans son étude sur les sociétés savantes toulousaines, ces trois groupements ont vécu différemment les évènements de 1789, avec un sort commun cependant, celui d’une dissolution nette mais non définitive pour deux d’entre elles.
L’Académie des Jeux Floraux, sommée en 1790 par la ville de faire présider ses séances publiques par des officiers municipaux, refuse de se soumettre et parvient cette même année à contourner les exigences de la nouvelle municipalité en tenant séance publique sans la présence desdits officiers. Dès janvier 1791, les dotations de la ville lui sont coupées et les clés de l’Hôtel de ville – où elle tient séances – confisquées, elle tiendra sa dernière séance en avril. Le décret de 1793 n’est donc pour rien dans sa dissolution, déjà effective.
L’Académie des Arts adopte une attitude radicalement différente de celle des Jeux Floraux face au nouveau régime politique révolutionnaire. Effectivement présidées par les officiers municipaux, les séances publiques de 1790 semblent se dérouler dans un climat de conciliation.
Peut-être un peu intéressée par le maintien de ses subventions, l’Académie va même jusqu’à réformer sa structure pour la rendre plus conforme aux prérogatives révolutionnaires de la municipalité, plus égalitaire donc. Malgré cette attitude de concorde, après « une période de relâchement dans l’assiduité et de scission dans les rapports académiques »7, elle semble cependant cesser toute activité à la fin de l’année 1791. Là encore donc, le décret de 1793 n’est pas passé, le souffle révolutionnaire l’y a devancé.
Enfin, l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-lettres semble, après une entente avec la ville à propos des officiers, et au prix d’une volontaire mise à l’écart du terrain politique dans ses séances, avoir maintenu une activité relativement normale. A partir de 1791 toutefois, ses subventions lui sont retirées et elle doit, pour continuer d’exister, mobiliser ses propres subsides. Elle se maintient cependant, même après que le Club des Jacobins lui ait demandé de modifier son intitulé en « Société des Amis des Sciences et des Arts ». Composant avec le pouvoir afin de préserver son intégrité intellectuelle et sa dynamique de production, elle finit par être dissoute par l’application du décret de 1793 et ses biens lui sont également confisqués, comme le prévoit l’article II dudit décret.
On le voit, trois attitudes différentes, opposées parfois, ont effectivement mené à une fin identique. Pourtant dans deux cas sur trois, cette disparition n’est pas directement à imputer ce décret de la Convention, pourtant émis à cette fin. L’effort alors réalisé dans le sens d’une victimisation des sociétés, d’une mise à mort par un décret assassin tel que décrit par les chroniqueurs de ces sociétés, doit donc être nuancé par les faits historiques. Certes, la société d’érudits, institution dépeinte comme « très considéré[e] »8, au rôle social par ailleurs indéniable ou « très florissant[e] »9, a de façon certaine payé son tribut face aux grands bouleversement sociaux et politiques propres à l’élan révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle. Comme le précise J.-P. Chaline, « l’époque révolutionnaire a constitué le pire moment dans l’histoire des sociétés savantes, avec une tentative de liquidation qu’elles ne devaient jamais oublier », c’est pourquoi on retrouve dans les historiques ou annuaires de ces sociétés ces longues énumérations où fleurissent les « métaphores de la catastrophe »10.
Mais le fait est que leur déliquescence était déjà en marche et qu’au-delà de simples réunions
d’amateurs des arts ou des Belles-lettres, de poètes improvisés ou d’érudits divers, c’est davantage vers des organes hérités d’un Ancien Régime désormais ennemi des valeurs nouvelles, et vers des pratiques jugées « dérisoires »11 en ces temps de trouble que sont portées les véritables attaques.
La « renaissance »
La rupture est toutefois de courte durée puisqu’un décret de la Constitution de l’an III précise que « les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d’éducation et d’instruction, ainsi que des sociétés libres pour concourir au progrès des sciences, des lettres et des arts »12. J.-P. Chaline souligne que vers 1810, on en dénombre une centaine en France dont environ 85 en province. Dix ans plus tard, elles sont environ 130 sur le territoire et cette croissance, quoique connaissant des phases d’accalmie, demeure régulière jusqu’au milieu du siècle où on en compte 310 en 1846, dont une cinquantaine dans la capitale.
A Toulouse, sous le Directoire et le Consulat, ce sont donc trois nouvelles sociétés qui voient le jour : le Lycée (1797) qui deviendra en 1803 l’Athénée, la Société d’Agriculture (1798) et la Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie (1801). Sous le Premier Empire, cinq apparaissent encore, avec notamment le rétablissement de l’Académie des Jeux Floraux (1806), celle de l’Académie des Sciences Inscriptions et Belles-lettres (1807), la création d’un Gymnase Littéraire (1806-1807 ?) dont on sait très peu de choses, une Société de Jurisprudence (1812) et la Société des Beaux-arts (1814). Cette période semble donc correspondre non pas à une phase de créations de nouveaux groupements mais davantage à la reconstitution de sociétés héritées de l’Ancien Régime13. Cinq sociétés sont également créées sous la Restauration dont une nouvelle et éphémère Société de Jurisprudence (1816), la réapparition de l’Académie des Arts (1817) dont l’activité semble avoir été inexistante en dépit de sa résurrection, la Société de Pharmacie (1821) qui échoue également, une troisième Société de Jurisprudence (1822) sans plus de succès que ses devancières ainsi qu’une Société des Bonnes Études (1823) de courte durée également puisqu’elle s’éteint en 1830. Sous la Monarchie de Juillet, trois sociétés apparaissent, la réputée et toujours active Société archéologique du Midi de la France (1831), une quatrième Société de Jurisprudence (1838), plus durable, et une Société d’Observation médico-chirurgicale. Deux groupements voient également le jour sous la Seconde République, une Société d’Émulation et de Prévoyance des Pharmaciens de la Haute-Garonne (1849) ainsi qu’une Académie de Législation (1851). Enfin, trois nouveaux corps de ce type apparaissent sous le Second Empire, la Société médicale d’Émulation (1852), la Société d’Hydrologie médicale du Midi (1853) et une Société d’Horticulture (1853).
Ce ne sont donc pas moins de dix-huit nouvelles sociétés qui naissent dans la première moitié du XIXe siècle avec, bien sûr, et comme nous l’avons rapidement évoqué, un certain nombre d’échecs, de tentatives avortées, de bilans nuls ou de groupements à l’activité obscure ou inexistante. Pour cette période, qui se situe hors des cadres chronologiques de notre étude proprement dite, nous n’irons pas plus avant dans l’analyse du fonctionnement sociologique des organes en question, renvoyant à l’étude de C. Barrera précédemment mentionnée.
A l’échelle nationale, la poussée du début de siècle se poursuit donc régulièrement et traverse la seconde moitié de la période. Mais c’est surtout à partir du dernier quart du XIXe siècle qu’elle est la plus spectaculaire avec plus de 200 créations entre 1875 et 1885, date à laquelle on en dénombre 560 en Province et environ 120 à Paris. Le mouvement semble s’affaiblir dans la dernière décennie pour se réduire progressivement à partir du début du XXe siècle. La guerre franco-prussienne soldée par la défaite française a, de façon certaine, joué un rôle dynamisant dans cette formidable accélération. Les sociétés, comblant alors les lacunes d’un système d’instruction académique défaillant et insuffisamment pourvu (cf. infra : 1.3) – raison évidente de l’échec pour une majorité d’instruits –, ont alors assumé la fonction de diffuseurs de savoirs, notamment scientifiques. La constitution de nouvelles élites sociales n’est certainement pas non plus étrangère à cet élan, l’homme de la classe moyenne se cherche en effet une place au sein de ces groupements autrefois réservés à une catégorie sociale bien plus élevée. J.-P. Chaline évoque à ce propos un mimétisme social motivé par le prestige que génèrent de telles activités savantes14. Enfin, la forte poussée du positivisme et son rôle dans le développement de divers champs de savoir, et notamment scientifiques, favorise une recrudescence de ces groupements érudits en particulier ceux ayant comme centre d’intérêt l’Histoire naturelle ou, un peu plus tard, l’anthropologie. À tel point que les sociétés deviennent, dans ce dernier quart de siècle, parmi les principaux véhicules de cet axe idéologique.
La seconde moitié du XIXe siècle à Toulouse est également marquée par cet élan avec notamment la création, en 1866, de la Société d’Histoire naturelle, une Société de Sciences Physiques (1872), la Société de Photographie (1875), une Société de Pharmacie du Sud-ouest, résultat d’une fusion en 1880 de l’Union des Pharmaciens, fondée en 1878, et de la Société d’Émulation et de Prévoyance des Pharmaciens de la Haute-Garonne citée plus haut. En 1882 naît également la Société de Géographie. Trois nouvelles sociétés littéraires voient également le jour durant la période, l’Académie poétique du Mont-Réal de Toulouse en 1881, la Muse toulousaine en 1886 et la Muse républicaine en 1889.
Dans l’ensemble, on observe donc une première phase, débutée sous le Directoire, qui se caractérise essentiellement par la reformation d’anciens groupements, et ce constat est valable pour la capitale comme pour la Province. C’est le cas notamment à Toulouse, où renaissent deux des principales académies existant avant 1789 et supprimées durant l’épisode révolutionnaire. La restauration de ces anciens organismes s’accompagne de la création dans les villes de grande et moyenne importance d’une apparition de sociétés aux dénominations et aux intérêts similaires, affichant alors la recherche d’un prestige perdu depuis la rupture révolutionnaire, que certaines n’ont d’ailleurs jamais connue.
Ce mouvement s’achève autour de 1820, date à laquelle débute une période où fleurit un autre type de sociétés aux préoccupations plus ciblées, plus spécialisées, prenant même parfois des airs de corporation professionnelle, comme ce peut être le cas avec les groupements de pharmaciens ou de médecins. Pendant cette période également, et dans la suite des traditionnelles « sociétés linnéennes »15, on assiste à l’éclosion des premières sociétés d’histoire naturelle où trouvent place des domaines en plein essor comme la botanique, la paléontologie ou la géologie. Toujours dues pour partie à l’initiative de naturalistes, les sociétés d’histoire et d’archéologie, auxquelles viennent s’ajouter les commissions diverses ayant pour but la protection et l’étude du patrimoine historique, occupent une part grandissante au sein des compagnies créées sous la Restauration. Jean-Pierre Chaline estime leur proportion à 10% environ sur la période, et au quart des créations sous la Monarchie de Juillet16.
Vers la fin du siècle, le développement puis l’avènement des différents domaines scientifiques voient la multiplication et une spécialisation accrue de ces sociétés qui se consacrent à des études et travaux de physique, de chimie ou d’industrie en général. Les sciences naturelles demeurent aussi en bonne posture durant la décennie 1875-1885. Le mouvement de création, comme nous l’évoquions plus haut, semble pourtant s’essouffler après 1890 pour retomber progressivement après 1900. Comme le précise J.-P. Chaline, il faut y voir là une baisse effective du référencement de ces organismes par le Comité des Travaux Historiques et Scientifiques notamment qui répertorie ces créations et disparitions. Ce serait également là la conséquence de négligences croissantes de la part même de ces sociétés pour figurer dans les listes du Comité et acquérir ainsi un statut officiel. Ce même auteur évoque également la possibilité d’une baisse d’intérêt du public pour ces organisations devenues quelque peu désuètes, « victimes de leur propre succès »17. Mais il apparaît très probable également que, suffisamment dotées de ces sociétés et académies diverses, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, les zones observées aient connu une baisse de leur multiplication parallèlement à un gonflement de leurs effectifs, accroissement par ailleurs noté par J.-P. Chaline18.
Au-delà d’un fait de « renaissance », il s’agit donc bien là, pour la seconde moitié et le dernier tiers du siècle surtout, de l’explosion d’un phénomène animé par les modes propres aux différents temps durant lesquels il s’épanouit de façon toujours régulière, avec bien sûr selon les préoccupations du moment, des périodes de recrudescence ou de ralentissement. Le conflit de 1870-71 semble cependant avoir fortement attisé cet élan et attribué à la décennie 1875-1885 le record du siècle, notamment dans les domaines scientifiques.
Pour compléter ce tableau général des sociétés savantes françaises au XIXe siècle, un examen de leur répartition à échelle nationale nous permettra de mettre en évidence des foyers régionaux et d’observer ainsi le positionnement du midi toulousain au sein de ce tissu culturel que constituent sociétés et académies savantes durant la période étudiée.
Cartographie sommaire
Là encore, pour cet examen de la répartition spatiale du phénomène, nous nous sommes principalement référé à l’étude qu’en a menée J.-P. Chaline à échelle hexagonale. Et pour rappeler l’intérêt d’une telle étude, celui-ci insiste d’emblée sur l’indépendance de la Province par rapport à ce qui se met conjointement en place dans la capitale. Ce serait en effet, d’après cet auteur, mal interpréter les faits que d’observer la restauration ou la création d’organismes dans les départements comme une imitation ou la reproduction d’un phénomène parisien. Nous verrons par ailleurs, lors d’un examen plus précis du phénomène, que s’affirme à ce moment au sein de ces groupements une réelle volonté de décentralisation, confirmant alors la revendication d’une singularité et d’une autonomie provinciale en matière d’érudition.
Dès le milieu du siècle en effet, se distinguent, en Province, des foyers de forte activité culturelle. Alors que certaines zones demeurent réfractaires à l’expression de cette sociabilité savante, les départements du centre notamment, d’autres secteurs montrent déjà un fort dynamisme intellectuel qui se manifeste par l’émergence de structures relativement stables et actives. Une frange nord-nord-est apparaît ainsi avec plusieurs villes comptant 4 à 7 de ces sociétés ou académies, c’est le cas dans les départements du Calvados, de la Seine-Maritime, de la Somme ou du Nord. J.-P. Chaline souligne le cas d’Amiens qui en dénombre 5 ou ceux, plus remarquables encore, de Rouen et Caen, déjà dotées de 10 de ces organes. Pour le cas de Caen, on peut évoquer ici la grande influence d’Arcisse de Caumont (1801-1873), historien et archéologue local qui favorisa l’essor de ces organes en fondant la Société des Antiquaires de Normandie et la Société linnéenne de Normandie dès 1824, ainsi que la Société Française d’Archéologie en 1833. Philanthrope renommé, il encouragea un cénacle de savants locaux à s’intéresser et à s’investir dans l’étude, la conservation et la promotion d’un patrimoine historique local19.
Face à cette zone des bords de Manche, on note également le cas des zones frontalières d’Alsace et de Lorraine ainsi que des régions Franche-Comté et Bourgogne, avec d’identiques proportions, autour de 4 à 5 groupements pour les villes de Strasbourg, Nancy, Besançon ou Dijon.
Des agglomérations de plus grande importance figurent bien sûr en bonne place comme Marseille ou Bordeaux, toutes deux en possèdent en effet 8, ou Lyon qui domine ce classement des métropoles avec déjà 15 sociétés en ce milieu de siècle et faisant figure de capitale provinciale pour le phénomène observé.
J.-P. Chaline signale également le cas de la Bretagne où d’autres départements voisins, dont le patrimoine historique est notable et où l’on dénombre déjà plusieurs sociétés d’histoire ou d’archéologie, implantations souvent liées d’après cet auteur à la présence de petits comités de protection ou de valorisation du patrimoine local. La Bretagne péninsulaire fait cependant exception à cette règle, notamment par un important taux d’instabilité de ces compagnies (plus de 75% d’échec, de tentatives rapidement avortées, ou d’inactivité. Il en va de même pour la Vendée, vierge de toute implantation de ce type.
Contrastant avec ce dynamisme localisé, on note également que les régions encore pauvres en organismes de ce type au milieu du siècle le demeurent sur l’ensemble de la période, c’est le cas des Landes, de la Bretagne péninsulaire donc, de la vallée du Rhône ou des départements du sud du Massif Central, pour lesquels la société locale, quand elle existe, demeure un exemple unique, un cas isolé sur la centaine d’années observée. Cette rareté s’explique cependant certainement par la faible peuplement de ces zones rurales.
A l’inverse, des métropoles comme Lyon ou Bordeaux ne cessent de voir le nombre de leurs groupements croître jusqu’à la fin de la période. Et tandis que la première demeure bien en tête du classement et connaît, jusqu’au premier tiers du XXe siècle, un phénomène d’essaimage dans les villes alentours, la seconde continue de concentrer toutes les sociétés du département, exerçant ainsi un « monopole » de cette sociabilité érudite.