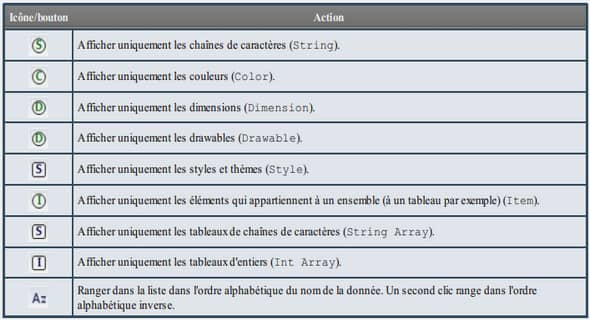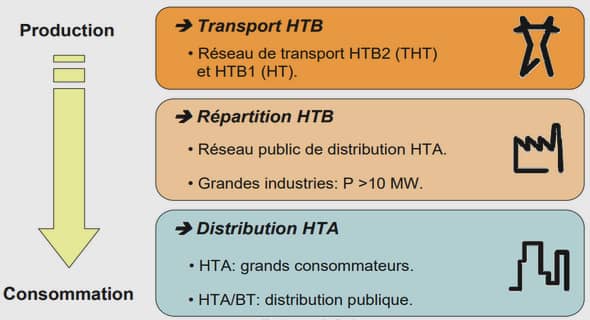Entre l’école et l’entreprise, la discrimination
ethnico-raciale dans les stages
Usages sociaux des marques du stigmate et saillance des frontières : la part de l’interaction
L’élaboration sociologique de la notion de stigmate doit beaucoup au fameux livre éponyme d’Erving Goffman. Elle y est définie dans une approche interactionnelle de la production et surtout des usages des statuts sociaux disqualifiés ou infâmants103. Goffman reprend cette notion pour qualifier « un attribut qui jette un discrédit profond, mais il faut bien voir qu’en réalité c’est en termes de relations et non d’attributs qu’il convient de parler »104 ; c’est en fait une attribution qui, une fois incorporée, confirmée et rejoué dans les rapports sociaux, prend valeur d’attribut. Celui-ci soutient un principe de distribution des places (par exemple selon une « division du monde en lieux interdits, ouverts et réservés »105), mais aussi des codes et des rôles dans les interactions. Calqué sur les conventions du face-à-face entre « normaux » et « stigmatisés », ces rôles sont incorporés (non sans tensions) sous la forme d’« identités sociales », à laquelle sont attachées des qualités morales, et des attendus. Les attentes et la pression normative contraignent certes tous les acteurs, mais de façon plus fermée pour les stigmatisés (sauf à se retrouver « entre eux »), avec des variations selon d’autres éléments de coordonnées sociales (la place dans la hiérarchie sociale, notamment). E. Goffman s’intéresse tout particulièrement aux diverses gammes de réaction des normaux et des stigmatisés, ces derniers étant généralement contraints à choisir entre se conformer et/ou « se faire petit » – réactions les plus fréquentes, ou à l’inverse (sur)exposer les marques du stigmate : jouer au « bouffon », ou réinvestir, éventuellement sur la scène collective-politique, les marques dans la présentation publique de soi. Ces deux dernières « tactiques » impliquent de réinvestir le stigmate, d’en « codifier »107 relativement les marques pour élaborer expressément la frontière. Ces analyses, bien connues, peuvent utilement étayer cette recherche sur les processus de gestion des frontières et des statuts ethnico-raciaux, qui peuvent être assimilés à un stigmate108. Je montrerai toutefois que la problématique de la discrimination appelle un cadre conceptuel un peu différent, et s’attache particulièrement aux stratégies inégalitaires de gestion du stigmate par les normaux. L’approche de la stigmatisation montre d’une part le caractère déterminant des interactions, et d’autre part des variations possibles tant dans l’intensité que dans le choix des marques de distinction ethnique. C’est ici la notion de saillance qui peut outiller cette analyse des variations de présentation de soi et de définition des autres, et plus généralement de « négociation des identités »109. Si l’on admet que les identités ethniques sont produites dans des interactions dont les logiques s’inscrivent plus globalement dans une configuration sociale110, on peut voir que « (…) des traits ou des attributs ethniques (…) se dégage[nt] ) la fois à l’intérieur et à l’extérieur du groupe, du fait des comparaisons inévitables et des subdivisions caractérologiques (…) découlant de la façon dont tous les individus dans une société ethniquement pluraliste se servent du phénomène ethnique pour définir le monde qui les entoure ». Ce sont de telles « mises en relief » variables que désigne la notion de saillance ; ces processus découlent de la rencontre entre, d’une part les mises en regard et les jugements « contrastifs » entre les groupes et leurs membres, et d’autre part, la mobilisation et la valorisation identificatoire de traits divers utilisés pour représenter une identité individuelle et/ou groupale, la construire et l’adapter (selon les groupes, les situations, les moments, les enjeux etc.). Finalement, dans le cas de construction politique des identités, ces éléments rendus plus ou moins saillants deviennent « autant de marques d’une culture politique de groupe et autant de sources d’affinités et d’aliénations ». Au final, donc, on peut dire que « la saillance ethnique caractérise la validité sociale de l’ethnicité, saisie à la fois comme produit et comme condition de l’interaction ».
Le rôle des institutions dans la production des frontières et des statuts ethnico-raciaux
Le rôle des institutions, et notamment de l’Etat, est déterminant dans la production et l’imposition des statuts ethnico-raciaux, et dans la production des frontières ethniques. Cela à deux niveaux. D’abord, les institutions participent le plus généralement de fonder des catégories qui servent de marqueurs de statut dans l’ordre social et de références identificatoires. « En marquant ses propres frontières [la communauté instituée] influence tous les niveaux inférieurs de la pensée, de telle sorte que les gens aient conscience de leur propre identité, et se classent mutuellement en fonction de leur affiliation à la communauté » Les catégories ethnico-raciales en font partie, les institutions étant au principe de leur élaboration, que ce soit dans la genèse « des races », celle des catégories de gestion coloniale, etc. Les statuts ethnico-raciaux font partie des catégories de gestion, et les institutions ne cessent de les rendre disponibles et de les opérationnaliser, dans la mesure où leur limite et leur ordre même en dépendent. La discrimination est ainsi une forme de gestion ethnico-raciale visant à estaurer des frontières au moment où précisément elles s’estompent, et où l’ordre menace de se modifier. Ces pratiques sont soutenues par les catégories et leurs attributs usuels (préjugés, stéréotypes, etc.) que les institutions participent de diffuser ou d’utiliser pour organiser l’action publique – que l’on pense au traitement des Roms par l’Etat114 ou au statut des « enfants d’immigrés » dans l’institution scolaire (cf. II.3.1). Le second niveau de production institutionnelle des frontières ethniques semble, lui, plus indirect : c’est le résultat paradoxal d’une logique d’assimilation. Dans une société pluraliste marquée par l’asymétrie Majoritaire/minorisés, les dominants ont le monopole de la culture institutionnellement légitime. Les institutions diffusent en conséquence de façon exclusive les codes, normes et symboles115 majoritaires, qui s’imposent aux minoritaires et finissent par investir et modifier de l’intérieur leurs propres référents. Ce qui conduit assez généralement à ce que la sociologie de l’Ecole de Chicago des années 1930 a nommé une « assimilation ». Toutefois, ce modèle, avec sa conception mécaniste du changement, a dû être largement nuancé. L’idée s’est imposée, d’une part que « l’acculturation » (adoption de standards culturels dominants) et l’« assimilation structurelle » pouvaient fonctionner selon des rythmes différents, et d’autre part, que la « société d’accueil » (comme on disait en France dans les années 1990) n’est pas si « accueillante » que cela, car elle impose en réalité des obstacles à l’assimilation, engendrant un processus plus « chaotique » que « linéaire » . C’est en partie la résistance étatico-institutionnelle à une considération égale des divers individus et groupes, allant de pair avec la pression continue en faveur d’une conformation à l’acculturation au groupe dominant , qui renouvelle l’altérité ethnique. Les identifications ethniques peuvent être tenues en large partie comme étant au départ « réactives », puis « distinctives », et finalement il peut en résulter qu’elle finissent par se transmettre comme un « héritage sociologique » . Au moins de façon indirecte, « la délimitation des groupes ethniques, ou l’émergence des frontières, est souvent un produit artificiel de l’action de la communauté politique »119, que ce soit en Amérique de Nord ou en Côte d’Ivoire. Jean-Pierre Dozon a montré, dans ce dernier cas, que « ces références [ethniques] n’acquièrent leur véritable signification qu’au regard d’enjeux nationaux tournant autour du régime et de sa légitimité120 ». La fabrication et l’accentuation des frontières ethniques a principalement à voir avec l’état des rapports de force, et avec des stratégies de modification (ou de maintien) d’un ordre du pouvoir qui protège les institutions. De façon très générale, donc, il est ici important de souligner l’usage stratégique possible des ressources ethniques dans les rapports de pouvoir. La saillance des marques ethniques, l’intensité des frontières, etc. dépendent de ces rapports de force, qui engagent les institutions – on verra ce qu’il en est pour l’institution scolaire. Ce regard général sur les frontières ethniques doit donc être inclus dans un prisme politologique plus large, pour apercevoir le rôle singulièrement déterminant de l’organisation politique étatico-nationale dans la fabrication de l’ethnicité.
L’école publique et l’ethnonationalisme français
L’exemple français est lui aussi très significatif de ces processus. Il se caractérise par un double rapport idéologique, opposé, entre Etat-Nation et appartenance ethnique. Il y a d’abord une relation négative, qui témoigne de l’effet du nationalisme. Reprenant notamment à leur profit l’élaboration sociologique d’une différence entre « communauté » et « société », les définitions politiques de l’Etat-Nation français ont construit le rapport entre Etat et groupes ethniques (ou entre « La Communauté » et « les communautés »), sous la forme d’une radicale polarisation. L’ethnique est alors tenu pour l’opposé moral du national. Le choix de l’une ou l’autre désignation (sup)pose une incompatibilité radicale, une alternative fondamentale : « l’identification nomme par l’identité nationale, sinon elle recourt à des qualifications ethnicisantes ». Si cette opposition asymétrique a une source ancienne dans la classification aristotélicienne entre ethnos et polis, l’asymétrie trouve elle son principe dans le schéma du Grand partage . Le thème de l’ethnique est ainsi toujours rattaché au mineur, à l’impur, au dangereux, à l’archaïque, etc. Et ceci, non seulement dans le discours politique, mais également dans une majeure partie de la littérature scientifique . La seconde face du rapport idéologique entre Nation et « ethnie » est plus souterraine. Elle fait l’objet d’un oubli125. C’est le fait qu’une relation positive unit ces deux termes – relation qui ne se réduit pas aux rapports entre nationalisme et racisme. C’est l’idée que la Nation a des « origines » dans tel ou tel peuple, que la France a au fond existé avant la France, transcendant et annulant les discontinuités historiques. Le terme d’ethnonationalisme qualifie ce lien imaginaire formant un « Nous » national de référence ethnique. L’adjonction du qualificatif ethnique à l’idée de nationalisme rappelle « la parenté entre nation et groupe ethnique, en même temps que le caractère tout à fait original de la nation, car ses caractères ethniques sont en bonne part le produit d’une réflexivité politique126 ». Max Weber et Marcel Mauss, déjà, avaient souligné le caractère de croyance de ce lien127. De façon très sensible en France, la représentation de l’Etat-Nation est en effet dossée à un vieux fond d’imaginaire ethnique, lové au creux de l’identité nationale.128 Ce lien positif entre Etat-Nation et catégorisation ethnique trouvera à s’appliquer en pratique dans l’histoire des politiques publiques, de la colonisation aux immigrations et jusqu’à la politique « d’intégration » à la fin du XXème siècle. Ces applications pouvant d’une certaine façon trouver des prolongements contemporains dans les manifestations de grands « conflits ethniques »129. L’école publique en France, historiquement réélaborée à la fin du XIXème siècle pour soutenir l’ancrage politique de la République, est au cœur de ce processus – j’y reviendrai (chap. II.4). Cette idéologie ethnonationaliste forme d’une certaine façon une trame de fond pour la représentation scolaire. Il s’agira plus avant de voir en quelle mesure la définition locale des situations est susceptible de recourir à cet imaginaire. I.3. Eléments pour une sociologie des frontières L’ethnicité n’étant qu’une des modalités de construction et de fonctionnement des frontières, je voudrai la situer dans des processus plus généraux. L’idée de frontières veut indiquer une lecture topologique de la gestion des statuts sociaux. Celle-ci servira à la fois d’indicateur pour une recherche des pratiques de traitements de type discriminatoire, et de concept opératoire souple pour réfléchir, à partir de l’espace scolaire et de ses symboliques, les formes variables que peuvent prendre les processus d’ethnicisation (et plus largement de minorisation). Je poserai en premier lieu quelques balises pour donner forme à un concept général de frontières (I.3.1.). J’insisterai ensuite sur les activités normatives de production et de gestion de celles-ci, activités de gestion de l’ordre que je définirai comme police (I.3.2).
Les frontières : éléments d’une topographie politique et morale
Une frontière est généralement définie comme la « limite d’un territoire qui en détermine l’étendue » (dictionnaire Le Grand Robert, 2001). Cette définition réduit l’idée de frontière à la seule fonction de clôture. Elle est en outre rivée à une approche territoriale, qui peut donner de la question une conception restrictive. Certes, cette notion est spontanément référée à la géographie, qui fournit évidemment matière à réflexion ; en outre, elle parle le langage de la topographie, dans le sens où la notion de frontière nous projette dans une représentation spatialisée du monde. Mais la définition géographique n’est qu’une forme particulière d’un processus d’expérience universel de distribution dans l’espace social et de configuration de celui-ci. Comme l’avait souligné déjà Georg Simmel, « si cette notion universelle de limitation réciproque est tirée de la frontière spatiale, celle-ci n’est pourtant, plus profondément, que la cristallisation ou la spatialisation des processus psychiques de délimitation, seuls effectifs. (…) La frontière n’est pas un fait spatial avec des conséquences sociologiques, mais un fait sociologique qui prend une forme spatiale ». La question de la ségrégation urbaine/scolaire, dans le domaine qui nous occupe, en est une illustration, j’y reviendrai (I.6.2). L’idée de frontière est une notion proprement métaphorique, au sens simmelien d’une forme générale qui est aussi concept mobile : on le retrouve dans divers domaines, et il autorise de circuler entre eux. Si la langue anglaise est plus fine, en distinguant la démarcation entre des territoires (borders), et une distinction entre des ensembles (boundaries), l’intérêt de l’idée générale de frontière est justement la mise en équivalence de formes et de processus qui organisent très généralement le monde, les rapports sociaux et les interactions sociales.
INTRODUCTION |