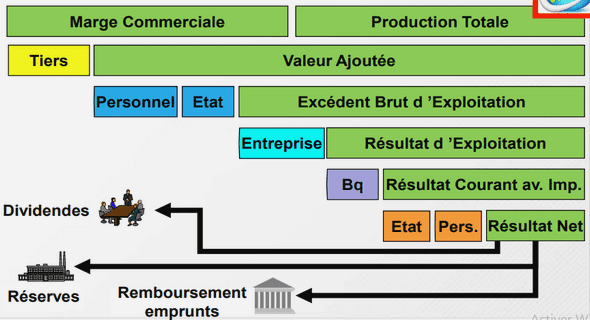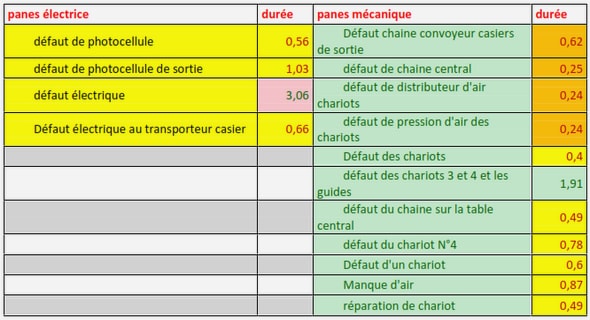Evolution d’une région littorale en crise
Le système écoloeigue des dunes l>lanches
Il s’agit d’un ensemble large de quelques centaines de mètres disposé parallèlement à la côte entre Kayar et l’ embouchure du fleuve Sénégal. Ces dunes sont fom1ées de sables fins, résultat de la dé flation éolienne effectué~ par la dérive à partir de la haute plage. Généralement nues en raison d ‘ un horizon très pauvre et du milieu hostile, les dunes blanches chevauchent les fomiations plus anciennes situées vers l’intérieur du continent. Elles couvrent, de la sorte, progressivement, le massif des dunes jaunes. Le système comporte trois variantes topographiques correspondant chacune à une unité écologique de base. a. L’unité écoloeique de base des dunes blanches externes C’est une théorie de dunes étroite au tracé parallèle à la côte. Elle constitue, entre Toula et Fass Boye, une structure d’un seul tenant dont la largeur n’excède pas 500 m. Tous les éléments de la toposéquence se caractérisent par une géodynamique intense que tente d ‘atténuer la fixation par une bande de filaos. On la retrouve au Nord entre Tioucougne et Mboumbaye, sur 45 km de longueur pour une profondeur de 500 men moyenne. Les sols très peu évolués, n’autorisent qu’un maraîchage fort marginal pratiqué au niveau des ndioukis littoraux. b. Les dunes blanches médianes C’est un couloir exigu sous fonne de légère dépression à l’abri et sous le vent des dunes blanches externes. La largeur n’excède pas 500 m. Le relief peu prononcé est le résultat à la fois d’une déflation éolienne à l’origine d’une évolution négative par érosion l’ayant 59 pénéplané, d’une part ; d’autre part, la pratique du maraîchage, assez soutenue, ~contribué à accentuer la pénéplanation en direction des pentes les moins prononcées. c. Les dunes blanches internes Cette unité écologique correspond à la partie la plus continentale des dunes blanches, en contact avec le système des dunes jaunes. Elle se distingue par une toposéquence à deux éléments, les crêtes dunaires et les espaces déprimés interdunaires. Aucun de ces types écologiques n’étant fixé par la végétation, l’unité connaît dans l’ensemble une géodynamique intense qu’ illustre sa transgression actuelle vers le système des dunes jaunes. Elle comporte par ailleurs, à l’échelle des Niayes du Nord, une légère nuance géographique, car peu vigoureux au Sud de MBoro, elle connaît un développement important entre MBoro et Fass Boye sur une profondeur oscillant entre 300 et 400 m. Au-delà de Fass Boye, elle prend la forme d’un espace éclaté en 6 enclaves perdues dans la dune jaune voisine. 2. Un système écoloeique à part: la terrasse deltaique Il constitue un espace de transition entre les Niayes proprement dites et le domaine fluviodeltaïque. S’étendant sur 1278 ha de superficie entre l’axe Potou-Léona et Mboumbaye, il court sur 8 km pour une profondeur moyene del,5 km. C’est une surface plane légèrement inclinée vers le Nord et l’Ouest. Egalement appelée terrasse nouakchottienne, notamment par A. Ndiaye ( 1975), elle a été formée au maximum de la transgression du même 11011127. En pénétrant dans le continent, la mer a arasé les dunes ogoliennes dont le matériel a été repris, broyé, puis déposé sous forme de terrasse. Ainsi, produit de l’interaction terre-mer, la terrasse est constituée de sables coquiliferes à fo.rte teneur arca. Elle encadre, en les surplombant, un réseau de dépressions occupées pendant l’hivernage par des marigots. 7 – A. Ndiaye ( 197 5), Le Gandiolais, ! »estuaire du Sénégal, la Langue de Barbarie : étude géomorpho logique, P. 40. 60 Paragraphe 2. Une occupation humaine très tardive
Le rôle de la bioeéoeraphie
Avant 1 ‘occupation humaine et surtout avant la dégradation écologique consécutive à la sahélisation, la végétation des Niayes avait une toute autre allure. C. Parillaud ( 1959) dit, parlant de cette végétation, qu’elle « prend souvent l’aspect d’un maquis impénétrable.» Les rives des « lacs, poursuit-il, sont livrées à une végétation dense qui prend l’aspect d ‘une_ jungle 9 )> De plus, les Niayes étaient infectées de mouches tsé-tsé et fréquentées par les fauves. Dès lors, il n’est pas surprenant que les grandes migrations qui ont dépeuplé la vallée, devenue instable entre Je XIe et le XUe siècle, aient ignoré la Grande Côte dans leurs mouvements vers le Sud. Ces agriculteurs et pasteurs habitués à un milieu fluvial hospitalier n’étaient pas am1és pour affronter la jungle des Niayes. Même si dans leur descente vers le Sud les vagues Sérères ont côtoyé sans doute le littoral Nord, au moment de choisir les sites d’implantation, les plus proches des Niayes – les Ndoutcs, Nones et autres Séréres Safénes – ont préféré les abords du plateau de Thiès biogéographiquement plus accueillant. ~~ – Si l’occupation humaine est tardive par rapport à rhistoire récente des Niayes, il n’en est pas de même si l’on se place à l’échelle préhistorique. (Exposition pennanente département Préhistoire-Protohistoire IF AN). li est attesté en effet. que les fonnatio11s dunaires de ! ‘Ouest du Sénégal recèlent les vestiges témoignant d’une présence humaine au néolithique. li est possible de distinguer deux catégories de vestiges. D’ une part, un outillage microlithique dont le matériau de base est le silex. Les pièces se présentent sous de faibles dimensions excédant rarement 30 mm. Les mieux représentés sont les microlithes en fait des déchets de fabrication des précédentes. L’autre catégorie de vestiges néolithiques se trouve être des objets en céramique comportant trois types : des poteries ovoïdes fréquentes surtout dans la région de Dakar ; le second type, comparable au premier présente toutefois un décor d’ondulation au peigne. Il est présent sur les sites de!: environs de Thiès. Le troisième type est fonné par des poteries ovoïdes à col redressé et à ouverture large. Les datations au radiocarbone, en donnant des résultats très étalés dans le temps (40, 1084 et 2322 avant notre ère) montrent que l’occupation humaine de l’espace dunaire remonte au Tafolien. Nous ajoutons que probablement, les auteurs de cette industrie néolithique abondante et variée ont d’abord été attirés par la morphologie post-nouakchottienne faite de profusion de lagunes favorable à la pêche et par la proximité d’ une végétation de type guinéenne propice à la cueillette et à la chasse. Dans la même logique, leur départ pourrait, entre autres hypothèses, s’ expliquer par l’acidification du climat ayant suivi la transgression nouakcholtienne et qui a vu le début de la mise e·n place des dunes vives actuelles. 9 – C. Parillaud (1959). Etude sur les Niayes. 61 Autant dire que jusqu’au XVIe siècle, les Niayes étaient un espace vierge. Cela est du reste attesté par la toponymie ainsi que l’ont montré A.T Diaw, A. Bâ et P. N Diaye (1989). En ·. . . effet elles font foison, les localités dont les noms renvoient à la virginité ou à un état sauvage3 ». Tableau 2.- Une toponymie preuve de ,·ide humain Toponymie Signification Bayakh lieu inhabité Gayane endroit touffu Gorba lieu defriché Santhie nouvel emplacement Khongolame lieu de rencontre pour la chasse Golgaïnde repaire des lions Sources: Feuille de Kayar Sans être catégorique sur la chronologie, on peut avancer que cet état de virginité quasi absolue a persisté jusqu’au XVIIe siècle. Les premières implantations humaines furent !’oeuvre des Peuls. li faut préciser qu’à l’origine, la présence peul était temporaire; pendant la saison sèche, les pasteurs peuls quittaient le Djolof’ et nomadisaient jusque dans les Niayes où ils affrontaient la trypanosomiase et les glossines afin de profiter des pâturages luxuriantes et des étendues d’eau pérennes. Toutefois sous l’effet de mutations politico-économiques au Djolof et au Kajor, la transhumance évoluera vers une implantation définitive. Ce n’est pas un hasard si le début de l’immigration peule dans les Niayes a coïncidé avec le règne du Damel32 Lat-Soukabé Fal ( 1697-1719). En effet, ainsi que le montre M. Diouf ( 1986), l’émergence du Kajor en tant qu ‘entité indépendante est« le résultat de l’économie atlantique et de la traite négrière». Jo – A.T. Diaw, A. Ba , P. Ndiaye (1989). Analyse de cartes topographiques du Sénégal. Exemple de la feuille · de Kayar. 1 1 – Royaume traditionnel du sénégal septentrional. 62 Cependant le royaume n’a pleinement profi té de cette nouvelle donne économique qu’ avec l’an-ivée au pouvoir de Lat-Soukabé, fondateur de la dynastie des Guedj33 • Son objectif majeur était de la pérenniser au pouvoir. Il comprit que pour cel a, il fallait s’assurer « un contrôle strict des ressources induites par le commerce atlantique» (M. Diouf, 1986 f~. Une réfom1e politico-sociale fort complexe aboutit à l’émergence des Tiéddos, groupe social et caste militaire tout à la fois. Ils étaient désom1ais le support du pouvoir monarchique. Certes, ils assureront à la dynastie des Guedj la pemianence sur le trône du Kajor. Mais en contrepartie ils s’enrichirent considérablement en s’ investissant dans la traite négrière. Car, faut-il le rappeler, s’ ils n’étaient pas au front, les Tiéddos avai ent le loisir de razzier en toute impunité à travers le royaume. C’ était, pour ainsi dire, leur rétribution en tant que soldats professionnels, élite guerrière à la base de la puissance du Kajor. C’est justement pour fuir ! ‘ insécurité pennanentè installée par les razzias thiéddos que les Peuls du Kajor ont entrepris de se réfugier dans la jungle des Niayes. C ‘est ici qu’apparaît l’ambiguïté biogéographique tantôt affirmée des Niayes; la jungle impénétrable qui autrefois interdisait l’ implantation humaine, vaut désormais aux Niayes d’être un espace-refuge. La densité végétale et la mouche tsé-tsé, ennemi du cheval, sont de nature à protéger les réfugiés contre les cavaliers tiéddos razziant. Ceci est confirmé par la toponymie : Findew, par exemple signifie refuge. Si la totalité de la zone des’ Niayes a connu les mêmes étapes initiales dans l’histoire de l’occupation humaine, -nomadisme temporaire, refuge contre la razzia esclavagiste- par la suite, le Nord et le Sud ont évolué de façon différente. Des nuances, voire des divergences sont apparues dans le processus du peuplement.
Introduction générale |