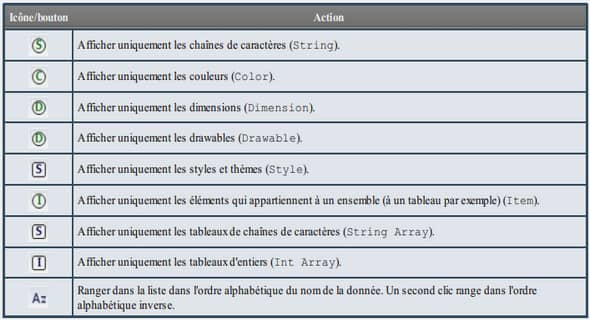Gouverner les institutions par le futur
Les terrains : la prospective au service des régions et des métropoles
Le choix d’un cadre analytique structuré autour du concept d’énoncé d’institution n’est pas sans conséquence sur notre objet de recherche. Il déplace la focale d’analyse de la prospective vers ses utilisateurs, afin d’étudier les transformations des institutions en action. Quels sont les différents usages de ces démarches prospectives par les institutions ? Quelle est la place et la signification des énoncés d’institution qu’elles produisent ? Ce déplacement de la focale sur le travail de définition des institutions par les acteurs eux-mêmes nécessite de cibler davantage les institutions étudiées. Nous avons fait le choix de nous concentrer sur deux niveaux institutionnels : les régions et les métropoles. Cette décision résulte de deux préoccupations distinctes que nous détaillons ci-dessous : une préoccupation empirique d’une part, en suivant le processus de circulation de la prospective en France ; une préoccupation analytique d’autre part, en se focalisant sur deux types d’institutions dont la définition est historiquement instable et incertaine. Fruit d’un cadrage progressif appliqué au fil de la recherche, ce choix comporte un certain nombre de biais qu’il convient d’expliciter et de contrôler, en les mettant en regard avec la question de recherche et les trois hypothèses exposées précédemment. Il inscrit aussi cette recherche dans les différent es littératures académiques portant sur les régions et les métropoles. Capitalisant sur les travaux plus théoriques de sociologie de l’action publique et de sociologie des institutions, cette thèse a en effet pour vocation de dialoguer avec les nombreux travaux sur le « local » (Pinson 2010). En croisant les différents courants de recherche, nous exposons notre lecture des apports, des limites et des angles morts de ces travaux sur les institutions infranationales.
Une préoccupation empirique : à la recherche des institutions utilisatrices de la prospective
Quelles sont les institutions qui ont eu – ou qui ont encore – recours à la prospective ? Cette interrogation empirique apparait comme un préalable pour définir l’objet de notre recherche. Or la réponse à cette question est plus problématique qu’il Introduction – Le futur en pratiques 52 n’y paraît. À notre connaissance, il n’existe pas de recensement exhaustif des démarches prospectives menées en France depuis la diffusion de cette pratique dans les années 196016. Cette absence s’explique par le flou qui entoure la définition de la prospective : quels sont les critères permettant de classer une démarche menée par une institution publique dans la rubrique « prospective » ? L’utilisation du label « prospective » ou la mention explicite du long terme sont-elles des conditions suffisantes ? Si les experts de la prospective consacrent un effort important à codifier cette activité et à en refuser le label à des démarches qu’ils jugent méthodologiquement insuffisantes, nul n’est capable d’établir une liste complète des travaux prospectifs conduits par les institutions publiques. Tout juste peut-on s’accorder sur la place importante qu’y occupent en France les différents niveaux de collectivités, comme en témoigne le succès du terme de « prospective territoriale ». Pour pallier ce déficit de connaissance, nous avons effectué un rapide état des lieux des travaux prospectifs menés par les collectivités françaises durant ces cinq dernières années (2008-2013), à partir du recensement des appels d’offre émis par les collectivités pour assurer l’accompagnement de leurs démarches prospectives. Réalisé à partir de la base d’appels d’offre identifiés par la coopérative – conseil, ce recensement comporte deux biais significatifs : il se limite aux démarches faisant appel à un prestataire extérieur (d’autres travaux prospectifs n’ont pas fait l’objet d’appel d’offre) et exclut les démarches réalisées par les communes et intercommunalités de petite taille. Malgré cela, cet état des lieux, présenté ci-après sous la forme d’un tableau, a pour vertu de mettre en lumière la diversité des utilisateurs de la prospective. Sur les vingt-cinq démarches identifiées, deux ont été conduites au niveau communal, neuf au niveau métropolitain, sept au niveau départemental et sept au niveau régional. S’il confirme l’importance du recours à la prospective par les collectivités, ce recensement ne facilite pas pour autant notre tentative de cadrage des utilisateurs à analyser. Limité à la période récente, il ne permet pas de différencier les institutions infranationales par l’intensité de leur mobilisation de la prospective.internationales, la prospective recouvre des éléments très hétérogènes selon les pays. La difficulté de traduction en anglais du terme de prospective illustre cette difficulté : la prospective correspond-t-elle au foresight, au forecast, au visioning ou au scenario-building ? Ce problème de construction de l’objet nous a conduit à nous focaliser sur le cas français, laissant la comparaison transnationale pour d’autres recherches18 . Au vu de notre question de recherche, il est en outre préférable de réaliser une comparaison entre des institutions relevant d’un cadre institutionnel commun, ce dernier restant encore principalement défini au niveau national. Face à l’absence de recensement suffisamment complet pour nous permettre d’identifier les institutions qui ont le plus mobilisé la prospective, nous avons adopté une démarche socio-historique consistant à suivre la diffusion de la prospective en France. Il s’agit d’exposer le parcours la prospective et ses circulations, pour repérer quelles ont été les premières institutions à se saisir de cette forme d’anticipation. Pour cela, nous sommes repartis des travaux sur l’émergence de la prospective en France, son appropriation par l’appareil d’État et sa diffusion infranationale (Musso 2006; Durance 2007a; Guiader 2008a). Nous reviendrons en détail dans les premiers chapitres de la thèse sur les débuts de la prospective en France et sa domestication par les institutions infranationales. À cette étape du raisonnement, deux éléments méritent d’être soulignés. Premièrement, la diffusion territoriale du recours au futur s’observe dès les premières années de l’apparition de la prospective en France, ce qui justifie de se focaliser sur les institutions infranationales. Deuxièmement, cette diffusion concerne essentiellement les niveaux régional et métropolitain19, du fait de l’association à cette époque entre prospective et aménagement du territoire. La mobilisation de la prospective par les Communes et les Départements s’est faite bien plus tard, au cours des années 1990. Se concentrer sur les régions et les métropoles permet ainsi de tirer parti d’une certaine épaisseur historique dans l’analyse de leur activité prospective. Nous y reviendrons dans les paragraphes suivants consacrés à la comparaison sur la moyenne durée.
Une préoccupation analytique : la focalisation sur des institutions instables et incertaines
Résultant d’une analyse socio-historique du parcours de la prospective, cette focalisation sur les niveaux régional et métropolitain résulte aussi d’une préoccupation d’ordre analytique. Pour mettre à l’épreuve empiriquement notre thèse sur la prospective comme énoncé d’institution, il est en effet intéressant de se concentrer sur des institutions dont la définition pose question. L’élaboration d’un énoncé d’institution à travers la prospective est d’autant plus instructive que la place et la fonction de l’institution font l’objet de controverses et d’incertitudes. Cela explique notre choix de cibler notre travail sur les institutions infranationales en France. Depuis les années 1950, l’organisation territoriale française a subi de nombreuses mutations. Plusieurs réformes nationales successives sont venues modifier le paysage institutionnel français, en créant de nouvelles structures ou en en modifiant les compétences et le cadre juridique. Cet activisme réformiste (Offner 2006) témoigne de l’instabilité des institutions infranationales et du flou qui entoure leur définition. Cette instabilité est renforcée par la situation de concurrence qui existe entre les différents niveaux de l’organisation territoriale française, comme le montrent les auteurs de l’ouvrage consacré aux luttes d’institutions (Gaxie 1997). En dépit (ou à cause) du principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, la réorganisation du paysage institutionnel est toujours considéré par les acteurs comme un jeu à somme nulle. Chaque institution se trouve alors en permanence en situation de devoir justifier son existence et de démontrer son utilité propre, pour évite r sa disparition ou étendre ses prérogatives. Les formes de cette concurrence interinstitutionnelle éclairent aussi le choix des régions et des métropoles. Historiquement (Le Gales 2008), les transformations de l’organisation territoriale française peuvent en effet être appréhendées à partir de l’opposition entre des institutions établies, héritée de la Révolution française et de la IIIe République (la Commune et le Département) et des institutions plus récentes, inscrites dans le projet modernisateur de l’après Seconde guerre mondiale (la Région et l’Intercommunalité). Les travaux de sociologie des organisations des années 1960 consacrés à la mise en place des premières institutions régionales et métropolitaines ont bien mis en lumière les tentatives de neutralisation de ces dernières par l e Introduction – Le futur en pratiques 56 système politico-administratif traditionnel structuré au niveau départemental (Grémion 1965; Grémion 1976; Worms 1996). Dans cet affrontement, les régions et les métropoles sont souvent présenté es comme le futur de l’organisation territoriale. Face à la faiblesse de leur ancrage historique et politique, nous faisons ainsi l’hypothèse que ces institutions en émergence ont mobilisé la prospective comme ressource pour trouver leur place au sein de l’organisation territoriale. Cela expliquerait le faible recours à la prospective aux niveaux communal et départemental jusqu’aux années 199020 . Se concentrer sur les institutions infranationales permet en outre d’interroger la dimension territoriale. L’institutionnalisation de nouveaux niveaux de gouvernement ne se limite pas à une question organisationnelle. Elle recouvre aussi la constitution et la reconnaissance de nouvelles échelles d’intervention publique, face aux territorialités historiques (Négrier et Jouve 1998; Jouve et Lefèvre 2002). L’énoncé d’institution ne porte pas uniquement sur l’organisation politique ; il a aussi pour vocation de faire exister un espace de gouvernement et d’en justifier la pertinence. Sans rentrer dans les controverses scientifiques sur la question du rescaling de l’autorité étatique (Neil Brenner 2004; 2009), il s’agit de reconnaitre que les échelles de l’action publique ne sont pas intangibles. Elles constituent « a space for politics » (Carter et Pasquier 2010), résultant d’un travail permanent, et plus ou moins conflictuel, de territorialisation de l’autorité politique par les acteurs. Au cœur de notre travail, cette question territoriale n’aurait pas été abordée si nous avions focalisé notre recherche sur les démarches prospectives menées par certaines organisations nationales au sein de l’appareil d’État, comme la DATAR ou le Commissariat général du Plan. Si certains travaux récents sur la sociologie de l’État ont montré que son processus de totalisation continue à faire l’objet d’épreuves (Linhardt 2008), celles-ci restent ponctuelles et fragmentées. Les luttes définitionnelles portant sur la fonction de l’État et sur la pertinence de l’échelle stato-nationale sont à la fois moins intenses, plus dispersées et donc plus difficile s à objectiver que pour des institutions politiques encore incertaines comme les régions ou les métropoles.
INTRODUCTION GÉNÉRALE – LE FUTUR EN PRATIQUES 2.2. L’avenir mis en mots : le croisement entre expertise et participation pour |