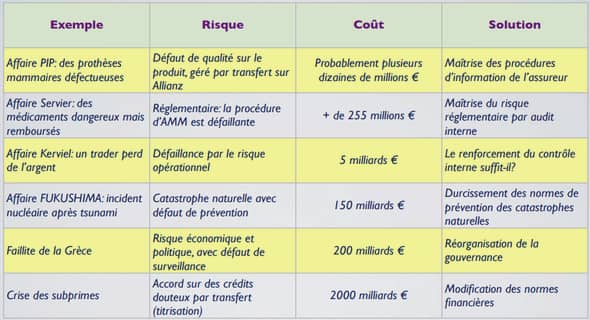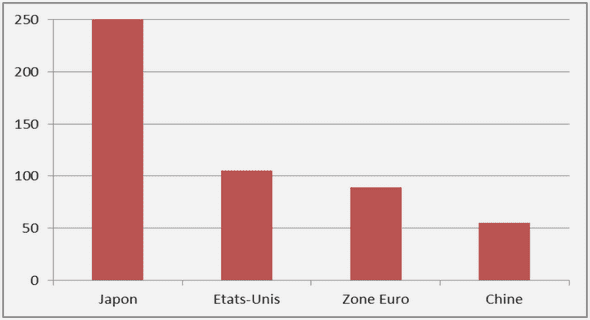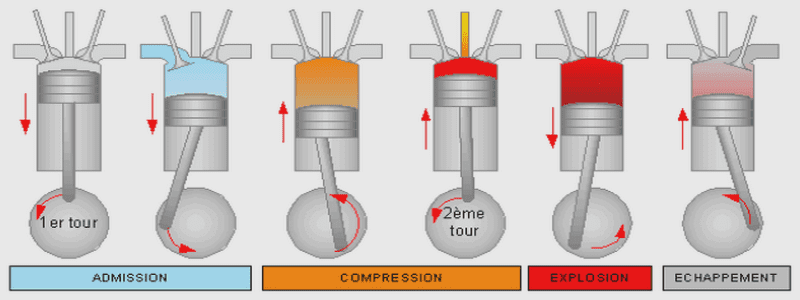Aspects postcoloniaux et féministes
Hybridité
Au lieu du terme de postcolonialisme, Alfonso de Toro préfère le concept de postcolonialité, grâce auquel il veut éviter des « problèmes historiques, ceux d’ordre chronologique ainsi que ceux posés par son origine » (de Toro 2009 : 94). Pour lui, la postcolonialité n’est pas une catégorie historique, mais plutôt : un type de discours stratégique, une méthode, un instrument de réinvention d’un lieu culturel propre, d’un lieu identitaire propre où le principe d’action et l’hybridité n’est pas forcément marqué par la charge historique des individus ou des groupes d’individus ou d’ethnies, mais par la situation présente qui conduit à la formation de diasporas. Dans ces dernières se trouvent des groupes ethniques qui habitent deux ou plusieurs cultures différentes, réalisant des identités ou des légitimités doubles ou triples. C’est dans cette formation diasporique qu’on trouve l’étrangeté local et imaginaire de l’origine de quelqu’un. (de Toro 2009 : 94)
Il ajoute que la postcolonialité résulte de « quatre fondements postmodernes », dont le quatrième est « l’introduction d’un savoir et d’une pensée hybrides » (de Toro 2009 : 94). Selon Alfonso de Toro, le terme d’hybridité réunit les concepts de la postmodernité et de la postcolonialité (de Toro 2008 : 64).
Pour situer son utilisation du terme d’hybridité, Kirsten Husung fait référence aux théories d’Homi Bhabha, selon lesquelles « tous les processus culturels, sociaux et politiques opèrent dans l’ambiguïté », c’est-à-dire qu’il n’existe ni identité originelle ni pureté culturelle (Husung 2014 : 33). De plus, la postmodernité a engendré la réévaluation de concepts tels que la race, le genre et le lieu géographique, les plaçant dans une sorte d’espace « interstitiel » que Bhabha a fini par appeler le « tiers-espace » (Husung 2014 : 33, 35). Selon Bhabha, le tiers-espace entraîne donc « l’hybridité de la culture » puisqu’il s’agit d’un « lieu de négociation et de traduction » (Husung 2014 : 35).
Dans l’œuvre de Beyala, d’autre part, l’idée d’un être « hybride » semble presque avoir quelque chose de péjoratif (Hitchcott 2001 : 183). Pour Beyala, il ne faut pas essayer de réconcilier un choc de cultures en préférant une culture à une autre (acculturation), il faut plutôt parcourir un processus de « transculturation » en passant par le tiers-espace de Bhabha, pour arriver à une position identitaire qui est tout à fait nouvelle (Hitchcott 2001 : 183). Cela signifie que, selon l’œuvre de Beyala, il ne faut pas rester dans le tiers-espace, pour éviter la possibilité de devenir une sorte de « transsexuel culturel » (Hitchcott 2001 : 183).
Féminitude
Christina Angelfors souligne les deux principales pensées binaires qui sont à la base du concept de féminitude, ainsi que la « préoccupation constante de la notion de “différence” – différences entre hommes et femmes, entre Blancs et Noirs, entre l’Europe et l’Afrique » – qui imprègne l’œuvre de Calixthe Beyala (Angelfors 2010 : 35). Angelfors nous rappelle que la théorie sur la différence sexuelle, c’est-à-dire la différence entre l’homme et la femme, oscille traditionnellement entre l’essentialisme et le constructivisme, tandis que le discours sur les différences culturelles repose essentiellement sur la polarité universalisme-particularisme (Angelfors 2010 : 35). Selon Angelfors, l’œuvre de Beyala semble adhérer à la fois et au constructivisme féministe beauvoirien et à un essentialisme qui suppose une différence fondamentale entre l’homme et la femme, que Beyala renforce en se référant au concept de la féminitude, qui est pour elle « un mélange de féminisme et de négritude » (Angelfors 2010 : 39).
Quant à la différence culturelle, Angelfors soutient que l’œuvre de Beyala reflète souvent l’universalisme, ce que Beyala a souligné elle-même dans un entretien accordé la revue Amina, en disant : « On n’est pas Africaine par rapport à sa couleur de peau. On est Africaine parce qu’on a une culture africaine » (Angelfors 2010 : 40 ; Beyala 2005). En même temps, selon Angelfors, Beyala « constate l’échec de l’universalisme à la française qui, dans son désir d’assimilation, n’a fait qu’imposer ses propres valeurs » (Angelfors 2010 : 41). De plus, Angelfors note que l’œuvre de Beyala semble se méfier de nouveau du concept d’hybridation, craignant la disparition de la culture noire face à la dominance de la culture blanche (Angelfors 2010 : 42). Pour éviter cela, il faudrait revendiquer les différences culturelles, les particularités, « dans l’espoir précisément d’obtenir l’égalité » (Angelfors 2010 : 47).
En revendiquant les différences identitaires, l’œuvre de Beyala semble à peine rentrer dans le mouvement de déconstruction faisant partie du poststructuralisme (Culler 2016 : 193). Toutefois, ni la revendication de Beyala, ni la déconstruction poststructuraliste ne semblent avoir atteint leurs buts, car les inégalités et les oppositions binaires persistent.
La méthode
Notre approche méthodologique sera en partie générique (Valette 2011), se concentrant d’abord sur les caractéristiques du sous-genre littéraire qu’est le roman d’apprentissage. En comparant les éléments caractéristiques de ce sous-genre, tels qu’ils ont été définis par Pierre Aurégan (1997), nous essayerons de répondre à notre première question de recherche, en examinant comment cet ouvrage de Beyala les suit ou s’en écarte. Puis, pour répondre à notre deuxième question de recherche, nous procéderons à l’analyse de la fonction littéraire des personnages masculins, pour voir si leur rôle est accessoire et donc si la représentation des sexes dans cet ouvrage est simplement inversée par rapport au roman d’apprentissage traditionnel. Pour ce faire, nous nous servirons également de concepts liés à la théorie postcoloniale et féministe, tels que l’hybridité et la féminitude.
Analyse
Les liens avec le roman d’apprentissage
L’héroïne
La narratrice éponyme du roman de Beyala se présente ainsi au lecteur : C’est par le plus grand des hasards que je suis née dans un village cocorico-misérable, ce même hasard qui fait qu’on naît riche ou pauvre […] Je suis fille unique. Je n’ai pas de père, du moins personne ne connaît son identité sauf maman éventuellement, à moins que je ne sois l’œuvre de l’Esprit saint. (Beyala 1994 : 12)
Tout d’abord, contrairement aux caractéristiques du roman d’apprentissage traditionnel français données par Pierre Aurégan (1997 : 38), le héros du roman de Beyala est une femme noire, une héroïne. Néanmoins, nous remarquons qu’il s’agit bel et bien d’une jeune personne, dont la structure familiale est marquée par une absence parentale, comme l’a prédit Aurégan (1997 : 38-39).
Évidemment, les origines sociales de l’héroïne ne sont pas celles de la bourgeoisie provinciale française selon Aurégan (1997 : 39), mais plutôt celles d’un peuple rural africain, habitant un pays jadis colonisé par la France. De plus, nous doutons que l’héroïne ait vraiment le même « désir de reconnaissance » décrit par Aurégan (1997 : 38), car c’est le personnage d’Awono, qui Assèze présume est son père illégitime, qui l’amène à sa maison à Douala pour lui donner une meilleure vie et qui décide tout pour elle juste avant et après son départ du village et, ce n’est qu’après la mort de ce bienfaiteur qu’Assèze commence à prendre son propre destin en mains : Pendant ces neuf jours de deuil, je me recroquevillai dans le malheur. Je me décomposais, pas uniquement à cause de la mort d’Awono mais parce que j’ignorais ce que j’allais faire désormais de ma vie. […] Je pris une carte du monde. Je l’étalai devant moi. Je ramassai un stylo rouge. Je traçai une ligne droite Douala-Paris. – Voilà ce que je vais faire ! dis-je. (Beyala 1994 : 208-209)
Ensuite, Assèze se montre de plus en plus résolue, disant durant une pause dans son itinéraire à Dakar : « Je dois continuer ma route. […] Tout ce que je sais, c’est qu’ici, ce n’est pas un endroit pour moi » (Beyala 1994 : 213). Elle avait déjà appris en Afrique que le monde est réglé par des intérêts individuels et l’argent, donc il faut prendre en considération son temps dans la maison d’Awono pour pourvoir suivre la voie d’échecs et de résignations qui doit constituer son apprentissage selon Aurégan (1997 : 40).
Par rapport à la façon dont elle est traitée par sa « sœur » Sorraya, la fille légitime d’Awono avec laquelle elle habite dans la maison de ce dernier à Douala, l’installation d’Assèze à Paris semble relativement indolore. Arrivant à la capitale clandestinement avec très peu de moyens, elle réussit après quelques négociations à se trouver un logement chez madame Lola et ensuite, elle se fait accepter par ses colocataires, une petite bande d’immigrantes qu’elle appelle « les Débrouillardes ». Grâce à elles, Assèze trouve un emploi dans l’atelier de monsieur Antoine et, plus tard, commence à travailler en tant que voyante freelance dans l’immeuble de madame Lola. Ensuite, grâce à ses retrouvailles avec son ancien amant, Océan, Assèze rencontre son futur mari, Alexandre, comme nous verrons plus bas.
Le temps et l’espace
Il est clair que le roman de Beyala adhère plutôt au deuxième modèle du roman d’apprentissage décrit par Aurégan en ce qui concerne le traitement du temps comme élément narratif, allant « de la jeunesse à la fin de la maturité » de l’héroïne (Aurégan 1997 : 42-43). Comme l’a décrit Aurégan, la vie de l’héroïne prédomine effectivement sur les faits historiques, qui sont non seulement relégués à l’arrière-plan de l’histoire, selon Aurégan (1997 : 43), mais sont en fait plus ou moins absents. Nous savons dès les premiers mots du roman que le récit commence après l’indépendance du Cameroun, mais pour le reste, l’intrigue n’est pas directement liée aux événements du monde réel.
Quant au traitement de l’espace, encore une fois, la province française n’est visiblement pas le « point de départ de la trajectoire » de l’héroïne. Néanmoins, son point de départ est bel et bien un milieu rural, la brousse camerounaise : Situé dans la grande forêt équatoriale, ce coin de brousse n’avait pas de nom défini, ni d’histoire bien claire. […] Le paysage ? […] En trois mots, une nature maladivement féconde, pétrie de sentines, bourrelée de frises, embrochée de lianes et de mille et une marigots, asile de superstitions, de serpents boas, de vipères, de hautes herbes coupantes et d’innombrables mille-pattes. Un vivier pour pangolins, moustiques, crocodiles et singes. (Beyala 1994 : 10-11)
La narratrice continue la description de son peuple ainsi :
Nous étions paysans de père en fils, nous cultivions les mêmes terres, n’envoyions guère d’enfants l’école, et les mâles de préférence, vivions dans une anarchie historique, produisions versés d’ondes neuves dont la moitié mouraient avant l’âge de cinq ans. (Beyala 1994 : 11)
La brousse camerounaise peut tout à fait représenter la clôture et l’immobilité suggérées par Aurégan (1997 : 44). Néanmoins, à la trajectoire de l’héroïne, il faut ajouter la ville de Douala, qui est décrite ainsi : Cette ville n’a pas d’architecture. Elle est construite n’importe comment avec n’importe quoi et qui. Elle a grandi par hoquets successifs. On y accède par des petites bourgades appelées pompeusement Douala quatre, Douala trois et Douala deux… …Puis il y a Douala un. Elle est laide, je dois l’avouer. Faites l’effort d’imaginer une ville sans colline, sans jardin vert, où l’on rencontre rarement un battement d’aile, ou un froissement de feuille ! (Beyala 1994 : 54) Si Douala représente l’urbanisation camerounaise, elle est loin d’être « le carrefour de toutes les ambitions » décrit par Aurégan (1997 : 44). Pour cela, il faut attendre l’arrivée d’Assèze à Paris : J’arrivai à Paris un après-midi du mois d’octobre dans un quartier proche de la gare du Nord dont je tairai la situation exacte pour ne pas gêner les honorables personnes qui y vivent. […] L’immeuble lui-même, bourgeois en son temps, n’aurait plus abrité un clochard des temps modernes. […] C’était l’immeuble des durs qui n’atteignaient jamais la maturation nécessaire, et même quand ils sacrifiaient à quelques travaux rétribués, ils ne parvenaient jamais à obtenir un statut stable et demeuraient exilés dans la société ; c’est aussi l’immeuble des Africains à la conquête de la modernité qui y faisaient halte avant de s’avancer respectueusement pour se perdre dans Paris. (Beyala 1994 : 214)
La vision de Paris qu’a Assèze est aussi résumée clairement un peu plus loin : « Ce n’était pas le Paris dont je rêvais, mais c’était Paris et je ne demandais pas de miracle à l’avenir, juste un petit pas » (Beyala 1994 : 219). Il y a donc lieu de se demander si son arrivée à Paris constitue vraiment un choc et une déception profonds, comme dans le roman d’apprentissage traditionnel selon Aurégan (1997 : 46). Toutefois, nous voyons que son « errance » est formatrice, puisque l’héroïne s’adapte à son nouvel environnement et finit par acquérir une position sociale enviée par ses amies immigrantes, les Débrouillardes, à la fin du roman. Son apprentissage représente donc bel et bien une traversée d’un espace géographique et social, selon les critères fournis par Aurégan (1997 : 46). Néanmoins, compte tenu de l’addition de la ville de Douala à la trajectoire d’Assèze, nous pensons qu’il s’agit non seulement d’une opposition double comme dans le roman d’apprentissage traditionnel français (Aurégan 1997 : 43), mais d’une constellation triple, dans laquelle le milieu rural africain et l’urbanisation africaine et parisienne sont tous opposés les uns aux autres.
L’initiatrice et l’initiée
Étant donné qu’Aurégan précise que l’initiateur est normalement un homme mûr, on pourrait penser que l’initiateur dans le roman de Beyala est représenté par le personnage d’Awono. Néanmoins, nous trouvons que l’aspect crucial dans la description d’Aurégan est que l’initiateur doit agir comme « une sorte de double » du héros, ce dernier menant bien ce que l’initiateur n’était pas capable de faire (Aurégan 1997 : 50). Le vrai double d’Assèze est sa « sœur » Sorraya et l’initiateur dans ce roman est en fait une initiatrice. Cela est résumé très clairement vers la fin du roman, d’abord quand Sorraya se décrit comme une ratée, lorsqu’elle dit a Assèze : « Tu m’as crue méchante en Afrique. Tu m’as crue gentille ici. Je ne suis rien de tout cela. Je ne sais même plus où je suis. Je n’ai pas réussi ma vie. J’ai raté en tant que jeune fille et aujourd’hui en tant que femme, tu comprends ? » (Beyala 1994 : 312). Nous voyons plus loin qu’Assèze a mené à bien ce que Sorraya n’était pas capable de faire, c’est-à-dire de se sentir bien dans sa propre peau, quand Assèze se dit : Aujourd’hui, je me retrouve. Et ce que je retrouve pourrait s’appeler Dieu. Ce Dieu est parfait. Du moins, c’est son sens. Ce Dieu n’est ni blanc ni noir, ni Afrique ni Occident. Il est oiseaux, arbres, même fourmis, et prétend à la magnificence universelle. Il m’a dit : Aime. (Beyala 1994 : 318-319)
En outre, cette citation renforce l’idée que la fin du roman d’apprentissage est aussi un début, puisqu’il s’agit d’une nouvelle étape dans la vie de l’héroïne suite à sa transformation intérieure, confirmant les théories d’Aurégan (1997 : 59).
Même si elle n’est pas mûre au début de l’histoire, l’initiatrice Sorraya a un savoir qui « découle de [sa] position dans la société (Aurégan 1997 : 47). De plus, elle vit en quelque sorte « en dehors du monde », en raison de son éducation européenne et la position sociale accordée par la situation de son père. Sorraya continue d’être en marge du monde social prédominant à Paris, disant : « En France, j’appartiens encore à une minorité. Jamais je ne serai considérée comme une Blanche. Je n’appartiens à rien. Une hybride. Un non-sens ! » (Beyala 1994 : 311). Ainsi, Sorraya « dévoile l’envers de la réalité, le mensonge qui fonde le monde social » (Aurégan 1997 : 48), puisque sa réussite sociale est trompeuse.
De plus, selon les critères du roman d’apprentissage avancés par Aurégan (1997 : 49), la relation entre Sorraya et Assèze est ambiguë, puisqu’elle oscille constamment entre celle de deux sœurs et celle d’une patronne et sa domestique. Par exemple, Awono insiste que, dans sa maison, Assèze est chez soi, mais Sorraya ne cesse pas de donner des ordres à Assèze et tous s’attendent à ce qu’Assèze aide la domestique Amina avec ses tâches. En outre, la fascination qu’a Assèze pour Sorraya est dangereuse pour cette première, non seulement dans la maison d’Awono à Douala, où elle est blâmée pour les actes de Sorraya, mais aussi à Paris, quand Assèze constate que : « Le spectacle de Sorraya dura deux mois. Six mois pendant lesquels elle grandit et moi je rapetissai » (Beyala 1994 : 303). La fonction de l’initiatrice dans ce roman correspond donc en grande partie aux critères donnés par Aurégan.
L’initiation sexuelle et l’apprentissage social
Quant à l’initiation sexuelle de l’héroïne, sa première rencontre semble être plus liée à la passion qu’à un désir d’ascension sociale : Il s’inclina vers moi, m’entoura de ses bras, caressa mes cheveux ébouriffés et m’embrassa avec violence. Les dragons du désir me frappaient furieusement de leurs ailes rouges et des langues de feu enflammaient mes mèches noires tandis qu’un mini-ventilateur ronronnait et crachotait un petit air frais. Chaque geste d’Océan m’éloignait de Sorraya, de cette existence où tant d’interdits s’érigeaient. (Beyala 1994 : 182)
Il est clair que cette liaison est une manière pour Assèze de fuir ses problèmes avec Sorraya et son mécontentement avec la vie dans la maison d’Awono. Nous voyons aussi l’image idéalisée de l’amour « qui va être mise à l’épreuve des faits » (Aurégan 1997 : 52), lorsque Sorraya reprend Océan pour elle-même : J’étais prête à renoncer à tous les couchers de soleil, à des étoiles grosses comme des plats, à tous les verts de pluie et à accepter le vert le plus pâle, pourvu que j’aie Océan. Mais Sorraya me l’avait pris. Et moi, cet être de terre qui ne savait pas penser, qui savait à peine lire, qui ne savait pas se conduire avec le monde, je revoyais les images lamentables de mon existence, étalées au long des années, sous beaucoup d’échecs. (Beyala 1994 : 188)
Il ne fait aucun doute que cette liaison fait partie de l’apprentissage de l’héroïne : « Je découvrais un autre aspect de mon caractère : celui de tout donner, tout de suite » (Beyala 1994 : 178). Néanmoins, il est difficile de confirmer que cette première rencontre sexuelle a vraiment provoqué le « choc décisif » qui doit constituer « une rupture dans la vie de [l’héroïne] » selon Aurégan (1997 : 53). Il nous semble que le vrai choc décisif dans la vie d’Assèze est la mort d’Awono, après laquelle Assèze commence à prendre son propre destin en mains.
De surcroît, il faut souligner que, contrairement aux idées d’Aurégan (1997 : 54), l’amour dans ce roman n’est ni « la fin de l’apprentissage » de l’héroïne, ni « au service de l’ambition ». De plus, les personnages féminins sont loin d’être juste « un moyen et une fin », comme l’a proposé Aurégan (1997 : 53-54). Au contraire, elles jouent la plupart du temps les rôles principaux. On pourrait donc se demander si ce sont en effet les personnages masculins qui sont « un moyen et une fin », si les rôles des personnages dans le roman de Beyala sont simplement inversés, raison pour laquelle nous avons décidé d’examiner leur fonction plus en détail dans la section suivante.
En résumé, nous pouvons affirmer que, dans les grandes lignes, ce roman de Beyala correspond aux caractéristiques du roman d’apprentissage proposés par Pierre Aurégan (1997). De plus, le roman se conforme à la définition du roman d’apprentissage donnée par Claude Burgelin (2001 : 707), car il s’agit bien des péripéties que connaît [une héroïne] dans son apprentissage du monde, [attestant] les leçons qui en sont tirées ». De plus, le roman semble aussi satisfaire à la description avancée par Giles Philippe (2001 : 376), puisque c’est la biographie de l’héroïne « de sa première jeunesse à sa maturité », démontrant comment se sont construites sa personnalité et ses valeurs, qui est utilisée « en lieu et place d’une intrigue romanesque » dans cet ouvrage. En outre, la biographie suit un ordre plus ou moins chronologique et la transformation de l’héroïne est essentiellement intérieure, confirmant les pensées d’Aurégan (1997 : 60-61). À la lumière de ces observations, nous pensons qu’il est possible de qualifier cet ouvrage de roman d’apprentissage. Toutefois, Beyala a clairement adapté la forme traditionnelle de ce sous-genre littéraire, puis qu’il y a en même temps des différences importantes avec les descriptions fournies par Aurégan, telles que le rôle plus vague que joue l’amour dans l’intrigue, l’addition de Douala à la constellation spatiale, le manque de désir de reconnaissance chez l’héroïne, ainsi que la signification apparente des personnages masculins dans l’ouvrage, que nous examinerons dans la section suivante.
Les rôles des personnages masculins
Selon Christina Angelfors (2010 : 39), pour Beyala les différences de sexe et de race apparaissent intimement liées dans un concept que cette dernière appelle la féminitude ». Si les personnages féminins dans ce roman sont tous noirs, il n’est pas étonnant que Beyala mobilise les personnages masculins pour représenter les différences de race. Commençons par le prêtre Michel, qui vient au village d’Assèze pour baptiser les enfants et pour les encourager à aller à l’école et qui, plus important encore, incarne pour la grand-mère toute la problématique créée par ce qu’elle appelle le
Poulassie, c’est-à-dire les anciens colons français, sans l’influence desquels elle prétend que la mère d’Assèze n’aurait jamais eu d’enfant hors mariage (Beyala 1994 : 15, 17). La réaction d’Assèze en voyant pour la première fois un Blanc est décisive pour la construction de l’opposition Noir/Blanc dans cet ouvrage et donc pour l’apprentissage d’Assèze : C’était un Blanc. Oui, il paraît qu’il sentait. […] En sentant un Blanc de si près pour la première fois de ma vie, je ne compris pas pourquoi on faisait tant d’histoires pour ces créatures velues et couleur maïs desséché. Le Blanc était accompagné d’un Noir aux traits épais, avec assez de cheveux pour cinq têtes sur un minuscule crâne. (Beyala 1994 : 21-22)