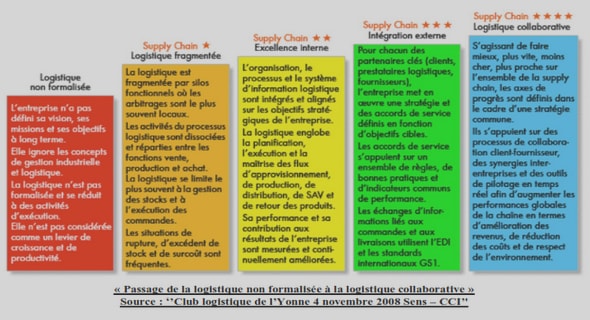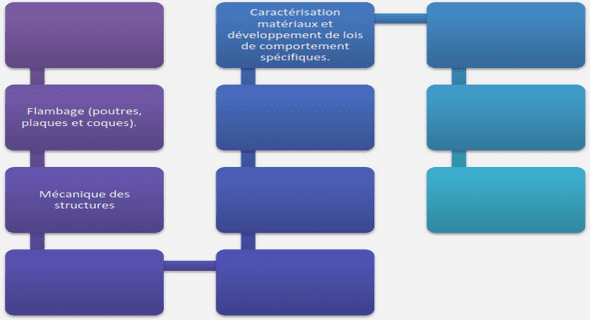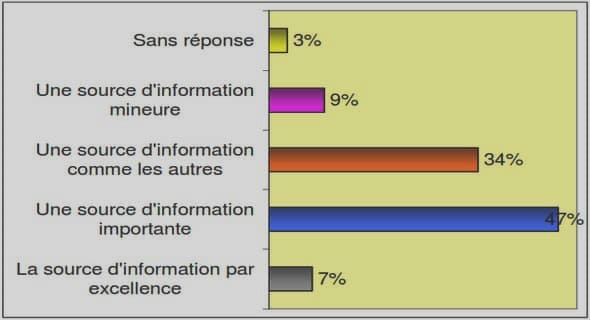Un chef-lieu de cité
Il ne fait relativement plus de doute aujourd’hui que Iulia Libica, telle qu’elle est fondée au Ier siècle av. J.-C. constitue le chef-lieu d’une cité rattachée à la province de Tarraconaise. Au IIe siècle ap. J.-C., Ptolémée désigne Llívia comme la polis des Cerretani, peuple occupant la partie orientale des Pyrénées8. Chez Pline, au I er siècle ap. J.-C., ces derniers sont désignés comme un peuple de droit latin, divisé entre Juliani et Augustani9.
Le territoire correspondant à la cité est davantage sujet à débat. Christian Rico dresse un bilan relativement complet des différents arguments avancés et des hypothèses formulées sur le sujet. Il en conclut que le territoire de cette civitas devait certainement comporter la haute vallée du Sègre et ses affluents, associés au bassin d’Urgell et aux vallées du Valira10. Cette interprétation, déjà ancienne, ne semble pas avoir été remise en cause depuis11. Ce territoire serait donc relativement peu étendu à l’échelle de la zone pyrénéenne et pré-pyrénéenne12 mais trouverait des points de comparaisons dans certaines cités de Narbonnaise ou même plusieurs micro-cités des Alpes13. Son exiguïté est une des explications avancées concernant l’évolution postérieure de Llívia.
Une « capitale éphémère »14
En effet, différents indices suggèrent que le chef-lieu antique perd son statut, probablement avant la fin de l’Antiquité. Les témoignages les plus clairs de ce déclassement sont relativement tardifs. Il s’agit d’abord de la promotion au rang épiscopal d’Urgell, de préférence à l’ancienne Iulia Libica. La première mention de cet évêché remonte à 531 et au second concile de Tolède15. Un peu plus d’un siècle plus tard, dans la chronique de Julien de Tolède relatant l’expédition du roi wisigoth Wamba en 672 suite au soulèvement d’une partie de l’aristocratie, la mention de Llívia comme un simple castrum confirme qu’elle n’a pas le rang de cité épiscopale16.
Une deuxième série d’indices pourrait suggérer que le déclassement de Llívia précède cette période relativement avancée. Dans l’ancienne province de Narbonnaise, plusieurs cités dont le territoire était peu étendu sont rattachées à une cité plus vaste : c’est le cas avec Ruscino, incorporée la cité de Narbonne bien avant la fin du IVe siècle17. C’est aussi le cas d’une série de petites cités alpines18. Cette possibilité n’est pas totalement écartée par Christian Rico, qui s’interroge sur l’existence de la cité de Llívia jusqu’à la fin de l’Empire et se demande si l’exiguïté de la civitas des Cerretani n’aurait pas pu « être un jour prétexte à son démantèlement et à son absorption par une cité du piémont plus puissante »19. Un second indice pourrait se trouver dans le nom même de Iulia Libica. Au IIIe siècle, les chefs-lieux de cité prennent souvent le nom du peuple dont ils sont la capitale20. Ce ne semble pas être le cas avec Llívia, bien que certains auteurs avancent de possibles liens entre l’épithète de Juliani attribué par Pline à une partie des Cerretani21. À ce stade de l’enquête, l’hypothèse d’une absorption de Llívia par une autre cité relativement tôt apparaît donc comme probable, bien qu’on ne puisse l’attester avec certitude.
Un castrum défensif
Le phénomène qui voit une localité qui n’avait pas le statut de chef-lieu de cité, Urgell, accéder au rang épiscopal pourrait s’inscrire dans une dynamique différente et sans doute plus tardive. Comme l’a récemment souligné Carles Gascón, la création de l’évêché d’Urgell intervient probablement dans les décennies suivant la bataille de Vouillé22. En 507, cette défaite des Wisigoths face aux Francs se traduit par un transfert de la capitale wisigothe à Tolède et un repli du royaume sur la Péninsule ibérique, ce dernier ne conservant, au nord des Pyrénées, qu’une frange de territoire en Gaule méditerranéenne, la Septimanie. Dans ce contexte, l’érection de l’évêché d’Urgell s’inscrirait dans une volonté de renforcement d’une zone devenue frontalière23. De l’autre côté du massif, l’établissement du siège épiscopal de Carcassonne s’inscrirait également dans ce mouvement24 (Figure 2).
Ce contexte se traduirait également par un renforcement, après la bataille de Vouillé, du réseau de fortifications attesté depuis le IIIe siècle dans les Pyrénées de l’Est25. Castrum assiégé dans la seconde moitié du VIIe siècle par les troupes du roi Wamba, Llívia pourrait s’insérer dans cette dynamique. En périphérie du diocèse d’Urgell, l’ancien chef-lieu de cité pourrait également, dans le même temps, faire partie d’un dispositif de protection du territoire de lacité épiscopale, à l’image de ce qui a été observé dans plusieurs cités de Septimanie26.
Un pôle de pouvoir
Dans l’ancienne province de Narbonnaise, l’apparition de nouveaux sièges épiscopaux s’accompagne de l’émergence d’un « réseau secondaire de places fortes, de centres administratifs et de pôles stratégiques qui ont également pu jouer un rôle dans la nouvelle organisation territoriale comme bases locales d’une projection de la compétence des cités »27. Correspondant à un nouveau niveau de ville, ils sont régulièrement désignés comme des castra dans la documentation.
L’emploi de ce terme pour désigner Llívia ne renverrait donc pas uniquement à un rôle militaire mais aussi à des fonctions politico-administratives. Ses liens avec le pouvoir comtal durant la période qui suit plaident en faveur de cette hypothèse. Dès la période wisigothique la présence d’un comte, c’est-à-dire d’un fonctionnaire exerçant des fonctions judiciaires et fiscales, à Llívia est envisageable. La chronique de Julien de Tolède constituerait à nouveau un indice. D’une part, on note que lors de la prise de Llívia, un comte, Aurigisclus, est fait prisonnier. D’autre part, le pôle y est désigné sous les termes de « Cirritaniae caput », renvoyant au moins à un statut particulier dans la région28. Ce statut se serait pérennisé au VIIIe siècle, après la conquête musulmane. En 731, Llívia sert en effet de refuge au chef berbère Munuza face à l’avancée des troupes de l’émir de Cordoue. La chronique relatant l’épisode évoque alors un « Cerritanensem oppidum » situé « per Libie fines »29.
Avec la conquête carolingienne à la fin du VIIIe siècle, la structuration en comtés se précise. Dans ce processus, l’association chef-lieu épiscopal/chef-lieu comtal est loin d’être systématique. Des chefs-lieux comtaux, distincts des chefs-lieux épiscopaux apparaissent, comme en Roussillon avec le binôme Ruscino/Elne30. Au IXe siècle, la cité épiscopale d’Urgell semble correspondre à un cas de figure similaire. Son territoire est partagé entre un comté d’Urgell dont la localité éponyme est à la tête de l’évêché et un comté de Cerdagne abondamment cité dans les chartes (10.1.3), dont Llívia semble être le centre (Figure 3).
L’étiolement de Llívia
Passée cette fin du haut Moyen Âge, l’histoire de Llívia est celle d’un pôle ancien progressivement marginalisé au sein du comté de Cerdagne, selon un processus bien décrit par Élisabeth Bille. L’étiolement de l’ancien chef-lieu est étroitement lié à l’émergence d’un site neuf qui finit par devenir « l’épicentre du comté »31. Ce nouveau point d’ancrage du pouvoir comtal se matérialise dans un premier temps par un palais comtal, installé dans la villa d’Hix, flanqué au XIesiècle d’une fortification implantée sur un Monte Cerdanum voisin32. Cet ultime déclassement de Llívia est définitivement consommé avant les années 1170, moment où le roi Alphonse Ier ordonne le transfert de la villa d’Hix sur l’éminence voisine, fondant ainsi Puigcerdà33.
De l’Antiquité au Moyen Âge, une série d’évolutions affectent ainsi la place de Llívia dans le réseau urbain. Chef-lieu de cité de la province de Tarraconaise, Iulia Libica est probablement absorbée par une cité plus vaste avant la fin du bas Empire. Elle émerge ensuite de nouveau à la charnière de l’Antiquité et du Moyen Âge, sous la forme d’un pôle défensif renforcé après la défaite de Vouillé mais aussi d’un pôle de pouvoir qui, au moins à partir du IXe siècle, coiffe un comté au sein de la cité épiscopale d’Urgell. Ce n’est qu’à une période avancée du Moyen Âge, à partir du XIe siècle, que le rôle politique de Llívia s’essouffle au profit d’un site neuf, dont la création est définitivement entérinée dans la seconde moitié du XIIe siècle par une couronne catalano-aragonaise récemment unifiée.
C’est ce long cycle, borné à l’amont par le déclassement du chef-lieu de cité et à l’aval par la création de ce pôle neuf que constitue Puigcerdà, que nous avons abordé dans le cadre de cette recherche. Nous fournissant un premier point d’ancrage, Llívia au sein du réseau urbain appartient, comme cité puis comme castrum, aux échelons les plus élevés dans la hiérarchie du peuplement à l’échelle régionale. Ce travail vise une approche du réseau local de peuplement, situé à l’échelle inférieure et articulé à ce premier niveau. Insérés dans un territoire qui s’inscrit, à travers Llívia, dans les rythmes de la Gaule Narbonnaise, les espaces étudiés possèdent néanmoins une particularité : ils se situent, au cœur des Pyrénées orientales, dans un espace montagnard qui constitue, par certains aspects, un terrain de recherche neuf.
Des espaces de haute montagne aux espaces valléens
Les recherches sur les dynamiques d’exploitations des espaces de haute montagne
Pendant longtemps, des « schémas historiographiques désuets »34 ont pesé sur l’approche de ces espaces considérés comme marginaux35 et marqués par le poids des contraintes naturelles. Depuis une trentaine d’années, l’appréhension de la montagne s’est toutefois largement renouvelée grâce, notamment, à la mise en place de projets interdisciplinaires portant sur l’occupation de la haute montagne dans la longue durée. Abordées au prisme de l’archéologie, de l’histoire, de l’ethnologie, des études environnementales et bio-archéologiques, plus d’une quinzaine de zones d’étude sont aujourd’hui à signaler d’un bout à l’autre des Pyrénées36.
Parmi les recherches pionnières dans ce domaine figurent celles qu’ont réalisées, en Cerdagne même, dans les années 1990, l’équipe formée par Christine Rendu, Bernard Davasse et Didier Galop.
Ces travaux s’ancraient dans différentes traditions : l’écologie historique développées notamment à Toulouse par Jean-Paul Métailié, l’archéologie agraire à laquelle donnait forme l’ouvrage dirigé par Jean Guilaine en 199137. Ces différents faisceaux qui convergeaient, avec les apports des disciplines naturalistes, vers l’histoire environnementale et la longue durée, ont concouru ensemble à l’assouplissement des frontières disciplinaires et à la transgression des périodisations historiques. Dans ce cadre, les études effectuées dans les années 1990 et 2000 sur la montagne d’Enveitg ont à la fois permis de mettre au jour les dynamiques d’anthropisation complexes des espaces d’altitude, à l’échelle pluri-millénaire des sociétés agro-sylvo-pastorales, et interrogé les relations que ces dynamiques pouvaient entretenir avec les transformations économiques et sociales des systèmes pastoraux d’estivage.
Parallèlement, différentes recherches se développaient plus spécifiquement sur l’exploitation forestière des massifs d’altitude38, tandis que les programmes d’archéologie minière livraient des ensembles de résultats inédits. Ces opérations, menées sous forme de programme collectifs, ont mis en évidence de nouveaux objets de recherche, qui se constituaient en myriades de petits sites,
dater et à inscrire dans des chronologies et des phasages : charbonnières, mines, aires de grillages, fours de réduction, cabanes de bergers, enclos pastoraux, systèmes de terrasses, etc. La comparaison de ces données avec celles de la palynologie, acquises aussi en haute montagne, de l’archéobotanique, de l’archéozoologie et plus largement des archéosciences, ont ainsi permis d’établir des séquences documentant les grands rythmes d’anthropisation de la haute montagne, mais aussi les pratiques sociales qui avaient présidé à son exploitation et à son aménagement. Ces programmes qui, depuis la thèse de Didier Galop consacrée à la moitié est des Pyrénées39, de la Méditerranée à la Garonne, se sont étendus à l’ensemble de la chaîne, ont dévoilé l’historicité profonde des espaces d’altitude. S’ils l’ont fait dans un premier temps à des échelles pluriséculaires, liées à la résolution des analyses environnementales comme à celle des datations radiocarbone et à leur relative rareté, les pas de temps se sont ensuite beaucoup affinés et les données chronologiques multipliées.
Pour revenir à la Cerdagne et à ses environs immédiats, Andorre, Pallars, haute Ariège, haute vallée du Freser, les données disponibles ou en cours de publication sont désormais difficiles à comptabiliser tant elles sont nombreuses. À l’échelle des six programmes pyrénéens les plus exhaustivement publiés, un récent décompte fait état, pour les seuls établissements pastoraux d’altitude, de 50 sites documentant 68 phases d’occupation entre le Ier et le Xe siècle de notre ère40.
Cependant, si cette accumulation de données documente d’une façon assez fine les dynamiques d’exploitation de la haute montagne, elle ne peut interroger qu’indirectement les mutations des économies et du peuplement des espaces inférieurs que constituent les vallées elles-mêmes. Or c’est là que se tiennent, a priori et sans préjuger d’importantes oscillations de leurs limites, l’habitat permanent et ses terroirs.
La précision chronologique des données acquises en haute montagne et leur multiplication posent ainsi de manière de plus en plus vive la question de la vie de ces terroirs placés au cœur des vallées et des mutations de la trame du peuplement que celles-ci ont pu connaître. Elles incitent aussi à revenir à des échelles de temps plus proches des périodisations historiques. L’objectif est d’interroger les mutations d’un système de peuplement sur un temps long, certes, mais relativement court par rapport à celui dans lequel ont été envisagées initialement les mutations des espaces d’altitude, et susceptible d’un dialogue plus fin avec le temps de l’histoire sociale.
Habitats, peuplement et terroirs au sein d’une vallée d’altitude
La démarche suivie au cours de cette thèse a donc consisté à acquérir de nouvelles informations sur les habitats de la plaine et des piémonts de Cerdagne et sur leurs terroirs. Elle s’inscrit à ce titre dans un autre courant de recherche, qui a vu, ces dernières décennies, s’accroître les travaux sur l’articulation des dynamiques de l’habitat et du peuplement avec celles des terroirs. Cette orientation de la recherche a plusieurs origines. En premier lieu, une redéfinition et un élargissement de la notion de site41, qui ne se limite plus aux espaces bâtis. Cette perspective s’est développée avec le déploiementdes études paléo-environnementales et bio-archéologiques, puis la multiplication des décapages sur de grandes surfaces dans le cadre de l’archéologie préventive42. L’archéologie du monde rural médiéval a largement bénéficié de ce renouveau qui, récemment a gagné la Cerdagne. Le diagnostic conduit à Vilalta à la fin des années 2000, portant sur un village médiéval mais aussi sur le terroir en terrasses qui le surplombe en constitue une première illustration43.
En second lieu, cette intégration des terroirs à la réflexion sur les dynamiques du peuplement et de l’habitat s’est opérée en lien avec des méthodes d’analyse neuves des données issues de la prospection pédestre. Initiées dans les pays anglo-saxons et développées plus récemment en France44, ces approches se basent sur une analyse spatiale de la répartition du mobilier hors site, interprété « comme un témoin de la pratique de l’amendement agraire par épandage de fumures »45. Largement éprouvées dans les régions de plaine, ces méthodes ont été rarement appliquées en montagne. La Cerdagne, avec sa vaste plaine d’altitude morcelée en parcelles labourées, offre de ce point de vue une configuration particulière permettant le développement de ce type d’opérations. Dans le cadre de cette recherche, nous tentons de mettre en place cette approche, avec trois objectifs principaux. Il s’agit d’abord d’apporter un éclairage neuf sur les dynamiques des terroirs, jusque-là appréhendées essentiellement au prisme de la haute montagne. Ensuite, en mettant l’accent sur les activités agraires, nous apportons un point de vue singulier sur ces espaces de montagne que l’imaginaire collectif associe plus volontiers à l’élevage et à la sylviculture. Enfin, si les résultats acquis grâce aux prospections pédestres que nous avons menées sont encore préliminaires, ils ont pu prendre sens grâce à une comparaison des données avec celles collectées parallèlement au sein du programme REPERAGE, conduit sur les trois communes de Castelsarrasin, Saint-Porquier et Escatalens, à l’aval de Toulouse, par Nicolas Poirier et Florent Hautefeuille. Cette comparaison dessine un troisième objectif, qui consisterait à moyen terme à mettre en regard les intensités et les rythmes de mise en culture entre régions pyrénéennes et grandes plaines des espaces limitrophes. C’est dans cette perspective qu’avait été lancé en 2015, sous la direction de Florent Hautefeuille et Ted Gragson, le programme Pyrénées-Garonne, consacré à une analyse comparée des dynamiques du peuplement des terroirs et des paysages dans ces deux zones géographiques. Le travail conduit au cours de ces cinq années de thèse s’est aussi inscrit dans ce cadre.
L’objectif de ce travail est donc de documenter les dynamiques de l’Antiquité tardive au Moyen Âge central en les inscrivant dans un triple horizon : celui d’un chef-lieu de cité en mutation, celui, plus large, des restructurations de la trame du peuplement, et enfin celui des terroirs montagnards qu’il s’agit d’appréhender avec leurs nuances et dans leurs différentes déclinaisons altitudinales : depuis les espaces qui environnent les noyaux d’habitat permanents jusqu’aux ressources des hauts versants.
Si cette recherche s’est fondée en partie sur des données de première main, elle a aussi beaucoup mis à profit des données archéologiques acquises récemment par l’archéologie préventive et programmée. Bien que beaucoup reste à accomplir, la Cerdagne a connu ces dernières années une véritable accélération de la recherche archéologique. Pour clore cette première série de réflexions, nous avons souhaité mettre en évidence cette progression qui permet une première approche du peuplement de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge.
Archéologie programmée et préventive en Cerdagne
En 2008, à l’occasion du colloque de Gap consacré à l’archéologie montagnarde46, Véronique Lallemand souligne que la « la montagne a longtemps été le parent pauvre »47 des opérations conduites en Languedoc-Roussillon. Ce retard des investigations à l’échelle de l’ancienne région, nous pouvons en prendre la mesure au travers des Bilans scientifiques régionaux publiés annuellement. Dans les années 1990, les deux entités administratives comportant des zones de montagne, à savoir la Lozère et les Pyrénées-Orientales livrent un nombre de notices nettement inférieur à celui des départements voisins du Gard, de l’Hérault et de l’Aude. Si en Lozère le nombre d’opérations signalées par des notices est resté bas jusqu’en 2016, dans les Pyrénées-Orientales on constate, àpartir du milieu des années 2000, une augmentation progressive du nombre de notices pour déboucher sur un rééquilibrage avec l’Aude et le Gard48. À l’échelle de l’ancienne région, les années 2010 semblent donc correspondre à un relatif rattrapage du département des Pyrénées-Orientales en termes d’opérations (Figure 4).
Si l’on s’intéresse à présent à la répartition des notices à l’échelle du département des Pyrénées-Orientales, on remarque plusieurs choses. D’une part, on constate que les communes de Cerdagne semblent avoir globalement suivi la progression de la recherche archéologique observée l’échelle du département. Si dans les années 1990, les notices concernant la Cerdagne correspondent à 9 % des textes produits pour les Pyrénées-Orientales, dans les années 2000 ce chiffre est identique et atteint 11 % pour les années 2010.
En examinant plus en détail les notes portant sur la Cerdagne française, on perçoit néanmoins une évolution dans la nature des recherches conduites. Dans les années 1990, les investigations se sont essentiellement développées au travers de l’archéologie programmée, grâce aux projets initiés, d’une part, par Christine Rendu sur la montagne d’Enveitg, d’autre part, par Pierre Campmajo sur les gravures rupestres. Ainsi, alors qu’aucune opération préventive n’est à signaler avant 2005, sur les 18 notes recensées entre 1991 et 1998, 7 concernent Enveitg, 7 les gravures rupestres. Les années 2000 et 2010 marquent plusieurs changements : la recherche se diversifie tandis que se développent les premières opérations d’archéologie préventive. Les travaux conduits à Enveitg et autour des gravures rupestres ne sont désormais plus majoritaires dans les bilans scientifiques : sur les 56 notices produites entre 2000 et 2016 sur la Cerdagne, seules 16 d’entre elles les concernent. Dans le même intervalle, une dizaine d’opérations préventives, dont deux fouilles, sont signalées.
Si l’on considère à présent la Cerdagne dans son ensemble, communes espagnoles comprises, cette évolution n’est pas tout à fait la même, en particulier en ce qui concerne le développement des opérations préventives. Grâce à un inventaire des opérations archéologiques (fouilles, sondages et diagnostics) effectué par Delphine Bousquet49, que nous avons par la suite intégré dans un système d’information géographique, nous pouvons suivre l’évolution de la recherche sur un laps de temps plus long et évaluer son développement à l’échelle de la région étudiée.
Des années 1970 à la fin du XXe s. : démarrage de l’archéologie en Cerdagne
Durant pratiquement les trois premiers quarts du XXe siècle, les recherches archéologiques en Cerdagne sont peu développées et se limitent essentiellement à l’exploration de grottes. Les années 1970 correspondent, au regard de cette relative inactivité, à un véritable démarrage. Débutent alors, sous la direction de Pierre Campmajo, l’exploration du site Llo Lo Lladre, premières véritables fouilles systématiques menées à l’échelle de la Cerdagne50. À partir de cette décennie, les opérations se multiplient de part et d’autre de la frontière : dans les années 1980 leur nombre double par rapport à la décennie qui précède (Figure 5).
Durant ce laps de temps, les différentes périodes chronologiques ont été documentées de manière inégale. Si jusqu’aux années 1980, la Protohistoire correspond à la période la plus représentée, à partir des années 1990, la tendance est plutôt en faveur du Moyen Âge (Figure 6).
De part et d’autre de la frontière, la documentation de cette phase chronologique ne s’est pas opérée de la même manière au cours des années 1990. Côté français, l’éclairage est essentiellement venu de la haute montagne. En abordant son occupation dans la longue durée, les investigations conduites à Enveitg ont régulièrement documenté la période médiévale. Sur les 30 opérations ayant apporté des informations sur le Moyen Âge au cours de la dernière décennie du XXe siècle, près de la moitié (14) d’entre elles ont été réalisées sur des sites agro-pastoraux localisés sur cette commune. Côté espagnol, les années 1990 ont quant à elles vu démarrer les fouilles du château de Llivia (6 opérations) et se développer des sondages dans des édifices religieux (4 opérations). Ces derniers s’inscrivent, avec un développement plus précoce que de l’autre côté de la frontière, dans le cadre d’une archéologie préventive. En comparaison de cette progression du Moyen Âge, les apports sur l’Antiquité sont quant à eux demeurés plus discrets tout au long du XXe siècle (Figure 6 et Figure 7). Sur la vingtaine d’opérations recensées ayant fourni des données au cours du siècle dernier, près de la moitié se concentrent à Llívia.