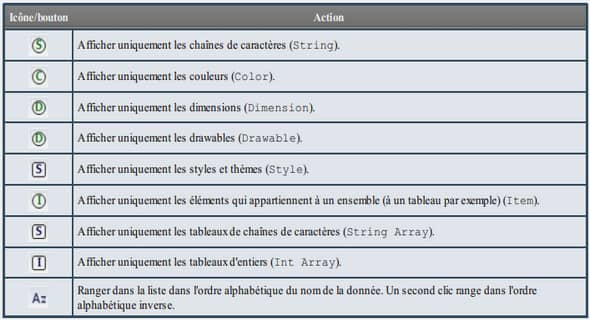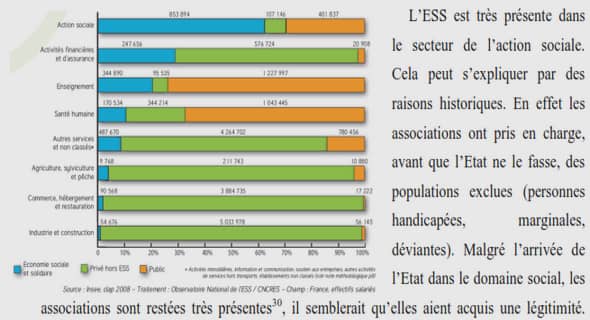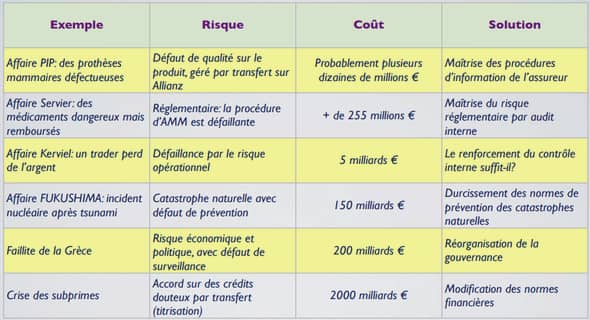La critique de la bureaucratie par l’État libéral
La figure de l’État-providence, dominante depuis les années 1930, entre en crise à la fin des années 1970. Cette crise est économique : les dépenses sanitaires et sociales croissent beaucoup plus vite que les recettes. Les taux de prélèvement obligatoires (impôts et cotisations) augmentent par rapport au produit intérieur brut, causant un problème de financement dans tous les pays occidentaux. Mais cette « maladie » s’avère plus large que la simple équation économique. Elle doit être comprise sur les plans culturels et sociologiques, comme crise d’un modèle de développement et d’un système donné de rapports sociaux. L’État-providence est remis en cause en tant que seul support des progrès sociaux et unique agent de la solidarité sociale (Rosanvallon 1981). La perspective libérale oppose, de façon croissante et avec une grande efficacité, les vertus du marché aux rigidités de l’État redistributeur, interventionniste et dirigiste. La logique bureaucratique qui est la sienne fait qu’il ne peut être qu’un piètre gestionnaire.
La fonction régulatrice du marché serait le moyen le plus efficace, le plus rationnel et le plus juste d’harmonisation des comportements : le marché permettrait de parvenir, par la confrontation et l’ajustement des préférences individuelles, à un fonctionnement économique et social optimal. « Un mouvement de repli est donc indispensable, mais qui n’est pas synonyme de désengagement : l’État doit jouer le rôle d’un « régulateur », chargé d’assurer le maintien des grands équilibres économiques, en intégrant des contraintes de nature diverse : (…) superviser le jeu économique, en établissant certaines règles et en intervenant de manière permanente pour amortir les tensions, régler les conflits, assurer le maintien d’un équilibre d’ensemble. Par la régulation, l’État ne se pose donc plus en acteur mais en « arbitre » du jeu économique, en se bornant à poser des règles aux opérateurs et en s’efforçant d’harmoniser leurs actions » (Chevallier 2004). Les thèses du new public management, issues du modèle de l’entreprise privée, portent cette conception du nouveau rôle des administrations étatiques dans les pays de l’OCDE. Une progressive remise en cause du modèle bureaucratique Le modèle bureaucratique et son efficacité sont largement sujet de débats, dans les sciences politiques, juridiques ou administratives comme dans l’opinion publique, au point que la bureaucratie renvoie aujourd’hui dans le sens commun à une organisation lourde, lente et peu réactive.
Robert K. Merton (1940) a mis en évidence le risque de la bureaucratisation du secteur public, dont l’absolu des règles et des principes d’intervention (hiérarchie, professionnalisation des employés, rationalisation) prendrait le pas sur les visées d’efficacité de l’action publique. Il y a alors un déplacement des buts des organisations bureaucratiques, qui donnent dans tous leurs actes la priorité à leurs propres problèmes. Merton met en évidence l’endogénéité de ces organisations, tournées vers leur propre perpétuation et donnant la priorité à la protection de leurs membres. Selon lui, cette forme de structure agit sur la personnalité même de ses membres, obligeant le fonctionnaire à être « méthodique, prudent et discipliné » et à développer un « ritualisme » qui l’amène à se focaliser sur l’application des règles et des procédures, quitte à en perdre de vue l’esprit, par exemple celui d’une réponse au besoin du client ou de l’usager de l’organisation. Vis-à-vis des destinataires, un certain nombre de défauts sont imputables à la bureaucratie : distance, complexité, paperasserie (Selznick 1949). Cette endogénéité a tendance à produire des services à coûts élevés pour une qualité qui peut être remise en cause. Philippe Bezès (2009) date des années 1960 le développement des critiques de l’efficacité de l’organisation bureaucratique de l’État en France. Ce constat renvoie aux débats sur le rapport au service public et au niveau de prélèvement fiscal en augmentation constante pour le financer.
Le coût du service public, clairement posé dans cette période, oblige à un débat public sur le rapport entre qualité et coût de ces services. Selon une formule de Yves Lichtenberger (2015), « la principale raison de réformer est que les citoyens ne perçoivent plus une qualité du service public au niveau de coût qui leur est imposé ». Cela conduit à resituer le service public comme un service destiné à des publics et non comme le service simplement assuré par un agent public. Les publics sont désormais moins homogènes, plus différenciés dans leur capacité à en être bénéficiaire. Cette évolution est alors un des enjeux majeurs de transformation du service public et de renchérissement de son coût. Marc-Olivier Padis (2010) souligne les difficultés croissantes des dispositifs classiques de l’État à toucher les nouveaux publics, les nouveaux besoins ou à mener à bien ses opérations. Il évoque « l’obsolescence des modes de gestion publique calés sur l’organisation de la société industrielle. On pouvait alors appliquer un traitement uniforme sur des positions stables ou qui visaient la stabilité, en laissant de côté des parts croissantes de la population. Dans le domaine sanitaire et social, par exemple, la diversification des risques, la différenciation des sorts professionnels, les nouvelles ruptures de parcours appellent des interventions plus variées que la prise en charge réparatrice des grands risques homogènes ». Ces transformations ont une incidence importante sur l’organisation territoriale de l’État. « L’État ne peut plus seulement quadriller un territoire perçu à travers la grille géométrique de la rationalisation administrative : il se trouve devant une situation d’archipel qui juxtapose des territoires isolés, des aires d’activité spécialisée et des noeuds de connexions qui associent des dynamiques locales à des réseaux à distance sur une échelle planétaire » (Padis 2010 pp.101-102).
Le new public management comme bouc émissaire ?
Une tendance des travaux sur l’évolution de l’action publique consiste à renvoyer tous les maux de l’administration à l’expression « new public management ». Dans le contexte français, nous soulignons que l’approche gestionnaire décrite plus haut, utilisée par les hauts fonctionnaires à la manoeuvre, est une version partielle de la théorie élaborée par Christopher Hood (1983). Le théoricien du new public management construit en 1983 une typologie destinée à étudier les outils (tools) à la disposition des gouvernements pour réguler l’action publique. Il s’agit de poser la problématique de l’instrumentation, c’est-à-dire les problèmes de choix qui se posent pour réaliser l’adéquation entre un objectif de politique publique et les moyens susceptibles de l’atteindre. À partir d’une analyse des fonctions de l’État, il propose une grille « NATO15 » qui regroupe les instruments fondamentaux à sa disposition en quatre secteurs : le recueil d’information (nodality), les moyens financiers (tresor), la contrainte légale (authority) et les forces à sa disposition pour contraindre le corps social – police, armée, administration (organization). Il distingue au sein de ces quatre groupes d’instruments : ceux de prélèvement d’informations sur le social (detectors) et ceux qui cherchent à orienter les conduites (effectors). Le succès de l’utilisation de l’expression new public management conduit ultérieurement Ch. Hood à la décrire comme un « puzzle doctrinal » (Hood 1994), qui rassemble un nombre important d’approches visant la transformation des États occidentaux dans le cadre du libéralisme.
Au-delà de la recherche (éminemment démocratique) de l’efficacité de l’action publique et de l’adéquation entre objectif et moyen, l’expression est utilisée de manière croissante pour justifier de la nécessité des États contemporains de s’adapter aux transformations qu’ils traversent : l’émergence d’enjeux de politique publique (environnement, urbain) ; la réorientation de problèmes plus anciens (sécurité, santé) ; la référence croissante à des modèles néolibéraux et managériaux qui s’inspirent des régulations par les marchés ; le développement des nouvelles technologies de connaissance qui produisent des conditions favorables à la diffusion de modes de pilotage de l’action publique fondés sur la mesure des performances. Le déploiement de ces technologies de pilotage s’accompagne de l’utilisation d’instruments qui, au-delà de leur fonctionnalité ou de leur efficacité, sont des modalités concrètes de domination et d’exercice du pouvoir. Ce mouvement s’accompagne donc « d’une relance des approches critiques dénonçant le déploiement d’une « société de surveillance » ou du moins les risques potentiels de prolifération de nouvelles modalités de contrôle et de normalisation des phénomènes sociaux » (Lascoumes & Simard 2010 p.5). Nous verrons ainsi que c’est moins la théorie même du new public management qui pose problème que l’application incomplète de la typologie d’instruments qui en est faite par les hauts fonctionnaires réformateurs. Dans notre cas, la notion de « nodalité » est en effet particulièrement stimulante.
Elle renvoie à la nécessaire présence de l’État sur le terrain, parmi les acteurs de l’action publique, afin de conserver la légitimé de son positionnement et de son action de coordination de l’action publique. Selon la théorie, l’État doit donc s’appuyer sur ses services déconcentrés pour l’application des dispositifs d’orientation des conduites (effectors), mais aussi pour jouer le rôle de relais d’information (detectors). Ces services jouent un double rôle de détection des problèmes sociaux et de remontée d’information vers le sommet. Ce type de position constitue dans la grille du new public management les éléments d’un soft power, qui complète efficacement le gouvernement régalien (hard power) par la contrainte légale (authority), par les finances (treasure) ou par l’organisation (organization) (Hood 1983). On note ainsi qu’aux côtés de l’administration de gestion et des problématiques régaliennes, il est nécessaire de maintenir une administration plus autonome, moins structurée par l’organisation et la hiérarchie, garante d’un soft power nécessaire à la connaissance territoriale et à l’implication auprès des acteurs sociaux. L’enjeu de la thèse est de montrer que cette approche « soft » du gouvernement est largement oubliée dans les référentiels de réformes, ce qui fragilise la « nodalité » de l’État.
Résumé |