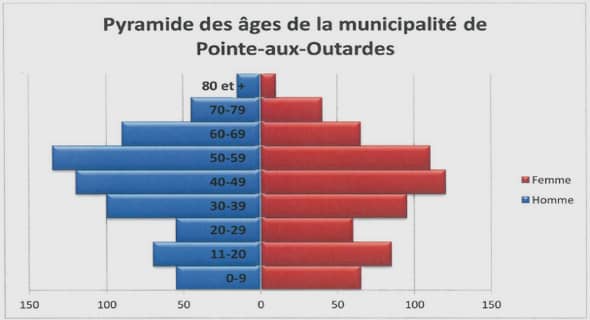Depuis plusieurs années, Madagascar a mis en œuvre des programmes visant à renforcer la croissance et les équilibres interne et externe, pour faire reculer la pauvreté. Le taux d’inflation est très élevé depuis 1994. c’est à partir de l’année 1996 qu’elle s’est décélérée.
Le gouvernement procède au programme des réformes économiques, avec l’appui de la banque mondiale, dans le cadre de l’ajustement structurel. Ceci a pour but de développer le secteur privé à Madagascar. Le programme de privatisation constitue l’une des composantes majeures, par le biais du processus de rééquilibrage entre le secteur public et le secteur privé. Le secteur bancaire est aussi touché par ce programme de privatisation. Il était conçu pour accroître la concurrence au sein du secteur en vue de réduire le coût de l’intermédiation financière et de permettre aux banques de contribuer efficacement au financement de la relance de l’économie et notamment des investissements requis par cette relance et ce dans le cadre d’une économie plus ouverte et plus axée aux mécanismes du marché.
Finalisée en 1999 par l’aboutissement de la privatisation de la BTM, la privatisation des deux banques publiques a apporté un changement au niveau du système bancaire malagasy. Il est nécessaire de savoir de près quel changement a-t-elle apporté, c’est ainsi que le thème : « Le système bancaire à Madagascar après la privatisation » m’intéresse pour mémoire de maîtrise.
Il discourt en premier lieu le cadre économique et financier de Madagascar de 1990 à 2002, et ultérieurement le programme de privatisation et le système bancaire avant, et après la privatisation.
LE CADRE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE MADAGASCAR (1990-2002)
LA CROISSANCE ECONOMIQUE
La croissance économique d’un pays correspond à l’évolution du produit intérieur brut par rapport à celle de la population. C’est le résultat de la politique économique menée par l’Etat. Elle peut être positive ou négative ou même zéro. Certains pays africains adoptent les politiques d’ouvertures sur l’extérieur au niveau du commerce et de l’investissement pour avoir une meilleure croissance économique. Mais pour les différentes raisons, notamment, les lourdeurs administratives, les déficiences des lois en faveur des investisseurs étrangers, cette politique tend à tomber dans l’eau.
En 2002, ce fut le même cas, c’est à dire c’était l’instabilité politique qui a rendu négative la croissance. Due aux grèves de longue durée, la croissance a baissé à 12,7%. Pendant les six premiers mois de 2002, les barrages sur les routes, la pénurie de carburants et la fermeture du MID ont mis en difficulté des pans entiers de l’économie du pays, notamment les secteurs de l’industrie, du tourisme, et du transport. Pour le secteur secondaire, les branches performantes comme les zones franches qui ont été le moteur de la croissance du secteur auparavant ont même été durement affectées par la crise et ont connu une croissance négative, étant donné les effets des arrêts de production et même des fermetures provisoires ou définitives des usines.
Pour l’année 1994, suite à la situation économique en 1992 qui est caractérisée par : le ralentissement des investissements privés, le faible hausse de la production, la suspension des accords avec les bailleurs de fonds, la faible pression fiscale et la baisse des exportations, on a enregistré une stagnation de l’activité économique, la suspension des négociations avec les bailleurs de fonds s’est traduite par une forte diminution des tirages sur emprunts extérieurs. Les financements des bailleurs de fonds représentent plus de 70% des dépenses en capital du budget malagasy, les investissements publics ont accusé une baisse de 44,2% en 1991, par rapport à 1989, et une autre baisse de 32,2% en 1995, par rapport à 1993. Ces baisses ont affecté la demande intérieure d’une part et d’autre part, l’expansion et l’entretien de l’infrastructure et donc la croissance économique. Il est à souligner aussi que c’est la même période que le cyclone Geralda a fait ravage dans notre pays. Le cyclone a provoqué des dégâts, le secteur primaire a été le plus affecté avec une chute de 0,5% de la production. La hausse de 1,2% de la production du secteur tertiaire est les effets bénéfiques du flottement de la monnaie et à la flambée des cours mondiaux de certains produits d’exportation tel que le café.
C’est à partir de 1996 que Madagascar a connu la stabilité macroéconomique. Le taux de croissance a une légère hausse de 2,1% contre 1,7% en 1995. comparé à la croissance de la population (environ 3%) le taux modeste. La croissance a été tirée par l’investissement public, la dynamique de la branche télécommunication et des entreprises zone franche et aussi des conditions climatiques favorables et des impacts des programmes et des projets de développement agricoles.
Pour les périodes 1996 à 2001, les taux de croissance ont été relativement élevés car ils ont dépassé le niveau des années précédentes. Ceci est expliqué par une forte participation des secteurs secondaire et tertiaire. En effet, le secteur secondaire a enregistré un taux de croissance 4,8% et le secteur tertiaire 4,9%. Nous pouvons dire qu’en 2001, le programme macroéconomique a donné des résultats relativement bons. Le PIB a enregistré un taux de croissance de 5,9%. Il a même dépassé le niveau moyen de 3,8% pendant les cinq années précédentes. Le secteur secondaire a bénéficié de l’expansion des entreprises franches ainsi que la bonne production de la plupart des industries manufacturières.
L’INFLATION
C’est un déséquilibre économique caractérisé par une hausse générale, durable, cumulative et plus ou moins forte des prix. En 1990, l’Etat a fait une politique sur la libre fonction des marchés : Suppression des contrôles de prix au producteur alliée à la production périodique de prix indicatif. Suppression des contrôles de marge bénéficiaire pour le commerce de gros et de détail. Ajustement des tarifs sur la consommation d’eau, d’électricité et des télécommunications en fonction des variations des taux de changes. Celle-ci a pour objectif de maintenir durablement la hausse des prix à un rythme annuel inférieur à 10%. Mais la politique n’a pas réussi car l’instabilité politique au milieu de 1990 a provoqué la montée des prix.
L’année suivante la politique de libéralisation de prix au producteur et de marge bénéficiaire a été poursuivie. Donc l’inflation s’est accrue de 11,6%. L’IPC a évolué de façon rapide comparée à celle du déflateur du PIB. A cette période, la hausse a été entraînée par celle du coût de transport et par la spéculation.
Mais la flambée des prix continuait de 1994 jusqu’à 1995. En 1994, la forte dépréciation de la monnaie nationale, la libéralisation des échanges, et les dégâts cycloniques ont produit la stagnation de la production sectorielle. Par conséquent le taux d’inflation est très élevé (36,6% contre 10,1% en 1993). C’est seulement à partir de l’année 1996 que l’inflation s’est fortement décélérée. Celle-ci est le fruit de la maîtrise accrue des dépenses publiques, de la bonne conduite de la politique monétaire et la quasi-stabilité du taux de change. L’augmentation des produits pétroliers survenus vers la fin de l’année 1998 explique la hausse moyenne des prix entre 1998 et 1999 qui est de 9,7%.
INTRODUCTION |