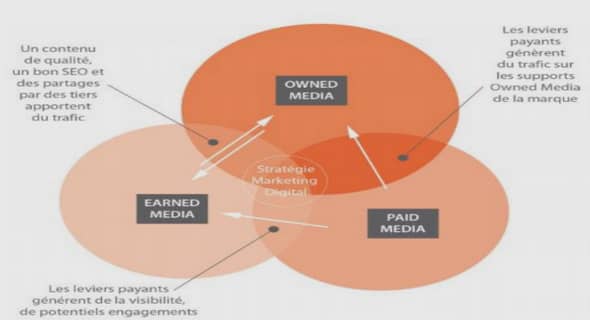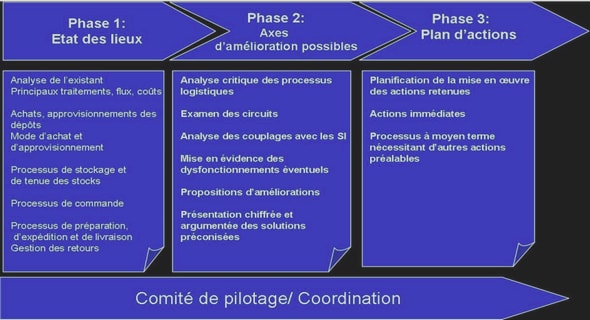Le corpus mythologique et le statut du discours mythique
Avant d’entreprendre l’étude comparative des versions de la geste de Tiri, qui permettra de cerner les modalités du processus d’actualisation dont elle a été l’objet, il est important de préciser la place que ce récit occupe dans le corpus mythologique yuracaré, de même que les caractéristiques que ceux-ci attribuent au discours mythologique en général. Ces deux dimensions sont en effet fondamentales pour saisir, d’une part, le rôle majeur que les Yuracaré en sont venus à accorder aux aventures de Tiri, mais aussi pour rendre compte, d’autre part, de ce que peuvent signifier des retouches à la geste du point de vue de ses narrateurs. La vision d’ensemble de la structure du discours mythologique yuracaré contemporain – qu’il s’agisse de la diffusion des récits dans les différentes communautés qui continuent de le transmettre, de la cohérence des différentes versions que l’on possède des plus diffusés d’entre eux ou encore du profil des personnages que les uns et les autres mettent en scène –, offre la possibilité de caractériser la position centrale autant que l’intensité de l’attachement que les Yuracaré vouent à ce personnage. Les propriétés du discours mythologique en tant que discours, permettent d’établir, quant à elles, le statut épistémologique et le type de savoir que celui-ci possède. Or, c’est de ces caractéristiques que dépend précisément le type de modifications que les narrateurs peuvent estimer légitime d’apporter au récit qu’ils se transmettent.
Quelques points de repères
Tel qu’on a pu le recueillir aujourd’hui, sur le haut Isiboro et le haut Sécure, et ainsi que les travaux récents le démontrent pour d’autres régions, le corpus mythologique yuracaré ne frappe ni par sa prolixité ni par sa diversité, en comparaison de celui d’autres populations des basses terres10. Il comprend un premier ensemble de récits bien connus et largement distribués. Ce sont les gestes de quatre héros, dont on connaît, pour trois d’entre eux, le nom propre : Tiri, bien sûr, Aysa, et Weche. Dotés d’une distribution remarquable, ces récits constituent des “classiques” qui ont pour point commun de présenter les actions de héros exceptionnels, ayant les uns et les autres concouru à marquer le devenir du monde de façon définitive et irréversible. S’ajoutent à cet ensemble de récits “classiques” des récits de moindre importance cosmologique, mais comme eux largement diffusés, la plupart ayant un jaguar pour protagoniste. Tel est le cas du récit comique du Tatou (shuyasha) et du Jaguar où le premier tourne en dérision le second, un des seuls véritablement burlesques de tout le corpus yuracaré et mettant en scène, à la manière des fables d’Esope, exclusivement des animaux. Cet ensemble relativement limité s’oppose au reste des narrations mythologiques qui ne sont plus aujourd’hui connues que localement ou dans des versions qui varient passablement.
Parmi les récits “locaux” à l’intrigue la mieux chevillée, auxquels on a pu avoir accès, et dotés d’une importance cosmologique considérable ressortent en particulier : l’histoire de courts récits parfois anecdotiques, centrés sur un personnage ou un existant particulier, mais sans intrigues complexes.
Comparée les unes aux autres, les versions des “classiques” de la mythologie présentent un degré relativement faible de divergences. La diffusion des gestes de ces héros tout autant que leur cohérence ne tiennent pourtant pas à la simplicité de leur intrigue : ces récits sont, au contraire, parmi les plus travaillés et les plus complexes du corpus mythologique yuracaré. La dispersion des narrateurs, les trajectoires historiques variées des parentèles au cours du XXe siècle, l’absence de recoupement dans les généalogies de ceux qui sont capables de les énoncer, sont autant de facteurs qui laisseraient penser que de tels récits devraient rapidement voir leurs divergences se multiplier d’une façon aléatoire. Ce n’est cependant pas le cas.
En comparant les versions les unes aux autres, trois types de divergences peuvent être reconnus. Les plus immédiatement identifiables se repèrent par contraste à l’absence d’un seul ou d’un ensemble d’épisodes dans une version. Si telle aventure ou telle rencontre vécue par un héros fait défaut chez un narrateur, cette lacune n’affecte pas forcément le reste du récit qui peut très bien être raconté avec autant de détails que dans les autres versions. Renvoyant à des épisodes optionnels dans certains cas, ces “trous narratifs” peuvent dénoter, à mesure qu’ils s’étendent à des groupes d’épisodes, un phénomène d’autocensure du récit.11 Le second type de divergences s’observe, pour sa part, dans les épisodes racontés par la majorité des narrateurs. Ordonnées sur un continuum, les plus légères dépendent du talent de chaque narrateur et se notent à la richesse des dialogues, au choix des mots, aux précisions qui échappent aux uns et figurent chez d’autres (comme l’usage des noms propres), mais elles interviennent dans des scènes ou des épisodes qui, une fois émondés des détails qui les individualisent, peuvent tous être résumés de la même manière. Ces variantes esthétiques ou stylistiques s’opposent à des foyers de divergences beaucoup plus notoires, qui ont la particularité d’être très systématiquement situés dans les mêmes passages. Les éléments narratifs se retrouvent, mais articulés d’une façon telle qu’il est, en revanche, impossible d’en produire des résumés identiques. Ces foyers instables sont les points d’accrochage à partir desquels les auteurs successifs ont infléchi et reconfiguré le contenu de leur récit. Cette typologie, comme on aura l’occasion de le constater en comparant les versions de la geste de Tiri, peut être notablement affinée.
Les épisodes “mis de côté”, puis oubliés, mériteraient une étude spécifique que l’on n’entreprendra pas ici. On pourrait étudier grâce à elle le processus de “décosmologisation” du mythe. Les versions recueillies par J. Ribera (1988a, 1999), si elles sont tout à fait similaires à celles que l’on examinera ici, ont en effet pour caractéristique de laisser tomber les fragments de discours où Tiri apparaît comme un démiurge à qui l’on attribue effectivement dans le passé d’avoir généré tel ou tel aspect du monde. Ce processus de censure et d’oubli se réalise à mesure que le devenir du monde “réel” se dit à travers d’autres narrations et particulièrement des récits chrétiens.
La nature non aléatoire des divergences, la stabilité globale des “classiques” yuracaré et la concentration des éléments de variation impliquent que tout, dans un mythe, ne se transforme pas au cours du temps au même rythme, et que tout ce qui s’y trouve transformé ne l’est pas de manière hasardeuse. Un tel constat n’invalide en rien la nécessité de tenir compte de la créativité du narrateur, mais souligne le fait qu’elle est elle-même conditionnée par la “matière narrative” à laquelle elle s’applique, et qu’elle n’est pas de l’ordre du simple exercice de style. Loin d’être absolument libre ou généralisée, cette créativité n’est en effet dotée de pertinence qu’en raison d’une exigence de fidélité générale à la version apprise. Hors de ce principe de conformité, les mythes ne sauraient présenter autant de cohérence dans l’espace et dans le temps. S’ils avaient été soumis à un processus permanent et stochastique de transformation, il deviendrait par ailleurs impossible de reconnaître un quelconque processus d’actualisation rattachant le devenir métamorphique d’un récit à des expériences historiques spécifiques.
La geste de Tiri et les autres “classiques” de la mythologie yuracaré présentent un profil relativement stable autant qu’une large diffusion, en grande partie en raison de l’intérêt que les Yuracaré portent aux héros dont ils rappellent l’agir. Comme on l’a déjà évoqué, ces récits ont tous pour figure centrale un homme (jamais une femme) considéré comme un « parent » (apta) doté d’une capacité d’agence extraordinaire. Chamanes hyperboliques ou démiurges (ce dernier terme étant particulièrement adapté à Tiri), ces existants sont capables en effet de diverses prouesses : métamorphoser autrui (pour en faire des animaux), se métamorphoser soi-même (en animal ou en autre chose), se déplacer aux extrémités du monde (au ciel, dans le grand aval des rivières), enfin faire revivre les morts à travers la technique du souffle craché (ka-la-su-ta, ka-la-summë-të) dont ils sont maîtres. Cette capacité d’agence, qui témoigne de leur profil ontologique hors du commun, s’associe à une autre propriété, à peu près unanimement acceptée, fondamentale pour comprendre le statut du discours mythologique en général : ils sont réputés immortels. Ces mythes s’achèvent ainsi souvent par des commentaires indiquant qu’après avoir accompli ce que l’on a rappelé en énonçant sa geste, le héros « s’en est allé, et a disparu ».12 On admet que les héros résident actuellement “quelque part”, bien que l’on ne sache pas toujours ni où ni sous quelle forme. On dira qu’ils vivent « au ciel » (asha-chi), parfois « au bout du monde » (a-tuwë-të-chi) et, à défaut d’une référence précise, le locatif intensif wille-chi (très loin) fera l’affaire.
La disparition est plus exactement marquée par l’usage du verbe kala-she-ta, « se perdre ». Le champ de la perte ou de l’égarement est également celui qui définit la notion “d’oubli”, li-ja-la-she-ta, « oublier », et de l’erreur linguistique, inversion de mots, dyslexie, mot mal prononcé. Se tromper, se perdre et oublier s’articulent sur un même plan sémantique : ne pas être là où l’on devrait être.
Bien qu’immortels et puissants, les héros des mythes ne sont pas, ipso facto, des dieux ou des divinités, car il n’y a pas de discontinuité ontologique entre nous, les humains, et eux, mais seulement une intensité d’être différente. La langue yuracaré n’a pas ménagé de niche lexicale qui ferait des héros une “espèce d’êtres”, et de fait, ils reçoivent simplement le titre de pëpë « grand-père, vieux, ancien », ou de tata, « père », dont on fait précéder leur nom propre. Ces deux termes, qui font partie du vocabulaire de la parenté, doivent être entendus ici comme des titres de respect marquant l’aînesse et la maturité. Équivalents l’un de l’autre, ils ont une valeur qui induit certains Yuracaré à les traduire pas señor (monsieur), plutôt que par leur signification littérale. Les quatre héros yuracaré qui, dans le passé, ont réalisé des prouesses, puis se sont perdus pour demeurer aujourd’hui “quelque part”, ne doivent pas être confondus avec ces gens du passé appelés pëpê-shama-w, « feu les anciens ». Ces pëpê-shama-w, sur lesquels on reviendra ci-dessous plus longuement, ne sont pas, pour leur part et comme leur nom l’indique, des êtres “exceptionnels”, passés par l’épreuve de la mort, ils demeurent en tant que « gens d’autrefois ».
En dépit de leurs réductions partielles dans les missions catholiques, maintes fois recommencées mais jamais définitives, dès la fin du XVIIIe siècle, les Yuracaré ont été relativement réticents à importer massivement dans leurs récits mythologiques des fragments de discours chrétiens, sinon par un jeu d’interférences qui portent sur le statut ontologique des existants et précisément pour actualiser leurs propres mythes. Le récit qui, par l’importance de l’action de son héros, offre par excellence la possibilité d’interférences et de mise en résonance avec les récits chrétiens est la geste de Tiri. Son contenu a sans doute conditionné l’intérêt que portent les Yuracaré à certains éléments de mythes chrétiens qu’ils peuvent évoquer, et qui ont particulièrement éveillé leur curiosité : la tour de Babel et sa destruction qui provoquera la dispersion de l’humanité et la diversification des langues, le déluge et l’histoire de Noé, enfin la création d’Ève à partir d’un fragment du corps d’Adam. Mais ces trois scènes ne se trouvent pas souvent mêlées directement à la narration de la geste de Tiri, ou à celle d’aucun autre mythe.13 Indépendamment du contenu de la geste de Tiri et même de la manière dont on la connaît, on pourra entendre par ailleurs, lorsqu’on interroge certains Yuracaré, que Tiri est Dieu ou Jésus, ou plus prudemment que Dieu se dit Tiri en langue yuracaré. Cette équation des noms propres est problématique et ne correspond que rarement à une coïncidence ontologique. De l’ordre de l’analogie, elle n’empêche pas, il est vrai, de tenter au coup par coup un rapprochement qui va au-delà d’un appariement de noms propres, mais c’est alors, toujours de façon oblique, empreinte d’incertitude, dans le cadre de réflexions individuelles qui ne se sont pas transformées en phénomène collectif normatif. La difficulté créée par ce type de rapprochements, qui croît à mesure que la connaissance des mythes chrétiens s’intensifie, conduit plutôt à raconter et à considérer de manière séparée des récits qui rendent compte des actions de l’un et de l’autre. Les Yuracaré du haut Isiboro ont adopté une position dédoublée qui s’apparente à une sorte de perspectivisme pratique et permet de rappeler ce qu’a fait Tiri d’un côté, ce que désire Dieu de l’autre, sans jamais produire un jugement synthétique du type : Tiri est Dieu. Ils sont alors capables de raconter des versions des deux mythes en leur conservant simultanément, à l’un et à l’autre, la même puissance eschatologique. S’il existe quelques versions de récits enregistrés auprès de très rares Yuracaré dont la source est indubitablement d’inspiration biblique, les héros, qui ont des noms chrétiens, sont présentés alors comme des héros à la capacité d’action extraordinaire dans le monde à la hauteur de Tiri, d’Aysa, sans que leurs gestes spécifiques ne se confondent avec celles de ces héros. Ce sont en quelque sorte des mythes “en plus”, la geste des héros “chrétiens” n’invalidant pas celle des autres, mais se plaçant à côté d’elle.14
La relative imperméabilité des mythes yuracaré va de pair avec l’importance que revêt pour leurs narrateurs de séparer, autant que possible, “leurs histoires” des histoires des autres. C’est certainement l’arrêt de la transmission des mythes qui est un des meilleurs moyens de se rendre compte de la pertinence de la distinction entre “nos récits” et “les leurs”, ceux des autres. Accorder un intérêt moindre à ses propres récits, ne plus les raconter et les oublier pour se tourner vers les récits chrétiens, procède d’une volonté affichée de “devenir autre”. Le moment de basculement est atteint précisément lorsque la possibilité interne d’actualisation de la narration ne peut plus se faire que sous sa forme maximale qui est la substitution. Mais l’enjeu d’un tel processus, que l’on qualifiait naguère d’acculturation, est celui d’un changement de monde : un changement de monde hautement problématique, puisqu’il n’implique pas de dissolution ou de dilution d’un rapport réflexif à soi comme « nous », mais une reconfiguration créative du « nous » pour pouvoir l’inscrire dans un autre monde.
La geste de Tiri occupe au sein de la mythologie yuracaré une place qui mérite quelques commentaires. Plus long récit du corpus mythologique yuracaré – parfois près d’une heure de narration –, il en est incontestablement la pièce maîtresse, et celui qui porte les inférences étiologiques les plus nombreuses. Seul récit ou un personnage mythologique s’élève à la grandeur d’un maître des humains, il répond à une série de questions clés : l’origine du posteriori en la contrastant avec les gestes des autres héros. S’il s’agit bien de héros du même type que Tiri, ils n’en ont évidemment pas la carrure ontologique : les effets de leur agir dans le monde ont été mineurs, et en aucun cas les Yuracaré ne les ont fait s’élever, comme Tiri, au rang de maître d’une portion de l’humanité.
La geste d’Aysa conte l’histoire d’un homme qui, contrairement à ses frères, parvient à échapper au serpent-monstre Imbëmëwta, en se transformant en épingle. Recourant à divers subterfuges pour tromper le monstre, il monte au ciel en faisant croître magiquement un palmier Bactris. Aysa, qui souffre du froid, se fait apporter du feu, et c’est là, pour certains narrateurs, l’origine du feu domestique. Ayant demandé aide à des rapaces célestes, il fait tuer Imbëmëwta : en se baignant dans le sang et les viscères de ce monstre, les oiseaux obtiennent les couleurs de leur plumage actuel. Après avoir ressuscité ses frères, Aysa a d’autres aventures. Le récit se poursuit par une série d’épisodes parfois racontés à part, où Aysa rencontre le géant stupide au corps de pierre, Pêpësu, à qui il joue des tours et réciproquement. Ce grand bêta, parfois méchant, qui vit dans une grotte, le prend comme gendre ou comme captif, en lui offrant sa fille, elle-même sarigue. Aysa fuit son beau-père lorsqu’il apprend que celui-ci se prépare à le manger.
La geste du second héros, parfois identifié à Aysa, est celle d’un homme solitaire, sans parents, qui, un jour de pluie, est interpellé par un bois flotté qui le convie à l’accompagner dans son voyage jusqu’au grand aval des rivières où une chute d’eau (un siphon, suivant les versions) doit le faire disparaître. L’homme accepte de l’accompagner, mais abandonne le bois flotté juste avant qu’il ne s’abîme et, quoique ce dernier tente de le faire périr avec lui, il parvient in extremis à sauter à terre. Perdu, tenaillé par la faim, errant, l’homme découvre un essart où il mange des arachides. Les propriétaires de ces plantations, les nains Boshita-w (ou Moshita-w suivant les parlers), l’attrapent avec un piège à glu et en font leur animal familier puisqu’ils le voient comme un agouti (ishete). Alors que l’homme constate que les Boshita-w n’ont pas d’anus et sucent leur nourriture sans l’avaler, ceux-ci s’étonnent des pratiques alimentaires de leur animal familier : non seulement il avale, mais aussi défèque la nourriture qu’il reçoit d’eux. Fascinés par sa particularité anatomique, ils demandent à l’homme – qui bientôt se manifeste « en personne », neutralisant l’extériorité perspective qui le faisait aux yeux de ses hôtes un agouti – de leur percer le postérieur. L’homme entreprend l’opération avec un pieu, mais ne parvient qu’à provoquer de mortelles hémorragies. Face à l’évidente colère des Boshita-w, contraint à la fuite, il remonte alors vers le couchant, fait plusieurs rencontres et finit par monter au ciel, où il trouve le chef des mantes religieuses, Süyya ma-buyta-w. L’homme solitaire, qui estime qu’il n’a pas assez de parents auprès de lui, sollicite la générosité de Süyya. Celui-ci dans son magasin a, en effet, des boîtes (de cartouches) remplies de petits “homoncules” serrés les uns contre les autres. Süyya lui remet plusieurs boîtes tout en lui recommandant d’éviter de les ouvrir avant d’être de retour chez lui. Incapable de résister à un élan de curiosité, l’homme en retire les couvercles au moment où il arrive dans les Andes. Tous ces petits hommes se déversent des boîtes par milliers et deviennent les Andins : ainsi naissent les villes de La Paz, Cochabamba, Sucre…
La geste de Weche rappelle les aventures d’un homme de grand talent chamanique, cadet de quatre frères, à qui la mère fait consommer une étrange bière de manioc. Weche découvre, en espionnant sa génitrice, que la boisson fade qu’elle leur prépare n’est autre que le sperme fermenté de Soleil, son amant. Weche décide de se venger de l’attitude humiliante de sa mère. Se déguisant en femme et paralysant sa mère lorsqu’elle se rend à l’essart, il se substitue à elle lorsque Soleil vient au rendez-vous convenu. Tranchant le pénis de Soleil d’un brusque coup de couteau, Weche apprête son “trophée” dans un repas qu’il offre à sa mère. Lorsqu’elle apprend ce qu’elle a mangé, de honte, elle se transforme en grenouille (lojojo). Weche et ses frères prennent la résolution de poursuivre Soleil, dont on ne dit pas au juste s’il demeure châtré ou reconstituera ses parties. Ils préparent un ensemble de flèches qu’ils tirent en direction du ciel, veillant à ce qu’elles s’emboîtent les unes dans les autres. Lorsque la terre et le ciel se trouvent unis par cet assemblage, ils se transforment en fourmis et montent au ciel. Après quelques aventures où, au terme de l’une d’elles, Weche doit ressusciter ses frères, ils deviennent gendres de Soleil. Un jour, le héros qui dispose d’un corps intrinsèquement froid décide de convier Soleil à se baigner avec lui. Il refroidit tellement l’eau de leur bain commun qu’il manque de tuer Soleil, qui ne devra de recouvrer la santé qu’aux soins de ses filles. Fatigués de vivre chez leur beau-père, Weche et ses frères partent vers le grand aval des rivières. Certains disent que Weche défie alors l’homme feu Ayma-shuñe, lui faisant lâcher prise lorsque qu’il lui prend la main, tant il est froid. Weche et ses frères se transforment dans la constellation des Pléiades. Le lever héliaque de Weche correspond à la saison des pluies et aux vents froids et humides qui, à cette saison, remontent par-delà le Chaco de la pampa argentine.
Discours rapporté, paroles des ancêtres
Énoncer un mythe présuppose un savoir qui consiste lui-même en une aptitude performatrice de restitution. Le savoir mythologique prend, une fois qu’il est acquis, une forme de “possession” qui ne diffère guère, pour les Yuracaré, de celles des artefacts, voire de certaines parties du corps “accessoires”, mais qui fonctionnent comme marqueurs de l’identité d’une espèce ou de l’appartenance à un genre sexuel (fruits, fleurs, cornes ou bois, dentitions spécifiques, griffes, queue, organes reproducteurs mâles ou femelles, etc.). Pour dire que l’on connaît un récit mythologique on peut dire en effet en yuracaré <Ka-tütü-y ati buybu>, « J’ai ce “mythe” ». Dans cet énoncé, la forme verbale traduite par « avoir » (ka-tütü) correspond à un emploi transitif du verbe « être là » (tütü) portant, suffixé, un marqueur verbal d’objet (ka).16 Cette construction renvoie ici à une possession qui coïncide avec une notion de disponibilité à soi, telle qu’elle peut être paraphrasée par des expressions comme « avoir avec soi », « avoir auprès de soi », « être pourvu de ». La possession relève donc davantage du registre général de la disponibilité ou de l’ornementation que de celui qui l’exprimerait comme une souveraineté transcrivant le lien d’un sujet autonome et actif sur un objet aliéné et passif.
Les mythes yuracaré n’ont pas de titre particulier et pour les évoquer individuellement sans les raconter, on les présente par le nom de leur héros ou une périphrase qui l’inclut, en revanche, on peut les désigner, de façon générale, comme des <pëpê-shama-w ma-buybu>, les propos de feu les anciens ». Alors que “du dehors”, pour décrire les mythes, on a recours à une terminologie qui implique leur appartenance à un genre de discours déterminé par des critères de forme et de contenu – ce sont précisément des mythes ou plus simplement des récits, des narrations –, les Yuracaré les caractérisent exclusivement en fonction des conditions de possibilité de leur énonciation. Techniquement, ce sont d’abord et avant tout des discours rapportés qui émanent d’une classe de gens ou de personnes particulières, les pëpê-shama-w, qui en sont les donateurs : les mythes se présentent donc à ceux qui les énoncent comme les paroles tenues autrefois par des gens qui aujourd’hui sont morts. Elles se présentent comme nôtres, parce qu’elles ont d’abord été leurs, et on en devient possesseur parce qu’on les reçoit.
La façon dont les Yuracaré traitent l’activité langagière en général, mais aussi les caractéristiques grammaticales des énoncés mythologiques confirment que les mythes en tant que buybu des pëpê-shama-w sont appréhendés comme des paroles retenues plutôt que comme des récits. Terme métalinguistique nominal renvoyant à l’activité langagière d’une façon générale, buybu saisit celle-ci hors de toute opposition de type langue / parole et sans opérer de césure classificatoire entre l’émission de parole, la personne qui parle ou le code qui rend ses paroles intelligibles : il ne renvoie pas à un genre de discours, mais vise les paroles elles-mêmes. À l’instar du regard, la parole manifeste une faculté expressive. Dans ce cadre, la notion de buybu renvoie à l’activité langagière, comme autant de manifestations d’intentionnalité individuelle dans leurs productions, susceptibles d’une signification collective. Ce sera aussi bien « ce qu’un tel veut dire », que le milieu, au sens écologique du terme, des expressions intelligibles partagées par les congénères ou parents qui communiquent entre eux et dont les intentions sont mutuellement intelligibles.
côté d’une expression comme <Ati-lë-jti ti-buybu !>, « Voilà tout ce que j’avais à dire ! » ou, plus littéralement, « Cela seulement est ma parole ! », où buybu thématise l’investissement subjectif de quelqu’un dans ses propos, on utilisera la construction inclusive ta-buybu pour dire « notre langue, notre façon de parler », « le yuracaré », en contraste avec Chimani ma-buybu, « la langue des Chimane », par exemple. Dans les quelques composés ou les constructions non directement nominales qu’il permet de constituer, buybu devient une racine qui renvoie toujours clairement à une capacité ou à une intention communicative. D’un bébé qui ne produit qu’un babil inintelligible on dira : <Nish i-buybu.>, « Il est dépourvu de parole. » ; <Kani i-buybu.>, « Il ne peut pas encore parler. » Que buybu s’attache à la parole en acte, à une capacité de communication, se comprend également à la manière dont a été rendue, dans les traductions bibliques, la figure du prophète : un prophète est un Dios a-buybú-tebe, un « instrument de la parole divine », formulation qui s’éclaire lorsque l’on sait que certains Yuracaré diront plaisamment qu’un téléphone voire un poste de radio est un buybú-tebe, un « instrument pour communiquer »17. Enfin, un autre terme de racine buybu montre l’importance d’une médiation conceptuelle de l’activité langagière par son aspect expressif. Cette racine est utilisée dans une construction idiomatique adverbiale (marquée par le suffixe -sh), (a)-buybu-sh qui, dans un contexte non discursif, vient qualifier un mouvement ou une action sans cause externe intelligible, immanente à la personne qui la produit. Elle prend, en traduction, la valeur de « par soi-même », « tout seul », « de son propre chef » : <A-buybu-sh delle.>, « Il est tombé tout seul. », littéralement, « Il est tombé à la manière de sa parole. » ; <A-buybu-sh otto.>, « Il est sorti de son propre chef. »
La construction très rigide des énoncés mythologiques affirme par ailleurs, de manière systématique, qu’ils appartiennent tous au registre du discours rapporté, puisque tous, y compris les énoncés descriptifs, requièrent l’usage du marqueur évidentiel -ya18. Cet enclitique, qui signifie aussi bien que l’énonciateur n’était pas présent au moment des faits qu’il relate, ou qu’il dit ce que d’autres que lui peuvent dire également parce que, comme lui, ils l’ont écouté, conditionne la forme assertive du discours mythologique qui de ce fait reste de l’ordre du on-dit. Paraphrasé précisément par l’expression espagnole dizque (contraction de la forme « se dice que », « on dit que »), l’usage de l’enclitique -ya fait de la narration d’un mythe une longue citation ponctuée voire scandée de « on dit qu’il a dit » (ta-ya), « on dit qu’il lui a dit » (ku-ta-ya).19 Le « on » par lequel il est possible de “pronominaliser” l’effet du modalisateur -ya en français renvoie à la chaîne des narrateurs qui se le sont transmis, à savoir, plus précisément, les pëpê-shama-w.