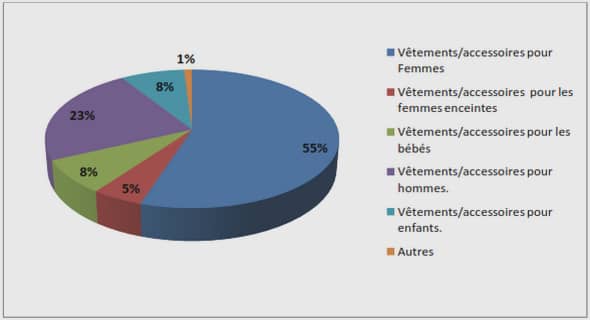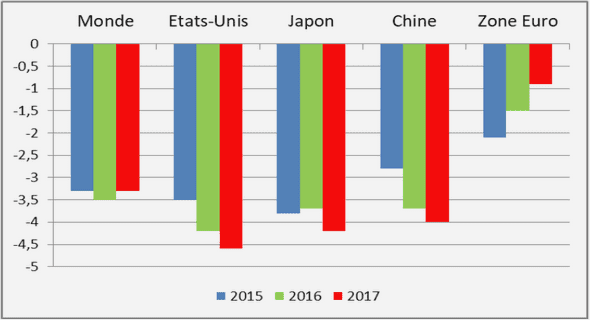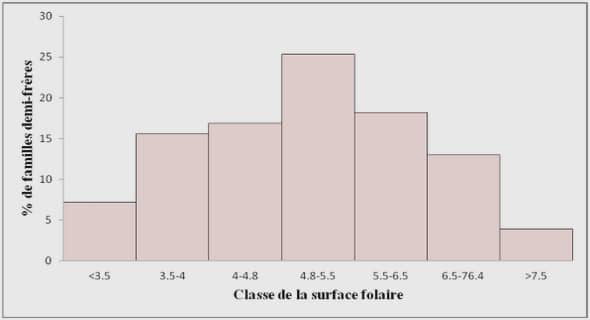Les théories du processus
Ces théories du processus ont pour mission d’expliquer les comportements et la mobilisation des individus en analysant l’interaction des facteurs environnementaux et individuels, c’est-à-dire la manière dont les individus se motivent pour travailler. Selon Vroom14, la motivation est fonction de trois facteurs : l’intensité de l’attente, l’instrumentalité du résultat en termes de conséquence et la valence ou valeur aux yeux de l’individu pour que la motivation soit supérieur à zéro. C’est la théorie de V.I.E ou Valence-Instrumentalité-Expectation. Elle est centrée sur les attentes et les valences de l’individu par rapport à des comportements particuliers, dans des situations particulières. C’est à dire que pour qu’un individu s’engage réellement dans l’action qui lui est proposée par l’organisation, il faut qu’il réponde oui aux trois questions suivantes : L’expectation : suis-je capable de réussir l’action demandée ?
Il s’agit en quelque sorte d’évaluer la probabilité de réussite de l’action. Cette évaluation est subjective et certains individus ont plus confiance que d’autres dans leurs capacités de réussite. Selon ROTTER , les individus fondent leur expectation sur les expériences passées d’échec et de réussite. C’est en quelque sorte l’opinion que chacun a de lui-même et de ses possibilités à atteindre un but donné, dès lors qu’il fait les efforts nécessaires. L’expectation implique de ce fait, l’image de soi, les données caractérisant la situation actuelle et les expériences antérieures, ainsi que les exigences de la tâche.
L’instrumentalité : la réussite de l’action conduit-elle de manière quasi certaine à l’obtention d’un enjeu (une récompense par exemple) ? Il s’agit ici de la transparence organisationnelle du processus, la loyauté du jeu garantie aux salariés c’est-à-dire une probabilité de recevoir telle ou telle récompense en fonction de la performance réalisée. Autrement dit, c’est la représentation des relations entre la performance et les
résultats de second niveau tel que le salaire, les primes ou le sentiment d’avoir accompli quelque chose de valable. Des systèmes de des chances d’atteindre leurs objectifs.
La valence : la récompense obtenue présente-t-elle une réelle valeur ? Il s’agit ici de l’importance subjective de l’enjeu aux yeux du salarié c’est-à-dire si l’individu ressent de l’attrait à l’égard des objectifs, de la performance et les récompenses espérées. La valence est donc la caractérisation affective attachée par chacun aux résultats de ses activités, fondée sur la manière dont chacun représente les résultats de la performance qu’il est en train de réaliser ou qu’il va réaliser.
Les différents types de motivation du personnel
Etant donné que tous les individus n’ont pas le même problème, la motivation de chacun est de ce fait différente. On distingue alors quatre types de motivation des salariés, à savoir :
La motivation finale : elle se définit comme l’énergie que l’employé tire du résultat qu’il vise à raison des avantages que cette finalité revêt à ses yeux. En ce sens, c’est l’objectif même qui intéresse l’individu et qui l’incite à agir. Pour ce dernier, seul compte le résultat.
La motivation instrumentale : dans cette optique, c’est l’art et la manière qui comptent, et le résultat est avant tout l’expression de cette perfection technique. Pour un individu dont la motivation peut être classé dans cette catégorie, c’est son intérêt pour le savoir-faire ou la technique de production qui peut le pousser à l’action.
La motivation de survie : c’est celle qui préside aux actes sans lesquels aucun autre acte ne serait envisageable. Il s’agit de survivre avant tout. Par exemple, pour une personne qui effectue un stage probatoire dans une entreprise, tout ce qui la préoccupe, c’est de réussir son essai ou son stage et de conserver son emploi.
La motivation obsessionnelle : c’est la motivation finale endogène et radicale. C’est celle qui idéalise, conduit à tous les sacrifices et « déplace les montagnes ». Le but est tellement essentiel, qu’il devient une obsession. C’est la situation où l’individu est autant passionné pour le résultat à tel point que la fin justifierait les moyens.
La différence entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque
La motivation intrinsèque : Elle signifie que l’on pratique une activité pour le plaisir et la satisfaction que l’on en retire.
Une personne est intrinsèquement motivée lorsqu’elle effectue des activités volontairement et par intérêt pour l’activité elle-même sans attendre de récompense ni chercher à éviter un quelconque sentiment de culpabilité. C’est ainsi que de nombreux facteurs peuvent déterminer cette motivation intrinsèque.
La motivation extrinsèque : La motivation extrinsèque se définit comme suit : le sujet agit dans l’intention d’obtenir une conséquence qui se trouve en dehors de l’activité même. Par exemple, recevoir une récompense, éviter de se sentir coupable, gagner l’approbation sont des motivations extrinsèques. Et tout comme la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque également est déterminé par des facteurs.
Le rôle de la motivation dans l’entreprise
La motivation qu’elle soit dans une entreprise ou ailleurs sert à faire avancer les choses et à faire repousser ses propres limites. Par la motivation donc, on crée une influence sur le groupe qui nous entoure. Dans une entreprise, elle sert à tirer tout le monde dans le même sens, c’est à dire, celui de la progression (qualitative ou quantitative). Il existe différentes sortes de motivation, à savoir: la motivation pécuniaire (argent), la motivation promotionnelle, ou même la motivation de résultat(en touchant la fierté des salariés). Ils ont pour rôle d’aider l’employé à se surpasser en lui permettant d’exprimer le meilleur de lui-même tant pour la société que pour lui. C’est pour cela, par exemple, que des sociétés élisent chaque mois un employé du mois.
Théorie sur la performance sociale de l’entreprise
La performance sociale se définit comme « la satisfaction et la qualité de vie au travail du personnel » . Elle comporte une dimension externe et renvoie à la question de la responsabilité sociale de l’entreprise, c’est-à-dire des effets sociaux externes de son activité.
Elle mesure également le niveau d’atteinte des objectifs de l’entreprise par rapport à la motivation et à l’implication des salariés. La performance sociale est généralement utilisée dans le cadre de l’évaluation du système de GRH, c’est-à-dire qu’une entreprise socialement performante est une entreprise qui a su mettre en place un mode de prévention et de règlement des conflits efficaces. Cette performance sociale est donc la capacité de l’organisation à mobiliser efficacement ses ressources humaines. Et pour cela, elle doit s’assurer de leur bien- être. Mais cette performance sociale est également stratégique afin de soigner l’image que l’organisation renvoie à son environnement. Concrètement, l’organisation va mettre en œuvre des actions visant à améliorer les conditions de travail ou la rémunération afin de donner envie aux salariés de s’investir. Et pour mesurer cette performance sociale, des indicateurs sont nécessaires.
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
Chapitre I. MATERIELS ET METHODES
Section 1. Matériels
1.1. Théorie sur la motivation du personnel
1.1.1. Les théories dites du contenu
1.1.2. Les théories du processus
1.1.3. Les différents types de motivation du personnel
1.1.4. Les facteurs de motivation des salariés
1.1.5. La différence entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque
1.1.6. Le rôle de la motivation dans l’entreprise
1.2. Théorie sur la performance sociale de l’entreprise
1.2.1. Les indicateurs de la performance sociale
1.2.2. Le bilan social
1.2.3. Les tableaux de bord sociaux
1.2.4. La valorisation de la performance sociale
Section 2. Méthodes de collecte et de traitement des données
2.1. Déroulement de la visite
2.2. Méthodes de collecte des données
2.3. Méthode de traitement des données
2.4. Limite de l’étude et difficulté rencontrées
Chapitre II. RESULTATS
Section 1. Données statistiques relatives à la motivation des salariés de la société EUFONIE
1.1. Données statistiques concernant l’effectif de la société
1.2. Données statistiques concernant la rémunération
1.3. Données statistiques concernant la motivation des salariés
1.4. Intégration des salariés dans leur environnement de travail
Section 2. Données statistiques relatives à la performance sociale de l’entreprise
2.1. Le style de management
2.2. Données statistiques concernant le comportement des salariés
2.2.1. L’absentéisme
2.2.2. Le retard
2.2.3. Le nombre de retard et d’embauche
2.2.4. Les stratégies utilisées par la société pour motiver ses salariés
Chapitre III. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS
Section 1. Discussions
1.1. Analyse des résultats obtenus
1.1.1. Analyses relatives à la motivation du personnel
1.1.2. Analyse relatives à la performance sociale
1.2. Etude des forces et des faiblesses de la motivation du personnel
1.3. Etudes des opportunités
1.4. Etudes des menaces
Section 2. Recommandations
2.1. Réussir à intégrer le personnel
2.2. Créer une bonne ambiance au travail
2.3. Favoriser la communication interne
2.4. Ouverture au changement
2.5. Un bon politique stratégique
2.6. Evolution professionnelle des salariés
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
WEBOGRAPHIE
ANNEXES
Annexe 1
Annexe 2