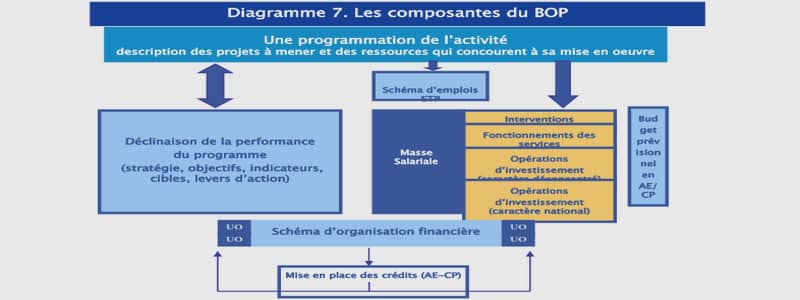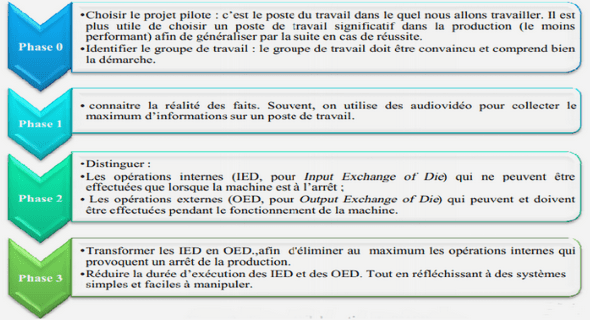Allier les défaillances de l’État social
Le recentrage sur la prévention sociale devient un avantage, mais cela n’exclut pas de nouveaux obstacles. En effet, l’importance accordéeà la police dans la lutte contre la délinquance s’explique en grande partie par l’absence d’institutions de nature sociales ou éducatives intervenant sur la délinquance. Ce que l’on nomme « la questionpénale » a toujours été négligée par les pouvoirs publics392 et, contrairement à ce qui a eu lieu dans un certa in nombre de pays – en Europe continentale et aux États-Unis surtout – le dévelop pement du système pénal n’a pas donné lieu à la mise en place de toute une série d’institutions quifonctionnent en lien avec le système pénal et remplissent des missions sociales et éducatives . Si certaines ont été créées par la loi, leurs moyens sont tellement réduits qu’elles sont purement fictives. Une première raison est liée au type de Code pénal en vigueur. Au dix-neuvième siècle, ’estc-à-dire lorsqu’ils deviennent des États indépendants, les pays latino-américains adoptent esd Codes pénaux et des Codes de procédure pénale fortement inspirés de ceux en vigueur dans ‘Espagnel coloniale. En plus, ils vont conserver ces Codes jusqu’aux années 1990394 , alors même que l’Espagne, et les autres pays d’Europe Continentale ont réformé les leurs à la fin du dixneuvième- et pendant le vingtième siècles . Ainsi, en Argentine, le Code pénal en vigueur jusqu’au début des années 1990 datait de 1921 et les Codes de procédure pénale (fédéral et provincial) dataiende la fin du 19è siècle . Ce Code Pénal prévoyait seulement quatre type de peines: la prison, la réclusion, l’amende et l’inhabilitation, en sachant que la première était la plus utilisée parles juges . Ce que l’on nomme les peines alternatives à la peine de prison n’existaient pas dans ce Code. Elles sont introduites seulement dans un « patronat des reclus et des libérés » [Patronat de Recluidos y Liberados], institution responsable de la prise en charge des sortants de prison, avait été créé dans les années 1930. Mais, encore aujourd’hui, le Patronat des reclus et des libérés manque cruellement de moyens et dans la pratique, les mesures de réinsertion post-carcérale sont inexistantes.
Dans les années 1990, c’est-à-dire après la périodedes dernières dictatures (années 1970 – 1980), la nécessité de réformer les Codes en vigueur est soulevée mais la question pénale reste Caimari, Lila, “Ciencia y Sistema penitenciari o”, Academia Nacional de la Historia, Nueva historia de la Nación Argentina. La Argentina del Siglo XX , Tomo VIII, Editorial Planeta, 2001, pp. 471-496, p. 483. Traduction notre.
En Europe et aux Etats-Unis par exemple, un certain nombre d’institutions et de professionnels provenant du champ « social » mènent des actions d’insertion sociale et des actions éducatives auprès des personnesqui font l’objet d’une procédure judiciaire. C’est ce que Michel Foucault décrit dans Surveiller et punir lorsqu’il explique que la naissance des prisons s’est accompagnée de l’apparition de nouveaux savoirs et de nouveaux acteurs: médecins, surveillants, aumôniers, psychiatres, psychologues, éducateurs. Foucault, Michel, Surveiller et Punir, Naissance de la prison, éditions Gallimard, 1975.
Dans les années 90, la quasi totalité des paysde la région fait voter de nouveaux Codes de procédure pénale. Cf Chapitre 2.
Pour être exact, il faut mentionner que les pays latino-américains ont connu des mouvements de réforme pénitentiaire au XIXè siècle puis au milieu du XXèMais. ceux-ci n’ont pas été suivis d’effets dans lapratique car les moyens matériels et humains nécessaires ne sont jamais attribués. Dès lors, au moment des transitions,les institutions pénales sont dans une situation très mauvaise. Elles cumulent plus d’un siècle de désengagement financier / budgétaire, plusieurs épisodes de dictature pendant lesquels les établissements pénitentiaires ont servi de lieuxde détention et de torture. Sur les deux réformes pénitentiaires, milieu 19è siècle (indépendances) et années 1940 (premier gouvernement péroniste), voir Caïmari, Lila, “Ciencia y Sistema penitenciario”, Academia Nacional de la Historia, Nueva historia de la Nación Argentina. La Argentina del Siglo XX , Tomo VIII, Editorial Planeta, 2001, pp. 471-496.
Le CPP national date de 1888; Caïmari, op cit, 2001, p. 482.
Caïmari, 2001, op cit., p. 483 et Virgolini, 1992, op cit, pp. 138-139 et p. 155.
Caïmari, 2001, op cit.
Essentiellement parce que de nombreux militants politiques ont été emprisonnés pendant les dictatures et que, à la démocratisation, ceux-ci se mobilisent pour réformer la législation et améliorer les conditions ed vie dans les prisons. Comme le dit l’historienne argentine Lila Caïmari « La dictature de 1976 – 1983, avec la découverte des négligée par les élus et la réforme des lois ne ccompagnes’a pas d’un investissement en moyens humains et matériels: la « modernisation » ou « l’humanisation » des lois ne s’est pas accompagnée de changements dans les institutions pénales par manque de moyens. Un exemple concret: les juges ont rarement recours aux peines alternatives parce que les institutions responsables de leur application manquent de personnel. Pour résumer, laréforme des textes de loi est restée sans effets sur les pratiques.
Concernant la justice des mineurs, la situation est un peu différente au départ mais aboutit au même résultat: les pays latino-américains ont systématiquement adopté les lois les plus « modernes » mais ils ne les ont jamais appliquées . En Argentine, une justice des mineurs existe depuis le début du vingtième siècle . Elle a récemment été réformée pour respecter lesnormes internationales les plus récentes – notamment l’application de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, que l’Argentine a incorporé à sa Constitution Nationale en 1994 – mais les réformes qui en découlent sont toujours en cours, esl institutions censées accueillir les mineurs « en situation de risque » et les mesures éducatives prévues ne sont pas appliquées . On peut donc avancer la même conclusion que pour la justice pénale: toutes ces réformes sont restées lettre morte. Aujourd’hui, les institutions censées accueillir les mineurs sont délabrées, il n’y a pas de séparation entre les mineurs qui relèvent de la protection de l’enfance et mineurs « délinquants », et aucune mesure éducative spécifique destinée à la prise encharge de ces derniers n’est mise en place. En conséquence, plutôt qu’une justice des mineurs qui privilégie la protection de l’enfance pour les mineurs « en danger » ou « en situation de risque » et l’éducation – rééducation pour les mineurs « délinquants », les institutions judiciaires existent seules et à la place des institutions éducatives et sociales. Le résultat est que la justice des mineurs pallie l’absence de politiques sociales et éducatives destinées aux mineurs .
À côté ou en plus de l’absence d’un « Etat éducateur »403, en Amérique Latine, il n’y a pas eu Centres de détention, de tortures et d’assassinat, marque une inflexion dans les représentations sur al peine et le châtiment » et la démocratisation renouvelle les espoirs, et les promesses « d’un châtiment civilisé » Caïmari, 2001, op. cit., p. 493.
L’Argentine est le premier pays a adopter, en 1921, une Législation spécifique pour les mineurs ley[ de Patronato de Menores] c’est à dire à peine vingt an s après que la création aux Etats-Unis, dans l’Etatde l’Illinois, du premier Tribunal pour mineurs. A l’époque cette législation était considérée moderne et progressiste uisquep les juges pour mineurs considéraient que leur mission était vant tout la protection de l’enfance. Dans la foulée, des asiles, réformatoires et orphelinats [asilos, reformatorios, orfanatos] visant à accueillir ces mineurs sont c réés de même qu’une institution chargée de veiller à leur bon fonctionnement: le Patronat national des mineurs [Patronato Nacional de Menores]. A partir de 1945, la prise en charge des mineurs par l’État repose sur la notion d’assistance, l’accent est mis sur l’éducation des mineurs « en danger » et la priorité donnée à la promotion de mesures éducatives ne milieu ouvert. BELOFF, Mary, “Constitución y derechos del niño”, i n David Baigún et al., Estudios sobre Justicia Penal. Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005. Guemureman, Silvia, Daroqui, Alcira, “Los menores de ayer, de hoy y de siempre. Un recorrido histórico desde una perspectiva critica”, Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, N°13, 1999. Après la démocratisation, on ne parleplus de mineur « en danger » mais “en situation de risque”, on donne la priorité au maintien des mineurs dans leurs familles ou dans leur « communauté» [tratamiento en el medio] et au développement de programmes préventifs. Le Conseil des mineurs devient Conseil national du mineur et de la famille [Consejo Nacional del Menor y la Familia]. Tenti Fanfani, “Politicas de asiste ncia y promocion social en la Argentina”, Boletin Informativo Techint, julio – agosto 1987, p. 90-91 non plus de développement d’institutions sociales et éducatives autonomes au pénal, ce que l’on appelle l’État social, c’est-à-dire l’existence d’u ne politique sociale et d’un système assuranciel avec ses acteurs et ses institutions. Celui-ci est resté très faible. Parmi les pays latino-américains, l’Argentine est pourtant celui dans lequel ce type d’institution s’est le plus développé puisque les premières lois, institutions et mesures d’assurancesociale apparaissent au début du dix-neuvième siècle et un système assuranciel voit le jour dans les années 1940 et 1950, c’est-à-dire pendant le premier gouvernement du général Perón. C’est ce quesouligne la sociologue argentine Laura Golbert, laquelle préfère parler de d’État providence « créole » (“Welfare State Criollo”) pour signifier que celui-ci s’est construit sur un modèle particulariste, par extension de privilèges accordés a quelques groupes appartenant à l’élite conomiqueé et politique, l’armée et les fonctionnaires de certaines administrations publiques notamment. Par la suite, ces droits ont certes été étendus à d’autres catégories sociales mais demanière limitée et en dehors d’un contexte démocratique, ce qui explique pourquoi le système d’assurance sociale a conservé sa logique particulariste404. Rubén Lo Vuolo et Alberto Barbeito parlent à ce sujet d’un « système hybride » qui se décline en trois branches. Le centre du systèmes’est constitué autour d’assurances autonomes pour les travailleurs et leur famille concernant les retraites, la santé et les allocations familiales. En parallèle, un système universaliste d’influence social-démocrate – les services publics – a vu le jour dans les domaines de l’éducation, des prestations familiales et une partie du système de santé par le biais des hôpitaux publics. Enfin, une politique as sistantielle s’est développée avec l’objectif de prendre en charge les exclus du système d’assurance405.
partir des années 1970 et comme conséquence du changement du modèle économique, ce système subit une première réforme et la politiqueassistentielle, auparavant résiduelle, devient l’outil central pour pallier les effets négatifs de l’ajustement 406. Cette inflexion est renforcée au
cours des années 1990 et les deux mandats du président Carlos Menem407. L’État se désengage et le système des assurances est en grande partie dérégul et laissé au secteur marchand tandis que les services publics se dégradent ou font l’objet de programmes assistantiels ciblés, par exemple dans la santé publique, l’éducation, la formation professionnelle. Emilio Tenti Fanfani explique que cela aboutit à la constitution d’un champ d’activités, d’instances de production de biens et services qui deviennent un refuge pour les marginaux: éducation dite “non formelle”, assistance médicale “primaire”, emploi “spécial”, logement “minimal” et c409. La politique assistantielle, quant à elle, a traitement éducatif » pour les mineurs délinquants par l’ordonnance de désormais pour objectif la lutte contre la pauvretéet se construit en référence au seuil de pauvreté aux « Nécessités de Base Insatisfaites » (NBI), lesdeux indicateurs utilisés pour mesurer la pauvreté . Elle prend la forme de programmes assistanciels ciblés et d’aides sociales en direction des plus pauvres. Ces programmes et aides sont financés massivement par des crédits provenant des bailleurs de fonds multilatéraux, sont mis en œuvre par de nouveaux acteurs – ONG, églises, associations d’habitants, fondations, etc – et font appel à la participation des habitants 411.
La faiblesse de l’État social argentin a des effets directs pour le programme communautés vulnérables. Dans les pays qui ont mis en place des politiques de prévention de la délinquance, celles-ci sont nées soit dans le sillage de cet État éducateur, soit dans celui de l’État social, soit un peu des deux à la fois. En Amérique Latine, ces antécédents à partir desquels la prévention aurait pu se greffer n’existent pas. De plus, la mise en œuvr e du programme communautés vulnérables suppose que l’État réinvestisse les quartiers défavorisés, puisque c’est dans ces territoires que le programme doit être appliqué. Dès la première annéed sa mise en œuvre, les auteurs de ce programme sont confrontés à une série de difficultés qui résultent directement de l’abandon par l’État de ces quartiers. Les quartiers d’habitat informel argentins se caractérisent avant tout par l’absence d’institutions étatiques. Les professionnels du programme Communautés vulnérables sont dès lors privés de relais dans les quartiers: ils ne peuvent s’appuyer sur des acteurs et des institutions étatiques déjà implantés et ayant une bonne connaissance de chaque quartier et de ses habitants. Dans la plupart des quartiers, ils réussissent à contourner cette difficulté en tissant des liens avecles associations.
Néanmoins, une deuxième difficulté se pose: l’équipe peine à trouver, parmi les professionnels de l’Etat, des personnes qui ont une expérience du terrain et sont disposées à se rendre dans les quartiers défavorisés pour intervenir auprès de jeunes, qui plus est de jeunes définis comme des « délinquants » ou des délinquants potentiels. Comme le dit Maria, la plupart des membres de l’équipe ministérielle n’a aucune expérience préalable d’intervention directe dans des villas: pour la majorité de membres de l’équipe, c’étaitla première fois qu’ils se rendaient dans une villa. Ils « découvrent » la réalité sociale des habitants de ces quartiers. La rencontre avec le terrain et le travail direct auprès de la population cibléesont vécus comme une épreuve, conséquence à la fois de la dureté des conditions de vie dans les villas et du manque d’expérience de l’équipe qui est peu ou mal préparée à y faire face.
On s’est formés sur le tas. On n’avait aucune expérience. La plupart d’entre nous, c’était la première fois qu’on entrait dans une ville. C’étaitpas genre: waouh, ces gens ont des années d’expérience de travail avec cette population. Non.La plupart a eu un premier contact avec ce type de population en travaillant dans ce programme. Et tu dois être super rodé pour que ça ne t’affecte pas dans ta vie privée, pour ne pas rentrer chez toi avec ta journée de travail. C’est très compliqué, ça. Plein de personnes ont littéralement explosé. lsI ne voulaient plus travailler avec cette population. D’autres au contraire en ont fait une affaire personnelle, ils défendaient les mômes comme s’il en allait de leur vie. […] Quand on a co mmencé à travailler, on a tous été très investis et ça a répercuté sur nos vies personnelles. L’équipeétait très susceptible, on reproduisait entre nous la violence qu’on voyait dans les quartiers Là, on a commencé une supervision. Après ça, des gens sont partis. Parce que travailler avec cette population n’est pas facile. Tout le monde ne peut pas Tenti Fanfani, 1991, op cit. p. 127; Vilas, Carlos: “De ambulancias, bomberos y policías: la política social del neoliberalismo”, en Revista Desarrollo Económico , Nº 144, vol. 36, Buenos Aires, IDES, enero-marzo 1997
Prévôt Schapira, Marie France « Du Welfare à l’assistance: la décentralisation de l’intervention sociale en Argentine », Cahiers des Amériques Latines, n°15, Paris, 1994; Merklen, Denis, Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática [Argentina 1983 – 2003], Editorial Gorla, Buanos Aires 2005; Cardarelli, Graciela; Rosenfeld, Mónica: Las participaciones de la pobreza. Programas y proyectos sociales, PAIDOS, Buenos Aires, 1998; Sigal, Silvia, « Marginalidad espacial, Estado y ciudadania », Revista Mexicana de Sociologia, n°4/81, Mexico, 1981 faire ce boulot. Ne peut pas et ne veut pas. Travailler avec ces jeunes et directement dans les quartiers. Tu arrives au quartier et tu deviens un canal de transmission de toutes les demandes possibles et imaginables. On peut te demander du ciment pour construire sa maison, de tout. Rien que canaliser les demandes et limiter à ce qui conc ernait la prévention de la délinquance, ça nous a demandé un boulot fou. Et je te dis, les gens sont tout simplement partis » (Maria, co-coordinatrice du plan).
D’autres membres de l’équipe refusent tout simplement de participer à son application. Rosana, employée dans la direction de politique criminelle, explique que, lorsqu’elle a été sollicitée par son directeur, et à l’instar d’autres employésde cette direction, elle a refusé car elle « ne voulait pas aller dans une villa ». Elle ajoute qu’« au sein du ministère, ceux qui travaillent dans le plan, c’est ceux qui travaillent avec les pauvres ». Comme beaucoup de métiers qui impliquent de travailler auprès de populations stigmatisées, faire de la prévention sociale est considéré comme une activité peu “noble” par une partie des employés du ministère de la Justice412 . Aller dans les quartiers est considéré comme la partie la plus difficile, mais aussi la plus ingrate, de leur métier.Le travail direct auprès de la population ciblée est vécu comme une épreuve, conséquence à la fois de la dureté des conditions de vie dans les villas et du manque d’expérience des employés ministériels, peu ou mal préparés à y faire face.
Ensuite, l’équipe est débordée par les demandes denature assistancielle qui émanent des habitants. Les « agents de prévention » sont identifiés comme des travailleurs sociaux et le programme Communautés vulnérables est vu comme une aide sociale, non pas comme un programme de prévention de la délinquance. Or, la olitiquep d’aide sociale repose essentiellement sur la distribution de biens alimentaires et matériels, et les habitants de ces quartiers ont pris l’habitude d’aller demander auprès des différentesassociations ce dont ils ont besoin. Le sociologue Denis Merklen dit à ce sujet que ceux-ci sont contr aints de se comporter comme des « chasseurs urbains », à l’affût de la moindre opportunité qui leur permettra de subvenir à leurs besoins 413. La tradition assistancialiste de la politique sociale a encouragé ces pratiques consistant à demander des aides. On peut mesurer à quel point les conditions dans lesquelles ils sont amenés à intervenir – et l a situation des habitants des villas – sont éloignées de l’idéal de développement et participationde des habitants.
Enfin, si l’État argentin est quasiment absent des quartiers défavorisés dans sa dimension sociale, les politiques répressives menées depuis al fin des années 1990 ont au contraire accru la présence des institutions pénales, plus particulièrement de la police. Ainsi, les jeunes hommes de ces quartiers sont très souvent contrôlés et arrêtés par des policiers et victimes des abus que commettent ces derniers. Cela a contribué à alimenter la méfiance de la population vis-à-vis des policiers414 . Cette méfiance se reporte sur les professionnels chargés d’appliquer le programme Communautés vulnérables, qu’ils présentent aux habitants comme un programme étatique de lutte contre la délinquance. Ils sont alors soupçonnés detravailler pour la police et de vouloir obtenir des informations sur d’éventuels délinquants qui habiteraient le quartier. Pour résumer, faire de la prévention sociale suppose que les acteurs étatiques réinvestissent les quartiers défavorisés. Or, l’absence d’une tradition d’intervention étatique irected dans ces quartiers prive ceux-ci des ressources humaines et des relais nécessaires. Identifiés soit comme des travailleurs sociaux soit comme des auxiliaires de police, les « agents de prévention » sont pris entre des demandes d’ordre assistanciel et l’évitement.
La victoire du candidat de l’Alliance aux présidentielles de 1999 inaugure une période d’inflexion dans l’action publique, avec l’évolution vers un équilibre entre une revalorisation de l’action des policiers et la poursuite d’expériences de participation citoyenne destinées à démocratiser ce domaine de l’action publique. Avecle gouvernement de l’Alliance, un nouveau terme apparaît: la prévention de la délinquance. Mais, lorsque le gouvernement de l’Alliance prend la tête de l’État fédéral, l’idée de lancer un plannational de prévention de la délinquance est seulement à l’état de projet. Dans un premier temps, la prévention n’est qu’une des composantes d’une politique de sécurité qui se veut « progresstei » et s’articule autour de trois axes: la législation pénale; la réforme de la police; et la prévention,ce dernier axe étant la principale innovation apportée par ce gouvernement en matière de sécurité.Le plan national de prévention de la délinquance va prendre forme petit à petit. Mais le plan est porté essentiellement par des acteurs de second rang au sein du gouvernement de l’Alliance et se révèle trop ambitieux, par rapport au projet présidentiel initial d’une part, et par rapport auxpossibilités du gouvernement fédéral pour faire appliquer un plan national sur l’ensemble du territoire, d’autre part. Dans un premier temps, l’appui des deux ministres lui donne un certain poids, mais cela ne suffit pas, le plus important étant que les gouverneurs et les maires l’appliquent effectivement. Or, au vu des politiques qu’ils mettent en place, il apparaît que pour le gouvernement fédéralcomme pour les gouverneurs des provinces, la priorité est la réforme de la police.
L’application du plan dans la ville de Buenos Aires, puis la chute du gouvernement de l’Alliance fin 2001 entraînent une reformulation du plan, laquelle se traduit par une revalorisation de la stratégie sociale et la création du programme communautés vulnérables. Confrontés aux échecs et difficultés pour réformer les forces de police et mposeri un contrôle citoyen, ou par conviction politique, des gouverneurs et des maires s’intéressent à la prévention sociale et décident d’appliquer le programme communautés vulnérables. Le contenu dece programme s’inscrit à la fois dans un discours qui dénonce les violences policières et met en avant la défense des droits de l’homme, ainsi que dans une perception de la délinquance qui fait découler celle-ci de la pauvreté urbaine et se donne pour objectif de promouvoir l’intégration sociale. Il privilégie un traitement social de la délinquance en reprenant la tradition de l’intervention sociale communautaire. Mais il rencontre plusieurs difficultés qui ne sont pas liées tant àson caractère novateur vis-à-vis des politiques de sécurité menées par le passé qu’au démantèlementl’Étatde social argentin et à la faible implantation des institutions étatiques dans les quartiers défavorisés. Les mesures de prévention sociale de la délinquance se sont révélées matériellement trèsfficilesdi à mettre en place.
DU PLAN NATIONAL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE AU PLAN INTÉGRAL DE PROTECTION DES QUARTIERS
Que se passe-t-il après la crise de 2001 et la démission du président Fernando de la Rua? La crise économique et politique de 2001 se prolonge en 2002 et la dégradation de la situation socio-économique a des répercussions importantes en matière de sécurité. Après les événements de décembre 2001, les manifestations, souvent accompagnées d’actes de violence, ainsi que les saccages de commerces se multiplient. De plus, les délits augmentent, en particulier les délits contre la propriété, les enlèvements contre rançons et lesbraquages à main armée, notamment dans la capitale et dans la province de Buenos Aires. Enfin, l’insécurité devient la préoccupation principale dans les grandes villes, allant même, depuis 2004, jusqu’à dépasser le chômage 415 . Quelles décisions et actions les acteurs politiques adopten-ils dans ce contexte? Entre le 20 décembre 2001 et la mi-janvier 2002, quatre présidents intérimaires se succèdent à la tête de l’État fédéral argenti. Les trois premiers (entre le 20 et le 31 décembre) ne restent que quelques jours en poste416 puis Eduardo Duhalde, l’ancien gouverneur de la province de Buenos Aires, est élu président intérimaire par le Congrès le 1er janvier. Il reste à la tête du pays jusqu’en mai 2003, date à laquelle ont lieu des élections anticipées pour élire un nouveau président. Celles-ci sont remportées par un péroniste progressiste, Nestor Kirchner.
Il existe une certaine continuité entre la présidence intérimaire de Duhalde et le mandat de Kirchner du point de vue de la politique de sécurité. La répression des manifestations en décembre 2001 a fait plusieurs morts du côté des manifestants. Cela incite les nouveaux responsables politiques à se montrer hostiles vis-à-vis de toute intervention trop « musclée » de la part des forces de police et de sécurité. Au sein du gouvernement édéral,f Eduardo Duhalde adopte une série de remaniements administratifs destinés à montrer qu’il compte subordonner la politique de sécurité au respect des droits de l’homme. Le secrétariat à la sécurité intérieure est transféré au ministère ade l justice, rebaptisé ministère de la justice, de la écurités et des droits de l’homme. Mais cette réorganisation ne s’accompagne pas de la mise en place d’une politique plus active concernant l’encadrement des manifestations: jusqu’en 2003, lelaisser-faire prédomine. Par contre, concernant la lutte contre la délinquance, le gouvernement fédéral est obligé d’adopter des mesures, en grande partie sous la pression des gouverneurs, notamment celui de la province de Buenos Aires. Le gouverneur de cette province, le péroniste Felipe Sola, est confronté à une double difficulté puisque les conflits sociaux et la délinquance s’aggraventdans sa province tandis que les forces de police