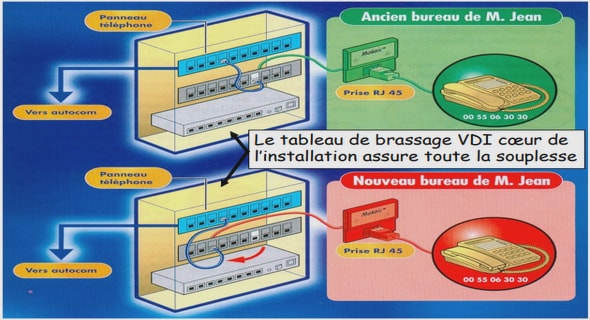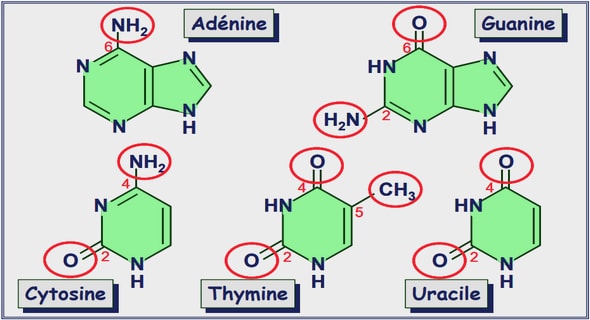Approche théorique et méthodique
Dans Le Deuxième Sexe I (1949), Simone de Beauvoir répond à la question de savoir ce qu’est une femme : elle explique la différence entre homme et femme en étudiant plusieurs auteurs et philosophes. « L’homme définit la femme non en soi mais relativement à lui, elle n’est pas considérée comme un être autonome » (Beauvoir 1949 : 15-16). L’auteur réfère à M. Benda qui dit que : « l’homme se pense sans la femme. Elle ne se pense pas sans l’homme » (Beauvoir 1949 : 16). Beauvoir explique que la femme n’est pas un être humain autonome, elle a toujours été considérée comme l’Autre :
Elle se détermine et se différencie par rapport à l’homme et non celui-ci par rapport à elle ; elle est l’inessentiel en face de l’essentiel. Il est le Sujet, il est l’Absolu : elle est l’Autre (Beauvoir 1949 : 16).
L’inégalité entre les deux sexes résulte dans cette hiérarchie. Les conflits entre hommes et femmes se construisent quand les femmes veulent se libérer de cette situation.
Beauvoir écrit que la société dans laquelle nous vivons est composée d’une majorité et d’une minorité. Les hommes se considèrent comme la majorité et les femmes alors comme la minorité. Le groupe le plus puissant est celui de la majorité, c’est-à-dire nous vivons dans une société patriarcale car les hommes ont beaucoup plus de droits que les femmes. Beauvoir ne veut pas éliminer les hommes de la société, elle veut, tout simplement, souligner que : « il y a autant de femmes que d’hommes sur terre » (Beauvoir 1949 : 19). Selon l’écrivaine la femme est essentielle à la société ; elle est aussi le Sujet et l’Absolu : « elle est l’Autre au cœur d’une totalité dont les deux termes sont nécessaires l’un à l’autre » (Beauvoir 1949 : 21). La relation entre les deux sexes dépend donc l’un de l’autre.
Beauvoir décrit la situation de la femme comme handicapée dans cette société :
Or la femme a toujours été, sinon l’esclave de l’homme, […] les deux sexes ne sont jamais partagé le monde à égalité ; […] bien que sa condition soit en train d’évoluer, la femme est lourdement handicapée. (Beauvoir 1949 : 22)
Cela fait que les femmes ne se revendiquent pas comme Sujet, au contraire elles se contentent dans le rôle de l’Autre.
Le Deuxième Sexe II (1976) de Simone de Beauvoir traite la question entre autres de la polygamie et de l’image de la femme par rapport à l’homme. Beauvoir analyse la situation de la femme mère et de la femme mariée mais aussi sa situation dans la vie sociale. Nous pouvons mieux comprendre la situation de Ramatoulaye, dans la société sénégalaise, en tant que mère et épouse, après avoir lu cette œuvre. Nous allons y revenir à ce chapitre dans l’analyse.
Dans Emerging Perspectives On Mariama Bâ, Ada Uzoamaka Azodo (2003) examine la religion islamique et dit qu’elle joue un rôle important dans la société sénégalaise, la polygamie est présente dans la vie quotidienne dans la plupart des familles. Selon la religion, les femmes sont censées partager leur mari avec d’autres femmes, mais de retour elles doivent le partager équitablement : « The […] Qur’anic verse […] grants men permission to marry up to four wives as long as they are treated “with equity” » (Azodo 2003 : 180). Ce n’est pas le cas de Ramatoulaye, qui suit les règles de la religion et se prépare pour le partage de Modou avec Binétou. Modou l’abandonne en brisant les règles d’un mariage polygame. Azodo considère la réaction de Ramatoulaye comme ironique, car elle accepte la vie polygamique mais refuse de pardonner à Modou.
L’écrivain dit que d’une façon le malheur de Ramatoulaye est de sa faute parce qu’elle, en épousant Modou, avait de très hautes attentes de mener une vie monogamique avec lui : She and Modou entered into their mariage with such strong, monogamous ideals that when he betrayed those ideals, she was unable to let go of her love for him. (Azodo 2003 : 187)
En nous basant sur ces œuvres présentées ci-dessus, nous allons nous servir d’une analyse thématique pour étudier l’image de la femme dans la société sénégalaise en nous concentrant sur Ramatoulaye, l’héroïne. Cette première question sera étudiée dans les chapitres « Le malheur de la polygamie » et « Mariage et amour ». La deuxième question que nous allons aborder est d’étudier les effets de la modernisation sur la femme, encore une fois en nous concentrant sur Ramatoulaye après la mort de son mari. L’analyse de la deuxième question se trouve dans les chapitres ; « Une femme plus moderne » et « L’abandon, quelque chose de bien ». Pour pouvoir examiner ces questions, Beauvoir prend une place importante comme elle analyse ce qu’est la femme dans son livre Le Deuxième Sexe. Pour approfondir nos connaissances sur la situation de la femme chez Mariama Bâ, nous allons analyser les idées de Azodo (2003) dans Emerging perspectives on Mariama Bâ qui fait une critique du roman Une si longue lettre. Cette critique va nous donner une idée du développement de la situation de la femme au Sénégal.
En ce qui concerne les références dans le mémoire, nous allons utiliser le système Harvard pour faciliter le travail. Le roman principal de ce mémoire est Une si longue lettre, donc lorsque nous faisons des références à ce roman nous indiquerons seulement la page entre parenthèses.
Études antérieures
J.O.J. Nwachukwu-Agbada (1991) écrit un article sur les romans de Mariama Bâ, « One Wife Be for One Man ». L’auteur étudie le roman Une si longue lettre, et dit que Mariama Bâ est contre l’idée de la polygamie parce qu’elle la considère comme une humiliation de la femme. Nwachukwu-Agbada souligne qu’il ne faut pas considérer le fait que les femmes acceptant la vie polygamique comme un acte de soumission ou d’humiliation (Agbada 1991 : 565).
Dans Emerging Perspectives On Mariama Bâ, Ada Uzoamaka Azodo (2003) analyse les personnages féminins de Mariama Bâ. L’auteur explique que Mariama Bâ, à travers Ramatoulaye et Aïssatou, montre que les femmes peuvent se moderniser dans une société patriarcale. Azodo (2003) explique l’évolution de Ramatoulaye en se référant à ses actions dans Une si longue lettre (1981). Pour pouvoir réussir et faire un changement dans sa vie, en étant une femme dans une société patriarcale, il faut avoir une solidarité féminine « sisterhood » (Azodo 2003 : 145).
• The Gathering of Women in Mariama Bâ’s Fictional World », un article écrit par Djotaayi Dieguenye (2004), analyse les personnages féminins de Mariama Bâ. L’auteur de cet article explique premièrement, l’importance pour Ramatoulaye d’écrire cette lettre ; c’est une manière de revendiquer ses droits et de faire entendre sa voix. Deuxièmement, l’auteur décrit Mariama Bâ comme une écrivaine prise entre deux mondes, l’un est celui des traditions et l’autre est celui de la modernisation.
Dans son article « Confidently Feminine » (1996), Nicki Hitchcott décrit les héroïnes d’Une si longue lettre. Selon elle, Aïssatou a la qualité d’une nouvelle femme « New Woman » (Hitchcott 1996 : 146) alors que Ramatoulaye est décrite comme une co-épouse (ibid.). La décision de divorcer d’avec Modou montre qu’Aïssatou refuse la vie polygamique, c’est pour cela que Hitchcott lui attribue la qualité de nouvelle femme. Cependant Ramatoulaye accepte la vie polygamique et le statut de co-épouse, elle est une femme qui est persuadée du fait que l’homme et la femme se complémentent : Ramatoulaye, the protagonist, endorses Bâ’s own theory of the essential unity of women and men » (Hitchcott, 1996 : 147).
La littérature africaine de Mariama Bâ
Avec son premier roman Une si longue lettre (1979), Mariama Bâ devient connue pour sa voix féministe avec laquelle elle écrit dans la littérature africaine moderne. L’œuvre gagne le prix Noma, Francfort en novembre 1980. Le roman est un roman de mœurs qui renvoie à l’image de la société africaine d’une certaine époque, la période coloniale et postcoloniale.
Mariama Bâ décrit des personnages féminins qui sont indépendants ou en train de le devenir. Ces femmes n’ont pas peur de faire entendre leurs voix pour combattre les inégalités existantes dans la société sénégalaise. Bâ ne s’adresse pas seulement aux lecteurs féminins mais aussi aux lecteurs masculins en parlant du problème de la vie polygamique et des difficultés des femmes pour s’insérer dans la vie sociale et politique.
Azodo (2003) se réfère à Almeida qui critique les personnages féminins de Bâ, et qui caractérise les voix de ces femmes par le phénomène de « malaise » (Azodo 2003 : 154). C’est un phénomène commun aux écrivains africains féminins de la même génération que Bâ. Almeida dit que ce phénomène vient du dilemme devant lequel les femmes se trouvent entre tradition et modernisation : « [malaise] emerges from the dilemma women face in wanting to keep traditions while, at the same time, wanting to reject what, in society, ties women down » (Azodo 2003 : 154).
Bâ, dans son roman, et aussi dans le monde réel, critique les conditions de vie des femmes dans plusieurs sociétés africaines. Elle parle de la façon dont les femmes africaines ont été décrites par les écrivains masculins avant que les écrivains féminins ne fassent entendre leurs voix. Bâ n’est pas seulement un écrivain africain mais aussi une femme africaine, elle dit : The woman writer in Africa has a special task. She has to present the position of women in all its aspects. …As we women must work for our own future. We must overthrow the status quo which harms us and we must no longer submit to it. …We no longer accept the nostalgic praise to the African Mother who, in his anxiety, man confuses with Mother Africa (Azodo 2003 : 154).
Cette citation fait référence aux sociétés africaines patriarcales. La tâche des écrivains africains féminins est de démontrer que les femmes ont autant de privilèges et de droits que les hommes. Et cela est en ligne avec ce que Beauvoir dit : « il y a autant de femmes que d’hommes sur terre » (Beauvoir 1949 : 19).
Il reste encore beaucoup de progrès à faire pour que la femme puisse se voir comme libre et pour que les conditions des femmes soient en égalité avec celles des hommes. Mariama Bâ a été membre de plusieurs associations féminines qui luttent contre les inégalités entre homme et femme, par exemple Amicale Germaine Legoff, Soroptimiste International et le Cercle Fémina.