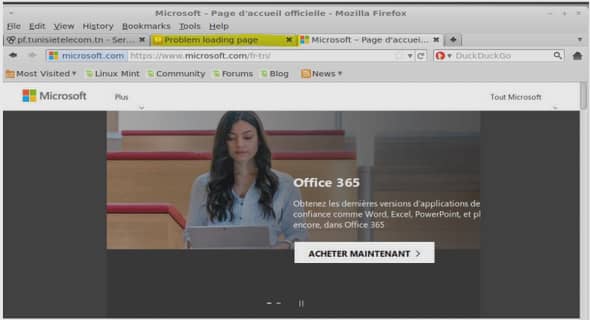les concepts imprégnés de valeurs
L’épistémologie conventionnelle de l’analyse économique cherche à séparer économie positive et économie normative. L’économie positive décrit de manière objective ce qui est, l’économie normative enseigne ce qui doit être. L’économie normative est guidée par des valeurs, tandis que l’économie positive organise sans filtre la réalité telle qu’elle se voit. Si l’économiste reconnait volontiers que des valeurs président à l’établissement des propositions de l’économie normative, il défend en revanche le caractère scientifique et objectif de l’analyse économique. L’analyse économique serait positive et totalement exemple de jugements de va-leur. En explorant la composante idéologique des concepts et des méthodes de l’analyse économique, je prête nécessairement le flanc à l’accusation d’avoir mé-connu le caractère positif de l’analyse économique.
Le cantonnement des valeurs en dehors de l’analyse économique ne paraît en pratique pas toujours absolu que l’économiste le souhaiterait. D’une part, la possibilité d’une science positive repose sur l’établissement de tests non ambigus, dénués de jugement de valeur. Mais des conditions ancilliaires, nécessaires à l’établissement du test, ne peuvent pas être assurées. Le test d’une hypothèse est donc soumis à controverses et toujours ambigu. Il n’est pas possible de tester sans introduire de jugements de valeur, ne serait-ce que méthodologiques. D’autre part, les économistes ne cessent de s’accuser mutuellement de mêler concepts et valeurs dans leurs raisonnements, d’adopter ou de refuser telle théorie pour des raisons normatives. D’un point de vue pragmatique, les débats en économie sont toujours hantés par la question des valeurs, l’économie positive est encore un vœu pieu.
Pour dissiper les incompréhensions et prévenir les objections, je me suis efforcé de clarifier le rapport aux valeurs, à la fois dans la théorie économique et dans cette thèse.
Si l’épistémologie contemporaine s’inspire largement de Milton Friedman (1953), cette position traditionnelle sur la séparation des faits et des valurs re-monte à Max Weber. En 1904, celui-ci publie un article « L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociale ». Cet article lance une série de débats en 1909 sur les rapports entre les valeurs et la connaissance au sein du Verein für Sozialpolitik, qui regroupe l’école historique allemande. L’ancienne génération de l’école historique a développé ses recherches en lien fort avec des valeurs, notamment de justice sociale. Elle va se disloquer sur la question de l’ob-jectivité, en raison de conflits implicites sur les valeurs à promouvoir. Les parti-sans de la neutralité axiologique, en particulier Sombart et Weber, vont fonder une nouvelle association, la Deutsche Gesellschaft für Soziologie (Brochier et Keller, 1998). Après le Methodenstreit entre Menger et Schmoller, le Werturteilstreit (que-relle des jugements de valeur) est la deuxième controverse des méthodes à avoir secoué les écoles allemandes d’économie et de sociologie 1.
Quoiqu’il traite Schmoller avec déférence, Weber se distancie de son ensei-gnement, en refusant son objectif d’établissement, dans la justice sociale, d’une Allemagne économiquement puissante. Schmoller croyait possible d’atteindre par l’expérience (Erfahren) des jugements de valeur objectifs. Au contraire, pour Weber, le monde moderne est caractérisé par la pluralité de valeurs. Les valeurs sont éclatées, sans système commun pour les intégrer, à la différence de l’époque où la religion dominait la société. Les valeurs sont devenues subjectives et il n’est pas possible de les choisir rationnellement. Elles sont irrémédiablement an-tagoniques. A contrario, la science doit être objective, indépendante du sujet qui énonce les résultats. Elle doit permettre une confrontation rationnelle des idées. Elle ne peut faire place aux valeurs. Weber oppose donc les jugements de fait aux jugements de valeur. Il prône la neutralité axiologique (Wertfreiheit), c’est-à-dire la séparation entre faits et valeurs dans la recherche scientifique.
Le savoir objectif est possible, malgré l’orientation subjective inhérente à toute recherche, à condition d’utiliser des concepts et un langage sans jugement de valeur implicite. Dans ce but, Weber développe les idéaux-types. L’objectivité est atteinte grâce à l’universalité des règles de raisonnements et de démonstration, qui s’appliquent à toute démarche scientifique. La séparation entre faits et valeurs permet d’atteindre une meilleure connaissance des moyens mis au service des valeurs. Elle éclaire donc les conséquences de la sélection de certaines valeurs.
La clarification de Weber est un point de passage obligé pour la réflexion méthodologique. Elle est un acquis de la démarche scientifique. Elle est cepen-dant difficile à mettre en pratique. La neutralité axiologique est un idéal, mais pouvons-nous le réaliser ? Comment être sûr que les jugements de valeur ne s’in-troduisent pas à notre insu dans l’analyse ? Dans la pratique de la recherche, est-il vraiment possible de dissocier, de manière étanche, les jugements de valeur et les jugements de faits ?
Un prolongement utile est fourni par la réflexion de Gunnar Myrdal, écono-miste suédois, récompensé du prix de la Banque de Suède en l’honneur de Nobel en 1974, en même temps que Friederich Hayek.
Dans son ouvrage Venteskap och politik i nationalekonomien 2, Myrdal (1930) con-teste l’objectivité des économistes. Les économistes prétendent arriver à des con-clusions positives, purement objectives. Ils fournissent des recommandations po-litiques qui seraient des vérités ne reposant sur aucun jugement normatif. Or, pour Myrdal, les économistes se leurrent. Ils ont élaboré progressivement des théories formelles à partir d’éléments de la philosophie du droit naturel. Les concepts qu’utilisent les économistes se sont peu à peu vidés de leur coloration morale d’origine. Mais ce biais n’a pas disparu pour autant. Il est naturellement réintroduit dans l’analyse, pour donner corps à des concepts devenus éthérés. De la sorte, les économistes croient formuler des recommandations positives, alors qu’ils ne font que retrouver les enseignements de la philosophie du droit naturel.
Myrdal voit le développement de la théorie économique au xixe siècle comme un raffinement constant de ce cercle logique ; les développements de l’analyse économique ne font qu’accroître la distance entre le préjugé normatif et la conclu-sion « positive ». Les propositions ont de plus en plus l’apparence de la pure posi-tivité mais ne parviennent pas à se passer d’élément normatif. Pour le démontrer, Myrdal procède à une critique immanente de la théorie économique : il prend comme point de départ les enseignements de la théorie. Les propositions écono-miques sont affectées d’un cercle logique qui les rendent indéterminées. Myrdal montre alors que les économistes ne s’y limitent pas quand ils en viennent aux recommandations de politique économique. Ils lèvent l’indétermination des pro-positions par le recours à une prémisse normative. Ils réintroduisent alors les en-seignements de la philosophie du droit naturel, dont leur système est imprégné. Par exemple, la définition de l’utilité souffre d’être circulaire. On peut y échapper en supposant une mesure, ce qui permet la comparaison interpersonnelle des uti-lités. Proscrite par la théorie pure, cette comparaison est, d’une manière ou d’une autre, cruciale pour l’application du concept. Dans la science économique du xxe siècle, ces travers sont présents de manière exemplaire dans l’œuvre de Mises, qui est une reformulation moderne de la philosophie du droit naturel (Gonce, 1973).
La critique immanente de Myrdal s’inspire de la philosophie de son compa-triote Axel Hägerström, qui débusque une métaphysique inconsciente dans la pensée populaire ou scientifique. Cette métaphysique inconsciente est dange-reuse car elle ne fournit pas les armes à sa critique (Ferraton, 2008). Les éco-nomistes prennent à leur insu les propositions du droit naturel pour des énon-cés empiriques. Ils prêtent d’autant moins d’attention aux biais normatifs qu’ils ignorent l’origine morale de leur théorie.
En 1930, Myrdal croit encore possible d’arriver à un petit corpus de proposi-tions purement positives. Dans ses travaux ultérieurs, il abandonne cet espoir. Il renonce en fait à la séparation entre faits et valeurs. Les jugements de valeur sont partout dans l’analyse économique. Présents dans l’application des propositions théoriques au réel (cf. 1.4.3), ils accompagnent les faits sélectionnés, les concepts et la manière de présenter les conclusions. Non seulement les valeurs orientent la recherche, mais elles imprègnent jusqu’à ses résultats (Peltier, 1990).
Si la réalité était façonnée par la Raison, la Raison ne ferait, par l’investigation scientifique, que se découvrir elle-même dans le monde. La positivité totale serait possible. Si l’on renonce à cette idée, les thèses de Myrdal n’ont rien de surpre-nant. Lorsque la réalité est contradictoire et non rationnelle, les phénomènes ne peuvent pas s’organiser d’eux-mêmes en un tout cohérent. Un cadre théorique est nécessaire pour sélectionner les phénomènes, les ordonner en faits et proposer un récit cohérent sur le monde. Lisons Myrdal : Les valeurs guident et accompagnent notre recherche. La recherche désintéressée n’a jamais existé et ne peut pas exister. Avant les ré-ponses, il doit y avoir les questions. Il ne peut pas exister de vue sans point de vue. Dans les questions posées et les points de vue sélection-nés, les valeurs sont implicites.
Nos valeurs déterminent notre approche d’un problème, la défini-tion de nos concepts, le choix des modèles, la sélection de nos ob-servations, la présentation de nos conclusions — en fait, la poursuite entière d’une étude du début à la fin. En demeurant inconscients du système de valeurs pour notre recherche, nous continuons de raison-ner avec une prémisse manquante, ce qui entraîne une indétermina-tion ouvrant la voie à tous les biais. (Myrdal, 1978a, p. 778-779) 3
Pour Myrdal, il est donc impossible de construire une économie positive. On ne peut se saisir du réel de façon objective. Entre le réel et la recherche scientifique s’intercalent toujours des valeurs. La simple appréhension des faits s’opère au moyen de concepts qui sont imprégnés par les valeurs qui guident la recherche. Les faits ne sont donc pas neutres car ils se sont généralement perçus à travers des concepts imprégnés de valeurs (value-laden concepts). Cette idée de concepts imprégnés de valeur est une étape importante dans l’explicitation du rapport de l’économie aux valeurs. Nous la reprenons à notre compte. Les concepts utilisés par l’économie sont des concepts chargés de valeurs, et nous préciserons plus tard quelles sont ces valeurs.
Dans un contexte où les valeurs sont omniprésentes, y compris dans les con-cepts scientifiques, Myrdal nous offre un antidote pour maintenir un espace de discussion rationnelle. La principale recommandation méthodologique de Myrdal est d’exposer clairement les valeurs qui forment la base de la recherche. Ce précepte s’avère un bon complément pratique à la neutralité axiologique de Weber (Ferraton, 2011). Mais si une science axiologiquement neutre est idéale-ment possible, rien n’assure cette neutralité axiologique en pratique. Le premier garde-fou à mettre en place, même dans l’idéal wéberien, est de dévoiler les va-leurs qui motivent la recherche.
En signalant clairement les valeurs qui guident la recherche, on donne au lec-teur les moyens de se prémunir contre les jugements de valeur qui pourraient s’introduire dans le raisonnement. Celui-ci se garde plus facilement d’une chose identifiée et répétée que d’une chose inconsciente. Paradoxalement, masquer l’im-portance des valeurs dans les propositions théoriques et prétendre adopter une position neutre est moins objectif qu’expliciter clairement ses orientations norma-tives.
Cette façon de procéder, en posant en amont de la réflexion des valeurs qui guident la recherche, n’est donc pas une régression épistémologique, une conta-mination volontaire des catégories scientifiques par des préceptes normatifs. Elle n’est nullement le signe d’une recherche normative mais le préalable pour que la discussion rationnelle, c’est-à-dire l’énoncé de ses arguments et l’écoute de la partie adverse, soit possible. Le discours scientifique énonce ses propositions de telle sorte qu’elles puissent être discutées. Il doit donc dévoiler l’ensemble des éventuels implicites derrière les propositions.
Lorsque les valeurs marquent irrémédiablement le raisonnement, la seule façon d’avoir une approche scientifique est d’expliciter les valeurs qui accompagnent la recherche. Sans ce moment d’objectivation, les valeurs restent à l’arrière-plan, dissimulées mais néanmoins agissantes dans le discours. La volonté de séparer distinctement les valeurs et les faits, lorsqu’elle conduit à taire les valeurs, se tra-duit donc, de manière paradoxale, à une confusion plus grande entre les deux, puisque les valeurs restent cachées et ne sont pas soumises à la discussion ra-tionnelle. L’explicitation des valeurs est donc un moment essentiel du discours scientifique. Son objectif est de rendre lisible l’intégralité du cheminement intel-lectuel, depuis les valeurs qui guident la recherche jusqu’à l’analyse rationnelle.
L’exposition des valeurs à la base de la recherche n’a pas pour but d’abou-tir à un accord sur les valeurs. Le conflit des valeurs est indépassable, c’est un domaine dont la raison ne peut pas rendre compte intégralement. Si l’on peut déplorer cet état de fait, il en découle également la possibilité d’un pluralisme scientifique, chacun étant libre d’être guidé par ses valeurs. Ce pluralisme est une bonne chose car il permet davantage de découvertes qu’un monisme méthodolo-gique et évaluatif. Le pluralisme méthodologique maintient vivante la recherche qui, sinon, pourrait être étouffée par une pensée unique. L’usage d’un modèle unique rend en effet plus difficile la perception de phénomènes qui contestent le paradigme. La coexistence d’une pluralité de méthodes et de valeurs est alors le moyen de lutter contre l’enfermement et les stratégies de protection que met en place tout système théorique 4. L’impossibilité de s’accorder sur les valeurs, qui apparaissait au départ comme une faiblesse, se change en force dans un monde traversé de contradictions.
Cette façon de concevoir la recherche reconnaît le caractère normal des contro-verses dans la discipline économique, et plus largement dans les sciences so-ciales. Dans ces sciences, le conflit sur les méthodes, sur la délimitation de la discipline ou sur les catégories de base, n’est pas une anomalie mais la règle. La discipline économique ne sera jamais une science normale au sens de Kuhn. Un seul paradigme ne pourra jamais rendre compte de la totalité de l’économie. Un paradigme organise nécessairement des coupures dans le réel pour le réduire en théorie. De la sorte plusieurs paradigmes concurrents peuvent coexister car ils organisent différemment leur objet à partir d’une même totalité économique (Mouchot, 1996, chap. 15). Il faut donc faire le deuil d’une science positive ou neutre.
Myrdal apporte néanmoins quelques limites au pluralisme des valeurs. Toutes les valeurs sont possibles en théorie, mais toutes ne sont pas également perti-nentes pour la recherche. Les valeurs qui guident la recherche doivent être parta-gées par des groupes sociaux. Pour faire avancer la connaissance sur les aspira-tions de son époque, le chercheur doit sélectionner des valeurs qui animent des groupes sociaux spécifiques. Ainsi sa recherche résonnera au-delà de ses convic-tions personnelles. La sélection des valeurs par le chercheur est donc astreinte à une obligation de réalisme et de pertinence. Myrdal, lorsqu’il expose ses valeurs dans American Dilemma ou Asian Drama, les relie à la philosophie des Lumières, c’est-à-dire pour lui un idéal de progrès et d’égalité.
En accord avec les préceptes méthodologiques de Myrdal, je dois, à mon tour, préciser les valeurs qui animent cette recherche.
Les milieux naturels sont aujourd’hui dégradés. On ne trouvera pas ici de li-tanies rappelant les dégradations environnementales. Ce sujet est connu. Deux grands phénomènes me semblent particulièrement importants à considérer : le changement climatique et la perte de biodiversité, qui concerne tous les grands types d’écosystème. L’existence de ces deux dégradations me paraît suffisam-ment bien établie par les travaux des sciences de la vie et de la terre pour qu’elles soient prises comme des données de l’analyse. On pourrait également citer d’autres dégradations préoccupantes, comme l’acidification des océans, le rejet des phosphates dans l’eau (Rockström et al., 2009). La conjonction de ces dégradations fait craindre un basculement de l’état général de la Terre (Barnosky et al., 2012). Ces préoccupations resteront à l’arrière-plan, et l’analyse dans cette thèse se concentrera avant tout sur le changement climatique.
Ce rappel pose l’enjeu par rapport auquel je dois affirmer mes valeurs. Ces va-leurs sont celles d’une conscience écologique. J’estime que préserver les milieux naturels est une bonne chose. Je pense qu’il s’agit là d’une tâche importante
laquelle l’humanité doit faire face dans les prochaines décennies. En disant l’humanité, je ne sous-entend pas que l’espèce humaine en tant que telle soit responsable de la dégradation des écosystèmes, ni que tous les humains doivent contribuer également à cette préservation. Je n’ignore pas les « responsabilités communes mais différenciées », selon la formulation de la CCNUCC. Le corps du texte donnera l’occasion de préciser les forces à l’œuvre dans ces dégradations et les principaux points de blocage.
Les préoccupations écologiques ne sont pas une simple lubie personnelle. Ces préoccupations sont anciennes, mais ont trouvé un développement systématique depuis une cinquantaine d’années, à la suite de bouleversements sans précédents de la structure productive. Elles jouent un rôle grandissant dans les discussions politiques. Le choix des valeurs écologiques s’appuient donc sur une réalité exté-rieure à la personnalité de l’auteur.
Il y a plusieurs façons de justifier ces préoccupations. Certaines lectures mettent en avant une sorte de religion de la nature dans les valeurs écologiques. Les thu-riféraires de la Raison accusent la sensibilité écologique d’être irrationnelle et mystique. Les écologistes les plus conscients défendent les milieux naturels, les espèces vivantes pour elles-mêmes, pour la valeur intrinsèque, la valeur d’exis-tence, dont ils sont porteurs. Ils voient la nature comme un tout, avec lequel l’homme doit vivre en harmonie (Worster, 1977). Sans me démarquer complète-ment de cette vision majoritaire, je pense néanmoins que la principale raison de protéger les milieux écologiques dans lesquels la vie humaine s’inscrit est instru-mentale. Ces milieux et ces régulations nous permettent de vivre. Leur destruc-tion équivaudrait à la fin programmée de l’aventure humaine. C’est bien d’abord pour des raisons humanistes, anthropocentrées, qu’il faut chercher à protéger les milieux naturels, supports de vie. La destruction des supports de vie conduit à des situations dangereuses pour les populations humaines, et, à terme, à une vie appauvrie. Les humains ne peuvent faire autrement que de vivre en collaboration avec les autres espèces.
Une objection pourrait être soulevée contre cette vision. Si le but est purement instrumental, pourquoi les valeurs écologiques doivent-elles guider la réflexion plutôt que, par exemple, des analyses économiques de type coût-avantage, ca-pables de mettre en regard les bénéfices et les dommages ? Les humains avec leur connaissance pourraient décider avec ce type de bilan ce qui est le mieux pour eux. Je ne souscris pas à cette vision d’un savoir qui permettrait de décider de manière absolue des avantages. Le savoir humain sera toujours radicalement incomplet face à l’évolution de la vie. Cette évolution est imprévisible, et nous ne pouvons prendre sa place, la diriger vers un but conscient. L’incertitude fonda-mentale des processus du vivant nous force à l’humilité. Cette humilité signifie que les humains doivent s’en remettre aux écosystèmes pour assurer la repro-duction des supports de vie. Ces systèmes naturels les ont, après tout, portés l’existence, et il n’y a pas de raison qu’ils ne continuent pas à le faire, pour peu que les humains ne détériorent pas ces systèmes et leurs fonctions régula-trices. Pour maintenir les conditions de possibilité d’une vie humaine, il paraît donc sage de limiter notre impact sur les cycles écologiques et de conserver des écosystèmes en bonne santé.
Si, toutefois, il s’avérait que l’humanité pouvait mener une vie purement artifi-cielle, uniquement soutenue par quelques bactéries commensales, alors cette jus-tification n’aurait plus de poids. Je ne puis cependant adhérer à cet objectif d’une humanité détachée de la vie terrestre, la dominant et finalement la condamnant disparaître. À l’heure où les techniques de l’information inventent des paradis artificiels numériques, je continue à préférer à ce monde créé rationalement par des intentionalités humaines, le monde de la nature, où nous découvrons l’étran-geté de ce qui n’a pas été prévu, la surprise d’un comportement qui n’est pas le nôtre. L’effacement de la nature dans notre cadre de vie rend cette expérience de plus en plus difficile. Il n’est pas impossible que, faute de l’exercer, l’humanité n’y trouve plus goût.
le statut de la théorie économique
Après la reconnaissance de l’imprégnation des concepts par les valeurs et l’ex-posé des valeurs qui accompagnent ce travail de recherche, le second temps de la stratégie d’explicitation du rapport aux valeurs clarifie les valeurs que l’on peut associer à l’analyse économique.
Par analyse économique, j’entends, selon la définition de Schumpeter, les re-cherches intellectuelles menées en vue de comprendre les phénomènes écono-miques. On pourrait parler également de science économique (economics) si cela n’était pas trop pompeux. Le système économique renvoie aux réalités de la produc-tion et de l’échange, telles qu’elles existent dans les différents pays, avec leurs im-perfections et leur bricolage. On pourrait aussi parler d’économie (economy), dans le sens où l’on dit économie nationale. L’analyse économique comporte donc les concepts et outils pour étudier et analyser les systèmes économiques réels.
La première difficulté pour cerner les valeurs derrière les concepts de l’analyse économique est son extraordinaire éclatement. L’analyse économique est parcou-rue de diverses écoles, qui se livrent des batailles féroces. Elle est dans un tel état de morcellement qu’il paraît en effet vain de fonder un raisonnement sur son unité. On peut cependant commencer par isoler une école que l’on appelle historiquement néo-classique, ou encore, dans un vocable plus révélateur, do-minante ou orthodoxe. C’est ce type d’analyse économique qui est majoritaire, c’est elle que l’on trouve sur les campus américains les plus renommés, c’est encore elle qui est présente dans les grandes revues de la discipline, et c’est en son sein que sont désignés les lauréats du prix en l’honneur d’Alfred Nobel. C’est l’analyse économique néo-classique qui est l’objet principal d’études. Les autres écoles, dissidentes et marginales, ne sont pourtant pas absentes de l’étude. Ce sera au contraire un enjeu majeur de comprendre les relations entre l’ana-lyse néo-classique et les écoles des post-keynésiens ou de l’économie écologique. L’analyse économique néo-classique correspond à ce que l’on entend générale-ment lorsqu’on parle de science économique.
Une fois restreinte l’analyse économique à l’analyse néo-classique, le problème reste cependant entier. L’analyse économique néo-classique peut toujours pa-raître trop éclatée pour qu’on puisse dire quelque chose de général la concernant. Elle est aussi suffisamment labile pour pouvoir être utilisée à de multiples fins, qui paraîtraient contredire les généralités que j’énoncerai. Il faut donc éviter un double écueil. Le premier est de subsumer l’ensemble de l’analyse économique sous une certaine essence. Je dois bien dans un premier temps reconnaître la diversité des écoles au sein même de l’analyse néo-classique. Beaucoup de tra-vaux ne participent pas d’une vision déterminée mais d’un bricolage conceptuel, qui tente de saisir, avec des outils imparfaits, une parcelle de réalité. Ainsi, par exemple, le calcul économique des ingénieurs-économistes qui s’inspire forte-ment du calcul à la marge de l’analyse néo-classique. Le second écueil est cepen-dant de dissoudre l’analyse économique néo-classique en une série de travaux singuliers, sans cohérence d’ensemble ni caractéristiques communes. Si l’on pro-cédait ainsi, parler de la vision propre à l’analyse économique néo-classique de-viendrait impossible : on aurait devant soi un champ complètement éclaté, une prolifération de visions particulières, propres à chaque chapelle, à chaque auteur. La pensée serait impossible (Beaud, 1998). On oublierait une continuité certaine de l’analyse économique, un certain nombre de concepts qui perdurent, profon-dément liés à des présupposés anthropologiques.